Cahiers de la documentation 2017/1 (mars 2017)
 Éditorial
Éditorial
1996 ! Sans aucun doute une année fertile pour le monde de l’information : le 21 mars a eu lieu notre premier Inforum, le 6 décembre est initialisé l’accord de coopération FELNET.
2016 ! Le 21 mai est organisé pour la vingt-et-unième fois l’Inforum sous le titre In information we trust !!!, le 20 octobre s’est tenu la journée d’études Milieu in formatie uitformatie ? afin de marquer le vingtième anniversaire de FELNET.
2017 ! Les actes de ces journées d’études alimenteront deux numéros des Cahiers de la Documentation. Vous en apprendrez plus sur le dernier dans un prochain numéro.
Le temps s’en va rapidement, trop rapidement à mon âge, mais l’abondance de bien est trop grande du moment qu’on survole rapidement vingt ans en deux paragraphes. Depuis plus de vingt ans, nous pouvons faire appel à des spécialistes du domaine réputés, belges ou étrangers, qui abordent des problèmes actuels dans le secteur de la gestion de l’information. Nous suivons de manière précise le nombre de participants depuis 2004, et avec des chiffres fluctuant d’année en année, nous pouvons constater que nos jours fastes se situent dans la période 2005-2007 et 2011-2012, avec près de trois cent participants. Revenons un instant à notre premier Inforum. Comme maintenant, la journée fut introduite par le président et se termina par une réception. À l’époque, pas moins de onze orateurs se succédèrent avec des exposés qui étaient plus courts, mais pas pour autant moins pénétrants. Quoique nous ayons une profession très dynamique, les sujets d’alors pourraient être ceux d’aujourd’hui : les problèmes liés à la diffusion électronique de l’information, le cadre juridique, les responsabilités du professionnel I&D.
La mise à disposition d’informations pertinentes et le fact checking de ces informations comptent indéniablement parmi les tâches du professionnel de l’information, ce qui nous amène immédiatement à l’Inforum 2016 In information we trust !!!
Nous y sommes confrontés chaque jour. Le meilleur exemple, ou peut-être le pire, c’est la presse, ou au moins une partie de celle-ci. Si nous regardons rapidement quelques nouvelles de l’année passée, nous trouvons de nombreux exemples. L’un d’entre eux, c’est que lors des discussions sur un éventuel saut d’index le vice-premier ministre Kris Peeters était souvent décrit comme un homme de la CSC, alors qu’en réalité, il a été plus de dix ans à la tête de l’organisation d’indépendants Unizo. D’autres cas sont survenus entre autres après les tristes attentats du 22 mars, lorsque des représentants d’un bord politique déterminé disaient que certains musulmans auraient célébré les événements, alors que pour autant qu’on sache, le parquet n’a pas dressé de procès-verbal, ou lorsque la rafle qui a suivi pour capturer l’un des suspects terroristes aurait été insuffisamment couverte par la VRT, contrairement à ce qui se passait sur une chaîne commerciale qui avait apparemment travaillé avec une compilation d’autres images. Ou comment les faits alternatifs ne sont manifestement pas une prérogative présidentielle.
Quand nous lisons tout cela surgit à un certain moment la question de savoir jusqu’à quel point l’information scientifique est fiable, ce qu’il faut faire d’un moyen comme Wikipédia, et de quelle manière nous devons finalement traiter la politique, ce qui paraît dans la presse et les bulles d’information. Tous ces aspects ont été amplement développés. Les présentations sont disponibles sur le site web de l’ABD-BVD. Les actes de trois exposés suivent dans ce numéro des Cahiers de la documentation.
Avant que vous ne commenciez à dévorer ce numéro sur une terrasse bien ensoleillée (au moment où j’écris cet édito il y a un beau soleil hivernal dehors), je me dois de remercier toutes les personnes sans lesquelles la réussite de l’Inforum serait impossible, à part le public, les orateurs et les modérateurs, il s’agit bien sûr de la Bibliothèque Royale de Belgique qui met son infrastructure à disposition, nos sponsors pour l’édition 2016, Ebsco et LM, ainsi que les responsables du soutien logistique, à savoir les interprètes, les hôtesses et le support technique de la Bibliothèque Royale. Ma reconnaissance s’adresse également à notre Conseil d’Administration qui m’a de nouveau donné la confiance pour coordonner les travaux autour de l’Inforum, et aux collègues du groupe de travail Inforum qui opère au sein de l’ABD-BVD : Christopher qui contribue depuis de nombreuses années pour examiner les sujets possibles, suggérer des orateurs, et assumer bon nombre de charges logistiques, Sara qui s’est entre autres appliquée à offrir aux non participants la possibilité de suivre l’Inforum de minute en minute et Michèle qui a collaboré pour la première fois en 2016 et dont l’entrée n’est certainement pas passée inaperçue lors de la recherche d’un thème adéquat et d’orateurs potentiels. Elle a été d’une valeur inestimable en assumant la rédaction de ce numéro spécial.
Je vous laisse maintenant feuilleter ce numéro tranquillement. Notez déjà dans vos agendas la date du prochain Inforum, qui aura lieu le 18 mai 2017, de nouveau à la Bibliothèque Royale de Belgique. Il s’agira des évolutions dans les services liés à l’information et de la mutation des publics.
Marc Van den Bergh
In information we trust ! Inforum 2016 de l’ABD
Florence Richter, Rédactrice en chef de Lectures.Cultures
L’Inforum de l’Association belge de documentation a 20 ans ! Et a fêté l’événement, le 12 mai dernier, à la Bibliothèque royale, en choisissant le thème de la fiabilité de l’information pour l’Inforum 2016, car, en 20 ans, le monde de l’information a beaucoup changé ; aujourd’hui, tout est très rapide et l’info très abondante… mais sommes-nous pour autant mieux informés ? Pas sûr…
Garantir l’exploitabilité des informations et des connaissances
Gilles Balmisse, Consultant indépendant, Co-Fondateur de KnowledgeAngels
Face à l’explosion du volume d’informations disponibles et la multitude d’applications permettant de produire, partager et diffuser ces informations, les organisations commencent à s’intéresser à un nouveau concept, celui de l’exploitabilité. Il s’agit en effet de rendre les informations et les connaissances accessibles, de qualité et sécurisées pour l’ensemble des collaborateurs. Pour y parvenir, de nombreux chantiers visant à refondre la gestion des contenus doivent être entamés. Mais si ces travaux sont en partie techniques, la dimension humaine et la conduite du changement associée ne doivent pas être négligées.
Strijd om het feit : De opkomst van factcheckers binnen en buiten de journalistiek
Peter Burger, Docent en onderzoeker journalistiek en nieuwe media, Universiteit Leiden
La vérification des faits, le noyau du métier journalistique, se trouve sous pression. Dans des rédactions aux effectifs réduits, moins de journalistes doivent produire plus d’actualités, dans un climat politique où tant les faits que les médias eux-mêmes font partie d’une lutte idéologique. En même temps, il existe un mouvement grandissant de personnes, actives dans les médias ou externes, qui font du « fact checking », effectuent un contrôle et un double contrôle, développant de nouvelles méthodes pour vérifier des faits. Les moyens pour ce faire n »ont jamais été aussi avancés que maintenant, et ils continuent à s’améliorer. Mais les nouvelles deviennent-elles meilleures grâce à toutes ces vérifications des faits ? Et le débat public ?
Vérifier l’exactitude des informations de Wikipédia : Quelques astuces…
Guy Delsaut, Professionnel de l’information indépendant et Wikipédien
En 16 ans, l’encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia est devenue une source d’information incontournable, mais, par son modèle, la fiabilité de son information fait l’objet de nombreux débats et controverses. Au lieu de la rejeter complètement ou de croire absolument tout ce qui y est écrit, il vaut certainement mieux apprendre à l’utiliser en comprenant comment elle fonctionne et comment on peut s’assurer de la fiabilité de l’information qu’elle contient. Cet article porte sur l’origine des erreurs et sur les moyens dont dispose le lecteur pour vérifier si l’information qu’il reçoit est fiable ou non. Bref… une plongée dans les coulisses de Wikipédia.
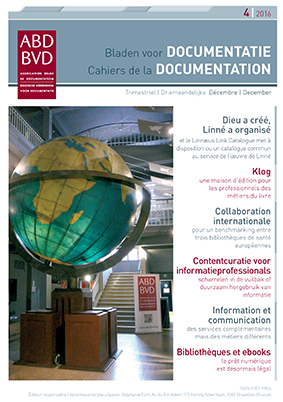
Éditorial
Quand on a demandé à Winston Churchill, en 1940, de réduire le budget de la culture pour soutenir l’effort de guerre, il a répondu : « Le réduire ? Mais alors, pourquoi nous battons- nous ? ». C’est un saisissant résumé des enjeux de la transmission du savoir et de l’art. Nous sommes heureux, à travers les Cahiers de la Documentation de participer – un peu – au débat sur cette transmission. A travers les évolutions et les choix technologiques et humains. Symboliquement, nous avons en photo de couverture une représentation du Mundaneum, à Mons, où s’est tenu notre Doc’Moment de septembre.
Dans ce quatrième numéro de 2016, vous trouvez tout d’abord un article sur le Linnaeus Link Catalogue rédigé par trois auteurs, Charwat, Fabri et Hanquart. Et oui, Linné, le grand savant du 18ème siècle ! Un catalogue collectif a été réalisé autour de son œuvre et de commentaires, alliant technologies avancées et restitution de documents anciens. Ensuite, vient l’interview des deux responsables de Klog, une nouvelle maison d’édition spécialisée dans NOS métiers de l’I&D. Puis, c’est à nouveau un trio d’auteurs, Buset, Declève et Ovaska qui nous expliquent leurs expériences de partage de benchmarking entre bibliothèques, dans Comment mener une collaboration internationale ? (…).
Lourense H. Das, avec Contentcuratie voor informatieprofessionals (…), décrit les mutations de l’information et l’accompagnement nécessaire donné par les spécialistes, entre-autres par la curation. Ensuite, Nathalie Boonen, avec Information et Communication (…), nous fait part d’une utile réflexion sur le partage des tâches entre… documentation et communication. Enfin, Séverine Dusollier nous éclaire sur un point de l’actualité du droit, une décision de la Cour de justice européenne en faveur de la légalité du prêt numérique.
L’année 2017 sera bonne pour l’ABD-BVD, avec de nombreuses rencontres : Doc’Moments, anniversaire des 70 ans de l’association et conférences de notre Inforum annuel ! Le sommaire est copieux : Bonne lecture !
Alain Reisenfeld
« Dieu a créé, Linné a organisé » et le Linnaeus Link Catalogue met à disposition ou un catalogue commun au service de l’oeuvre de Linné
Elaine CHARWAT, Linnaeus Link Administrator, Linnean Society of London
Régine FABRI, Chercheur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jardin botanique Meise
Nicole HANQUART, Chercheur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jardin botanique Meise
Le Linnaeus Link Catalogue est un catalogue commun dédié à l’œuvre du naturaliste Charles Linné, géré par la Linnean Society de Londres et rassemblant les fonds d’une vingtaine de bibliothèques européennes et nord-américaines. Après une brève présentation du savant et de l’importance toujours actuelle de son travail, cet article aborde la démarche qui a présidé à la naissance du catalogue, les aléas de son implémentation, mais aussi, et surtout, les fonctionnalités de cet outil tant au niveau de l’intégration des descriptions bibliographiques que de l’interrogation de la base par le lecteur. Il insiste enfin sur la consultation croissante de ce catalogue spécialisé aux dimensions somme toute réduites.
Klog, une maison d’édition pour les professionnels des métiers du livre
Interview de Clotilde VAISSAIRE-AGARD et Alain PATEZ, Fondateurs et responsables des Éditions Klog
réalisée par Guy Delsaut, membre du Comité de publication des Cahiers de la Documentation
Fondées en 2011, en Normandie, les éditions Klog publient des ouvrages à destination des professionnels des métiers du livre. À la fin de l’année 2016, près d’une trentaine de titres auront été publiés, dans trois collections ou hors collection. Ces ouvrages se veulent au plus près des pratiques professionnelles. Dans cette interview, leurs deux fondateurs lèvent le voile, entre autres, sur l’origine de la maison d’édition, sur la façon de promouvoir leurs publications, sur leurs dernières parutions… et les prochaines. Clotilde Vaissaire-Agard et Alain Patez nous expliquent également leurs parcours et leurs activités en dehors des éditions Klog.
Collaboration internationale pour un benchmarking entre trois bibliothèques de santé européennes
Karen Johanne BUSET, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, directrice de la Bibliotek for medisin og helse, Trondheim (Norvège)
Ghislaine DECLÈVE, Université catholique de Louvain, directrice de la Bibliothèque des sciences de la santé, Bruxelles (Belgique)
Tuulevi OVASKA, Itä-Suomen Yliopisto, directrice de la KYSin tieteellinen kirjaston KUH Medical Library Kys, Kuopio (Finlande)
La coopération internationale est une part importante du travail des bibliothécaires de santé et des professionnels de l’information en général. Trois bibliothèques européennes de sciences médicales et de la santé ont entamé en 2013 un projet de benchmarking. Ce projet a pour objectif de comparer les services proposés par les bibliothèques, de permettre aux participantes d’apprendre les unes des autres et de dégager de bonnes pratiques. Cet article présente un point d’étape du projet, il rapporte les expériences et discute les défis et les opportunités d’un benchmarking international pour les bibliothèques. Il décrit concrètement cette coopération, les moyens et les outils de communication, la manière dont le projet a été documenté et son déroulement.
Contentcuratie voor informatieprofessionals scharrelen in de vuilbak of duurzaam hergebruik van informatie
Lourense H. DAS, Onderwijsbibliothecaris, Meles Meles SMD
Les professionnels de l’information s’occupent de la collecte, du traitement, de la valorisation et de la mise à disposition de l’information. Les innovations technologiques ont généré une énorme augmentation dans la quantité d’information. Cette information est elle-même diffusée via une grande diversité de types de sources et de formats (numériques). Les possibilités de collecter, de (ré)utiliser et de diffuser cette information (contenus) se sont de ce fait également multipliées. Il est indispensable de recourir à des professionnels de l’information capables de collecter des contenus spécifiques et de les diffuser. La curation de contenus apparaît donc par définition comme le domaine du professionnel de l’information, mais il reçoit la compagnie de professionnels provenant d’autres domaines de spécialisation, parmi lesquels les spécialistes du marketing. Cet article décrit le concept de curation de contenus et présente les défis que ce phénomène nouveau offre au professionnel de l’information.
Information et communication des services complémentaires, mais des métiers différents
Nathalie BOONEN, Documentaliste, Groupe CESI
A l’heure de la révolution numérique, on ne peut plus informer sans communiquer. Au sein de notre réseau – le RIST – et de façon générale dans notre métier de documentaliste, nous avons pu poser le constat suivant : de plus en plus de professionnels de l’information sont poussés vers le service de communication, alors qu’ils ne disposent pas forcément des compétences pour la réalisation de missions propres à ce département.Communiquer est un métier ! Informer l’est aussi ! D’autant plus qu’il faut savoir le faire en jonglant avec les outils technologiques d’information et de communication. En quoi les départements documentation et communication sont-ils complémentaires ? Et qu’est-ce qui les différencient ? Une entreprise a-t-elle intérêt à utiliser les deux types d’expertises ou à privilégier un service plutôt qu’un autre ?Dans ce monde, où YouTube tend à détrôner les ouvrages de références, ces interrogations sont utiles à la compréhension de la situation actuelle dans notre profession. Chacun y puisera ses éléments de réflexion, voire peut-être sa solution.
Bibliothèques et ebooks le prêt numérique est désormais légal
Séverine DUSOLLIER, Professeur à Sciences Po Paris – École de droit
Dans son arrêt du 10 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne constate qu’il n’existe aucun motif décisif permettant d’exclure du champ d’application de la Directive 2006/115/CE (relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle) le prêt de copies numériques et d’objets intangibles. Une telle conclusion est, par ailleurs, corroborée par l’objectif poursuivi par la directive, à savoir que le droit d’auteur doit s’adapter aux réalités économiques nouvelles.
L’auteur resitue le contexte de cette décision, entre offre d’ebooks dans les bibliothèques et opposition des éditeurs au prêt numérique. La position de la Cour sur le prêt numérique est explicitée, ainsi que la mise en exergue de la bibliothèque comme acteur indispensable de l’accès au livre.
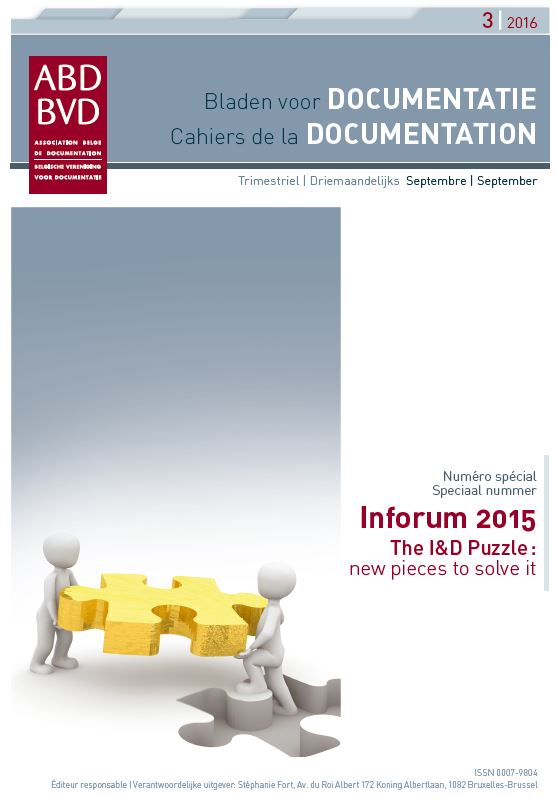 Éditorial
Éditorial
Quinze mois déjà se sont écoulés depuis notre Inforum 2015, intitulé The I&D Puzzle: new pieces to solve it. Mieux vaut tard que jamais ! Après deux numéros spéciaux très denses (2015/3 L’audiovisuel sous les projecteurs et 2016/2 Année européenne du patrimoine industriel et technique), vous trouverez, dans ce nouveau numéro spécial des Cahiers de la Documentation, les articles rédigés par quatre de nos cinq orateurs. Garante du multilinguisme de l’ABD-BVD, l’équipe des Cahiers vous propose ainsi quatre articles, deux en néerlandais, un en français, et un en anglais, afin de conserver une trace écrite de tout ce que vous aurez pu découvrir et apprendre lors de cette journée du 4 juin 2015.
Le numéro spécial Inforum 2016 In information we trust!!! paraîtra quant à lui dans la première moitié de l’année 2017. Nous vous rappelons que vous pouvez à tout moment consulter et télécharger gratuitement les présentations de nos différents orateurs depuis 1996, via l’onglet «Inforum» sur notre site web. Vous étiez plus de 150 participants pour cette édition 2015 de l’Inforum, nous tenons à vous en remercier une fois encore. En espérant vous voir au moins aussi nombreux pour l’édition 2017 !
N’oublions pas non plus la tenue d’un Doc’Moment spécial, le 29 septembre après-midi, au Mundaneum, le « Google de papier », à Mons. Une visite guidée des lieux sera complétée par un exposé sur la visualisation des données. En novembre, nous organisons un autre atelier avec les sponsors de l’Inforum 2016, Ebsco et LM. Bonne rentrée à tous, et au plaisir de vous revoir lors de l’un de nos évènements !
Catherine Gérard
Digital preservation strategy and preservation planning at the British Library
Michael DAY, Digital Preservation Manager, The British Library
La British Library est dépositaire de collections de contenus numériques, diverses et en rapide expansion, tant numérisées que sous forme numérique d’origine. Elle a récemment publié un document à vision stratégique, intitulé « Living Knowledge » (connaissance vivante), confirmant que cette mission de conservation est la mission première et fondamentale de la Bibliothèque, celle sur laquelle reposent toutes les autres missions. Cette stratégie a également spécifiquement mis en évidence la nécessité pour la Bibliothèque de prendre en considération les défis posés par la conservation à long terme des contenus numériques, en particulier les contenus numériques d’origine reçus au travers du dépôt légal, qui inclut la capture périodique (au minimum annuelle) de l’ensemble du domaine web du Royaume-Uni. Le présent article explore quelques-unes des activités entreprises par l’équipe de la Bibliothèque chargée de la préservation digitale, dans sa recherche pour implémenter une capacité de planification en vue de cette préservation, en mettant l’accent sur la saisie initiale des exigences de préservation au travers du profilage des collections et sur un programme d’évaluation des formats de fichiers.
Information is not for storage, information is for action
Het wijzigende karakter van informatiebeheer in een web 2.0-kenniswerkomgeving
Filip CALLEWAERT, Verantwoordelijke Informatiebeheer, Havenbedrijf Antwerpen
Dans cet article, Filip Callewaert décrit comment et pourquoi son équipe et lui ont réinventé leur pratique de la gestion de l’information, en fonction des nouveaux besoins du 21e siècle : « information is not for storage, information is for action ». Ceci est lié à un mode de gestion « lean », allégé, au plus juste. Le but est de créer un travail de connaissance à valeur ajoutée. Le travail basé sur les technologies du web, et surtout sur sa dimension 2.0 sociale et collaborative, permet maintenant de faciliter le vrai travail de la connaissance en tant que processus, là où dans le passé nous nous focalisions uniquement sur le produit du travail de la connaissance : les documents et les fichiers finalisés. Le Web 2.0 renverse les barrières fermées du travail de la connaissance, car il attribue une place fondamentale à la conversation, considérée comme une technique de résolution de problèmes, et qui sera dès lors conservée. Cependant, le logiciel n’est jamais la solution ; les solutions sont toujours « conçues » en interaction avec le contexte : au fond, elles résident dans la vision holistique sur les processus, outils et personnes, avec leurs compétences, habitudes et cultures.
Informatie opsporen, uitgaande van een beeld
Paul NIEUWENHUYSEN, Hoogleraar, Universiteitsbibliotheek, Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Cette contribution fournit un bref aperçu d’une recherche en cours et de l’évaluation d’une méthode de recherche d’information où l’utilisateur entame sa recherche au départ d’une image. Il s’agit d’une technique relativement nouvelle où la requête ne se compose pas de mots, mais d’une image codée dans un fichier informatique. Différents tests sont effectués. Les résultats démontrent que la recherche sur base d’image est devenue une méthode complémentaire puissante, permettant de rencontrer des besoins en information difficiles à satisfaire à l’aide d’autres méthodes plus classiques. Différents types d’application sont décrits.
Le chemin d’évolution du métier de la veille
Résultats d’une enquête menée lors de la journée Inforum, à Bruxelles, le 4 juin 2015
Béatrice FOENIX-RIOU, Fondatrice de BFR Consultants, auteure de l’ouvrage « Recherche éveillée sur Internet : mode d’emploi » et du site Recherche éveillée
Dans le cadre de la journée annuelle Inforum 2015, organisée par l’Association Belge de Documentation (ABD-BVD) sur le thème The I&D Puzzle: new pieces to solve it, nous avons été sollicitée pour intervenir sur le sujet de « La veille sur les réseaux sociaux : méthodes, outils et astuces ». Pour compléter notre intervention, nous avons mis en place un dispositif de veille éphémère1, permettant de capter d’autres pratiques que la nôtre, dans un esprit d’exploration. Ce dispositif comprenait en particulier un questionnaire, qui interrogeait les participants à la journée sur leurs usages des réseaux sociaux et leurs pratiques de veille. Cet article propose les résultats de l’analyse quantitative et qualitative des réponses. En particulier, nous analysons l’évolution du métier de la Veille par l’usage d’une boussole dynamique.
NUMÉRO SPÉCIAL
Année européenne du patrimoine industriel et technique
 Éditorial
Éditorial
Il me montre tour à tour toutes les cheminées, les tuyaux et les halls d’usine. Il en parle souvent à l’imparfait. Dans l’eau de la Sambre ne coule plus aucun avenir pour le travailleur. « C’est fini. C’est foutu. «
« Bof ! De vieilles machines et des usines abandonnées… »
Telle est sans doute une des réactions couramment observées lorsqu’on évoque le concept d’archéologie industrielle.
La période industrielle qui, à partir de la fin du XVIIIe siècle, a caractérisé une grande partie de l’Europe occidentale, et la Belgique tout particulièrement, a entraîné de profonds changements et a fortement marqué nos organisations, qu’elles soient sociale, économique, géographique, historique ; certaines traces sont même inscrites durablement dans notre paysage !
Pourtant, avec la désindustrialisation de nos régions, la tendance est de faire le nettoyage, d’éliminer le disgracieux et de ‘gommer’ les marques d’une période parfois peu glorieuse et à laquelle sont souvent associés misère, souffrance humaine et drames sociaux. Bien que certaines de ces traces aient déjà pu être sauvegardées, la majeure partie des témoins du passé reste en voie de disparition. Heureusement, de nombreuses initiatives voient le jour en vue de préserver ces traces trop facilement effacées.
À l’occasion de l’Année européenne du patrimoine industriel et technique, qui vient de se clôturer, il nous a paru à la fois intéressant et important de marquer cet événement en lui consacrant un numéro spécial de nos Cahiers de la Documentation. Non pas dans le but de vous montrer « de vieilles machines et des usines abandonnées », mais bien de dévoiler la richesse du patrimoine documentaire qui nous a été légué.
En effet, à tous les stades de sa dynamique, l’industrialisation a généré quantités de documents, d’informations et d’archives… Ces « traces » sont multiples, revêtent de très nombreuses formes et requièrent d’être elles aussi préservées. En d’autres termes, toutes les étapes de la chaîne documentaire (sélection/collecte, traitement, diffusion) sont concernées !
L’archéologie industrielle se proclamant « méthode interdisciplinaire », nous nous devions de saisir l’occasion de mettre en avant le rôle que nous, spécialistes de la gestion de l’information, pouvons jouer pour collecter, préserver, dynamiser et rendre accessibles toutes ces traces de notre passé.
Au travers de l’éventail d’articles que nous vous proposons dans ce numéro, nous avons voulu initier un tour d’horizon, loin d’être exhaustif, d’initiatives anciennes et récentes, d’ici et d’ailleurs, qui illustrent l’omniprésence du patrimoine industriel « documentaire ». Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à découvrir ces différentes facettes de notre patrimoine industriel que nous en avons eu à les rassembler ici pour vous.
« C’est peut-être que l’homme est plus que jamais anxieux de savoir où il va, qu’il ne pourra le deviner qu’en établissant où il est aujourd’hui et en cherchant à comprendre d’où il vient. »
Le thème de ces Cahiers de la Documentation ne pouvait être traité sans une abondante et significative iconographie. Pour accorder un maximum d’espace aux nombreux articles qui composent ce numéro, nous avons cependant été obligés de réduire la taille des illustrations qui les accompagnent. Afin de compenser cet inconvénient et avec l’accord des auteurs et des ayants-droit, nous avons prévu d’héberger ces images dans une galerie photo disponible à l’adresse ci-dessous.
Nous espérons que cette solution vous permettra de visionner ces images de manière confortable, dans un format et des couleurs que l’édition papier ne nous permet pas.
En deux siècles, nos sociétés ont subi des modifications fondamentales. […] L’évolution industrielle a été l’origine d’un » autre » visage pour nos villes et nos campagnes. Visage qui témoigne de la croissance récente de notre société, qui symbolise deux siècles de développement industriel, de travail et de créativité.
Christopher BOON, Dominique J.B. VANPÉE
Matériel iconographique
Editorial
Christopher BOON, Dominique J.B. VANPÉE
Guest Editorial
Patrick MARTIN
Archives industrielles. Où se nichent-elles ?
Guido VANDERHULST, Expert en patrimoine social, portuaire et industriel
Préserver un élément du patrimoine industriel requiert d’abord de recueillir un maximum d’informations à son sujet afin d’en retracer l’histoire. L’auteur propose de faire un bref tour d’horizon de la multiplicité des sources d’information : consultation des institutions officielles et des administrations avec lesquelles l’entreprise était en contact, localisation de plans cadastraux, identification de l’existence d’archives d’entreprise ou de correspondance, visite sur le terrain, recueil de témoignages, enquête de voisinage et prises de vues constituent quelques-unes des démarches à entreprendre pour une analyse préalable.
Les archives des houillères et le Centre Liégeois d’Archives et de Documentation de l’Industrie Charbonnière (CLADIC) de Blegny-Mine
Bruno GUIDOLIN, Bibliothécaire-documentaliste, Blegny-Mine asbl – Province de Liège – CLADIC
Après avoir dressé brièvement un panorama des institutions documentaires et archivistiques actives dans le domaine charbonnier en région liégeoise, cet article se penche sur le contexte de la création du CLADIC, centre de documentation et d’archives de Blegny-Mine, et présente les ressources que cet établissement met à disposition de ses usagers. Il envisage par la suite l’étude du cas des archives de la Société anonyme des charbonnages d’Argenteau en tâchant de démontrer, par des exemples concrets, l’intérêt, l’interdépendance et la continuité qu’elles incarnent pour un site tel que celui de Blegny-Mine, inscrit depuis 2012, avec trois autres sites miniers, sur la Liste du patrimoine mondial de l’humanité.
Sur les traces des ouvriers mineurs : carnets, livrets et cartons-comptes
Camille VANBERSY, Responsable scientifique, SAICOM (Sauvegarde des Archives industrielles du Couchant de Mons)
Le SAICOM (Sauvegarde des Archives industrielles du Couchant de Mons), centre d’archives privées actif dans la sauvegarde des archives industrielles et minières du bassin du Couchant de Mons (région de Mons-Borinage), mais également du Centre et de Charleroi, possède une vaste collection d’archives utiles à la compréhension de l’histoire de ces « terres de charbon ». Parmi ces archives, les livrets et carnets ouvriers ainsi que des cartons-comptes occupent une place importante en permettant de retracer les carrières des ouvriers qui ont façonné ce pays. Après avoir retracé la genèse et l’histoire des ces différents types de sources, l’auteur présente l’utilité et les applications de ceux-ci pour la recherche en histoire tant économique que sociale ou généalogique.
Een leven lang documenteren. Max Broes en de triage-lavoir van Péronnes-lez-Binche
Rob BELEMANS, Stafmedewerker immaterieel erfgoed, Faro – Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
Plus de 60.000 pages de documentation sur un seul sujet, richement illustré, renvoyant à des milliers des sources imprimées dans six langues : c’est l’impressionnant résultat du travail bénévole accompli par une seule personne pendant des décennies. Max Broes a peaufiné pendant plus de 50 ans son « univers de moulins » : un ensemble de plus de 300 classeurs débordant d’informations sur des sujets en rapport avec les milliers de sortes de « moulins » pré-industriels, leur mode d’utilisation et les résultats de leur production. La notion de « moulin » doit être ici interprétée dans son sens le plus large : tout transformateur d’énergie qui, par le mouvement et propulsé par le vent, l’eau, la force humaine ou animale, accomplit un processus de transition, constitue pour Broes un moulin. Toute personne souhaitant consulter le résultat étonnant de son travail de titan peut dorénavant s’adresser au Museum voor de Oudere Technieken (MOT) à Grimbergen.
La carte postale, un support iconographique essentiel pour les historiens des techniques de la « belle époque ». À manipuler toutefois avec précaution
Pierre-Christian GUIOLLARD, Docteur en Histoire des Sciences et des Techniques – Chercheur associé au CRESAT, Université de Mulhouse Colmar
Aux mots carte postale sont généralement associés les mots vacances, voyages, loisirs ; peu nombreuses sont les personnes qui feraient une relation avec les mots mine, usine, travail. Et pourtant, au début du XXe siècle, les sites industriels, les ouvriers, les mineurs furent très souvent choisis pour illustrer les cartes postales. Un siècle plus tard, ces documents ont une valeur d’archive iconographique très prisée par les historiens de l’histoire industrielle du début du XXe siècle. Dans cet article, nous essaierons de comprendre l’engouement de nos aïeux pour la carte postale, son extraordinaire succès et sa popularité acquis entre 1900 et 1920, faisant de ce bristol illustré le premier « réseau social » des Temps modernes. Nous verrons comment ces messages familiaux ou amicaux, griffonnés à la hâte ou soigneusement rédigés, peuvent être interprétés selon différents niveaux de lecture. Nous découvrirons la richesse insoupçonnée que représentent l’interaction entre l’image d’un site industriel figurant sur la carte, le commentaire de son expéditeur et parfois, la mise en relation avec l’actualité de la Belle Époque.
Interviews with contemporary witnesses to document collections of historical objects. Guidelines for the staff of collection institutions and museums
Tanya KARRER, Head of constoria Karrer – communication agency for history and stories
Les collections et objets historiques appartenant au patrimoine technique et industriel, de par leur histoire relativement récente, sont particulièrement adaptés pour être documentés à l’aide d’interviews de témoins contemporains (Contemporary Witnesses’ Interviews). Le présent guide décrit, étape par étape, comment préparer, conduire et traiter une interview en vue de documenter des objets ou des collections complètes. En complément, l’auteur passe en revue la situation juridique et quelques exemples liés à sa pratique. Grâce aux interviews de témoins contemporains, les gestionnaires de musées et de collections peuvent constituer une documentation de grande valeur autour des objets et des collections, qui peut être caractérisée par les sept critères suivants : information accessible, certitude juridique, connaissance des fonctions et de la matérialité d’un objet, base pour la recherche primaire, justification du projet lié à la collection, détermination de critères de valeur et de sélection, création d’une identité et de nouvelles perspectives. En cela, l’attractivité et la valeur des objets et de la collection dans sa globalité se trouve augmentée.
Le don de mémoire, une collecte participative. L’exemple de la mémoire industrielle
Julie CROQUET, Responsable de la Maison de la Mémoire, Écomusée PAYSALP
L’écomusée PAYSALP, association située dans les Alpes françaises, a développé avec l’appui d’une vingtaine de communes une démarche de collecte de mémoire permettant à chacun de participer à la connaissance de son espace de vie. Ce « Don de mémoire » (oral et documentaire) permet la participation des habitants sous différentes formes : collecteurs, contributeurs, informateurs, associations, témoins, élus, enfants… Les documents collectés sont numérisés et restitués à tous sur la base en ligne « Mémoire Alpine » et viennent enrichir des projets culturels de l’écomusée et du territoire. Parmi les multiples thématiques abordées, la mémoire industrielle a fait l’objet d’une collecte particulière en 2015 ; patrimoine si proche mais déjà en danger, particulier dans son mode de collecte et de valorisation, sa connaissance participe avec toute sa légitimité à l’appropriation de leur territoire par les habitants.
Les sons du travail. Une mémoire oubliée à préserver Projet européen « Work with sounds »
Pascal MAJÉRUS, Conservateur du Musée de La Fonderie
Gaëlle COURTOIS, Responsable son du projet Work With Sounds à La Fonderie
Pendant deux ans, La Fonderie, musée bruxellois des industries et du travail, a collaboré à un vaste projet européen de collecte de sons du travail, « Work With Sounds ». Préserver des bruits souvent considérés comme des nuisances peut paraître paradoxal. Pourtant, à l’instar des équipements industriels qui disparaissent, ils font partie du patrimoine historique et social. La collecte du passé, une fonction muséale essentielle, trouve ici une actualisation particulière. Ces sons préservés, étudiés et documentés, sont disponibles dans une base de données accessible en ligne.
De virtuele collectie van MIWE/SIWE in Erfgoedplus
Jan DE COCK, Erfgoeddepotconsulent bij de Provincie Vlaams-Brabant
Dominique J.B. VANPÉE, Lid van het Publicatiecomité van de Bladen voor Documentatie
La collection MIWE (Museum Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed) de l’association SIWE (Steunpunt voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed), en liquidation, est à l’heure actuelle virtuelle, car elle possède de nouveaux propriétaires et, à d’autres endroits, est venue accroître les collections de patrimoine industriel, technique et scientifique. Mais elle peut être consultée dans son entièreté, de manière digitale, sous forme de photos et de descriptions des objets, sur le site web du SIWE, sur Erfgoedplus et sur Europeana.
Preserving a major oilfield on the Norwegian Continental Shelf – Statfjord
Finn H. SANDBERG, Manager of the Documentation and Research unit, Norwegian Petroleum Museum
Kristin Ø. GJERDE, 1st. Curator and senior researcher, Norwegian Petroleum Museum
Depuis 1971, des hydrocarbures ont été extraits de profondément sous le plateau continental norvégien. Afin de recueillir et de traiter cet « or noir », de gigantesques structures ont été construites, transportées et installées sur le fond marin dans des profondeurs variant entre 60 et 1.000 mètres. En mars 2000, quand des plans de démantèlement de ces plates-formes pétrolières ont été introduits, la Direction du patrimoine culturel norvégienne a adressé une lettre à différents musées invitant à manifester leur intérêt pour ces activités « offshore ». Elle lançait ainsi un défi : « Ce qui ne peut être préservé doit être documenté ». Cet article décrit comment le Musée norvégien du pétrole (NPM) a relevé le défi par différents projets documentaires relatifs à ce patrimoine industriel. « Industrial Heritage Statfjord » est le troisième en ordre de cinq grands projets documentaires actuels. Le champ pétrolifère de Statfjord est encore toujours un des plus grands champs en production du plateau continental, et est plus spécifiquement examiné dans cet article. L’article explique également l’importante collaboration entre le NPM, les Archives nationales et la Bibliothèque nationale de Norvège.
Les missions photographiques du Musée de la Photographie à Charleroi. Comment anticiper l’histoire
Julien LIBERT, Collaborateur Scientifique, Musée de la Photographie à Charleroi
Depuis sa création, le Musée de la Photographie collecte des photographies industrielles de la région et du monde. Celles-ci sont des sources multiples pour l’Histoire. En effet, entre l’aspect sériel et l’aspect social, les photographies d’industrie peuvent être formellement différentes et apporter un éclairage particulièrement intéressant, même si l’industrie n’est pas le sujet principal. Dans cette perspective, les cinq missions photographiques du Musée de la Photographie anticipent l’Histoire en fournissant des sources historiques importantes pour documenter la mutation d’une ville soumise à la déliquescence industrielle depuis des décennies.
De websites van VVIA & SIWE archiveren in het wettelijk depot? Omzien naar het heden…
Dominique J.B. VANPÉE, Lid van het Publicatiecomité van de Bladen voor Documentatie
Prenant comme exemples les sites web de deux associations flamandes se consacrant au patrimoine industriel, l’auteur propose une réflexion sur l’importance, dans un monde fluide, virtuel et digital, du dépôt légal pour les sites web auprès de la Bibliothèque royale de Belgique.
Enjeux pratiques et éthiques de la conservation des œuvres à composantes technologiques
Emanuel LORRAIN, Chercheur/consultant en préservation du patrimoine audiovisuel et numérique, PACKED vzw – Expertisecentrum Digitaal Erfgoed
L’obsolescence programmée qui conduit à l’indisponibilité des pièces de rechange et des services de réparation pour des technologies dépréciées représente un défi de taille pour les collections d’art contemporain. La cadence à laquelle se succèdent les différents modèles, formats et standards met en danger la visibilité à long terme d’un certain nombre d’œuvres dont les équipements nécessaires vieillissent et deviennent défectueux. La grande fragilité de ces créations et les versions multiples qu’elles connaissent au cours de leur vie bousculent les pratiques traditionnelles du musée. Cela l’oblige à se transformer et à mettre en place des approches spécifiques pour répondre aux enjeux à la fois pratiques et éthiques qui lui sont posés.
Ephemera. A window on the quotidian
Diane DEBLOIS, Editor, publications of The Ephemera Society of America Inc.
Cet article décrit le concept d’éphémères1 en tant qu’objets de collection – leur variété de formats et d’interprétations. Quelques-uns de leurs défenseurs de la première heure sont présentés, ainsi que quelques collections institutionnelles et privées importantes. Les problèmes concernant le catalogage et la conservation de tels objets sur papier sont abordés. De manière générale, l’article vise à donner un sens à l’importance culturelle acquise par les collections et les expositions d’éphémères.
Sur les traces de l’éphémère Centre d’Archéologie Industrielle…
Christopher BOON, Bibliothécaire-documentaliste, « simple curieux » d’archéologie industrielle
À la lumière de l’examen des quelques « traces » laissées dans différents écrits, l’article tente de retracer les facteurs ayant conduit à la création du Centre d’Archéologie Industrielle, au sein de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR), à la célérité de son développement et à sa disparition tout aussi rapide de la scène scientifique belge.
Het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis (CBG) aan de Universiteit Antwerpen (UA) en industrieel erfgoed
Dominique J.B. VANPÉE, Lid van het Publicatiecomité van de Bladen voor Documentatie
Le Centre d’histoire de l’entreprise (Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis – CBG) lié à l’Université d’Anvers (UA) avait déterminé dans ses objectifs de conserver des pans du patrimoine industriel par ses activités autour des archives d’entreprises, un centre de documentation et l’étude de reliquats industriels. Ce fonctionnement depuis 1971 à nos jours est expliqué dans le présent article.
Le centre de documentation de La Fonderie. Sa naissance, son développement, sa situation aujourd’hui
Fabienne DE SADELEER, Bibliothécaire, La Fonderie
En 1986, l’asbl La Fonderie. Histoire Ouvrière et Populaire. Musée d’Histoire sociale et Industrielle de la Région bruxelloise a présenté, dans le bâtiment des douanes de Tour et Taxis, une exposition : Bruxelles, un canal, des usines et des hommes. Elle montrait les thèmes qu’elle allait développer par la suite : l’histoire du canal, colonne vertébrale de l’industrialisation de Bruxelles, les hommes et les femmes au travail et leurs organisations ouvrières, leurs lieux et modes de vie. Les documents utilisés pour la préparation, ainsi que des fonds reçus permettent de créer un centre de documentation. Celui-ci, modeste au départ, a grandi au fur et à mesure de l’expansion des recherches de la Fonderie. L’auteur vous en propose l’histoire de 1983 à aujourd’hui.
MIAT FACTory. De evolutie van bibliotheek naar kenniscentrum
Parsival DELRUE en Brigitte DE MEYER, Kenniscentrum MIAT FACTory en museumbibliotheek – MIAT
Le MIAT est le Musée de l’Industrie, du Travail et du Textile, situé à Gand. Cet article retrace l’histoire de la naissance et du développement de la bibliothèque muséale du MIAT. MIAT FACTory, le centre de connaissances du MIAT, est né en 2014. La bibliothèque constitue la base d’opérations du centre de connaissances. Elle reçoit ainsi à nouveau une place visible au sein du musée et dépasse le fonctionnement traditionnel d’une bibliothèque. MIAT FACTory est une projet en évolution. Cette contribution dresse un état de la question et met en avant les ambitions futures du projet.
La reconversion d’anciens bâtiments industriels et commerciaux aux fins d’hébergement de bibliothèques, de centres d’archives ou de documentation. Quelques réalisations en Wallonie et à Bruxelles
Christopher BOON, Bibliothécaire-documentaliste, Administrateur Association Belge de Documentation (ABD-BVD asbl)
D’anciens bâtiments à vocation industrielle peuvent être préservés dela destruction lorsqu’il est possible de pourvoir à leur réutilisation. L’article donne un aperçu de quelques réalisations de reconversion, en Wallonie et à Bruxelles, où des bibliothèques et des centres d’archives ou de documentation ont pu trouver un nouvel hébergement dans des locaux réaménagés.
De herbestemming van oude industriële gebouwen als nieuw onderkomen voor archieven, bibliotheken en documentatiecentra in Vlaanderen en de Brusselse regio
Patrick VIAENE, Docent Universiteit Antwerpen (Faculteit Ontwerpwetenschappen, Monumenten- en Landschapszorg) en Hogeschool Gent (School of Arts), Bestuurder van TICCIH (The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage)
Les usines, les ateliers et les entrepôts constituent une partie du patrimoine industriel. Ce patrimoine n’est pas uniquement de grande importance du fait de ses valeurs historique, sociale, technologique ou architecturale. Ces bâtiments peuvent dans la plupart des cas – du fait de leur implantation favorable dans un environnement bâti, de leurs caractéristiques en matière d’espace et de construction, etc. – être relativement facilement réutilisés dans un large éventail de nouvelles affectations, en matière de logement, de travail, de sport ou de culture. Cette contribution examinera un des aspects de cette pratique, en l’occurrence la reconversion du patrimoine industriel au profit de bibliothèques et de centres d’archives ou de documentation. Les réalisations concrètes sont, dans ce domaine, très variées en Flandre et à Bruxelles, conséquence tant de la thématique, de la taille des collections bibliographiques et archivistiques, que de la configuration et de l’ampleur des bâtiments industriels réaffectés ou des possibilités financières. Une caractéristique commune est néanmoins la réutilisation durable de la part des différents acteurs à l’origine des initiatives, en particulier de la part des autorités.
Au pied des hauts-fourneaux, un Learning Centre. Reconversion du noyau de l’activité sidérurgique au cœur de la vie universitaire
Marie-Pierre PAUSCH, Responsable du service des bibliothèques, Université du Luxembourg – Campus Limpertsberg
Julie WILLEMS, Responsable des services aux usagers, Université du Luxembourg – Campus Belval
Au début des années 2000, la reconversion du site de l’usine sidérurgique d’Esch-Belval, au Grand-Duché de Luxembourg, est entamée pour devenir le siège de l’Université du Luxembourg alors dispersée sur plusieurs campus. Cet article présente :
– la réaffectation d’un ancien bâtiment de l’usine, la Möllerei, en Learning Centre dont l’ouverture est prévue pour 2018;
– le BiblioLab, espace destiné à servir le public universitaire présent sur le site de Belval avant 2018 et conçu comme un laboratoire permettant de tester les concepts d’aménagements et de services en vue du Learning Centre.
De kennisbank van ETWIE. Een digitale bron van informatie over industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed in Vlaanderen en Brussel
Tijl VEREENOOGHE en Joeri JANUARIUS, Coördinatoren, ETWIE vzw
Depuis 2013, l’asbl ETWIE développe une base de connaissances numérique comprenant de l’information sur le patrimoine technique, scientifique et industriel en Flandre. Une partie importante de cette plate-forme réside dans la très large bibliographie, tenue à jour en collaboration avec le MIAT à Gand. Par le partage et l’établissement de liens entre connaissances, ce nouvel instrument de travail présente de nombreuses possibilités.
De Who is Who van SIWE. Een actorenlijst van het Vlaamse industrieel en wetenschappelijk erfgoed
Dominique J.B. VANPÉE, Lid van het Publicatiecomité van de Bladen voor Documentatie
Le Who is Who du Steunpunt voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE) était en quelque sorte un précurseur partiel de la partie “acteurs” de l’actuelle banque de connaissances de l’Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed (ETWIE).
Unieke bibliografie industriële archeologie & industrieel erfgoed in België. Een terugblik op een bibliografisch werkinstrument
Dominique J.B. VANPÉE, Lid van het Publicatiecomité van de Bladen voor Documentatie
À la lumière de courriers électroniques échangés avec les personnes concernées à l’époque et d’éléments retrouvés sur Internet, l’auteur jette un regard rétrospectif sur la Bibliographie de l’archéologie industrielle et du patrimoine industriel en Belgique.
Les ressources de l’histoire industrielle au service de la dépollution des sols wallons
Arnaud PÉTERS, Chercheur, Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques (ULg)
Le Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques (CHST) est un centre de recherches et de ressources documentaires créé en 1987 à l’Université de Liège par le Prof. Robert Halleux. Comme centre de ressources documentaires, le CHST a accumulé, dans le cadre d’opérations de préservation, d’importantes collections dans le domaine de l’histoire industrielle. La bibliothèque du CHST constitue aujourd’hui une référence pour les recherches en histoire des entreprises, histoire des techniques, histoire économique et sociale et histoire de l’environnement. Dans le contexte de l’émergence d’un besoin d’information historique, ces collections ont également permis aux chercheurs du CHST (historiens, archéologues, géographes) de développer des méthodologies propres à l’étude historique de sites industriels désaffectés. Cette contribution les décrit en s’attardant sur les questions heuristiques. Elle éclaire l’exploitation de sources souvent méconnues dans le contexte particulier de la dépollution des sols.
Herbestemming van de historische collectie Agfa-Gevaert
Patrick VAN DEN NIEUWENHOF, Zelfstandig erfgoedconsulent
La collection historique d’Agfa-Gevaert reflète très bien les rôle et impact sociaux, économiques et techniques que la firme a eus aux niveaux local, régional, national et international. Appareils photos, emballages, archives, photos… de et sur la firme ont été collectés et gérés par d’anciens travailleurs. Ceci a abouti à une archive bien ordonnée et accessible. Agfa a décidé l’année passée de fermer et de vendre le site de leur conservation, le Varenthof à Mortsel. La province d’Anvers et le Musée de la Photographie anversois ont actuellement pris la responsabilité de procurer un nouvel hébergement à cette collection unique. Cet article fournit un compte-rendu des premières étapes entreprises.
À la recherche des Forges de Clabecq
Madeleine JACQUEMIN, Archiviste, PhD, chef de travaux aux Archives générales du Royaume (AGR)
Les Archives générales du Royaume conservent essentiellement des archives publiques, mais également des archives privées, dont des fonds d’archives d’entreprises. L’auteure de cet article, qui y travaille, porte deux casquettes professionnelles complémentaires, à savoir celle d’historienne et celle d’archiviste. Elle a, en effet, réalisé une thèse qui comprend à la fois l’inventoriage de 300 mètres linéaires d’archives de la société anonyme Forges de Clabecq, et la rédaction, à partir de toutes les sources disponibles, d’une monographie consacrée aux Forges de Clabecq, avec comme fil rouge le développement de l’entreprise de la fin du XVIIIe siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Cet article relate les différentes étapes de son travail, ses rencontres, ses découvertes, ses surprises et ses réalisations.
De (on)zin van het bewaren van curatele archieven en bedrijfsbibliotheken. De casus Boelwerf
Johan DAMBRUYNE, Rijksarchivaris en diensthoofd van het Rijksarchief Antwerpen-Beveren
Contrairement aux archives d’entreprise propres à la S.A. Boelwerf, les archives de la curatelle et la bibliothèque d’entreprise des anciens chantiers navals situés à Temse n’ont que peu ou pas attiré l’attention. La présente contribution souhaite mettre en lumière ces aspects moins connus du patrimoine de Boelwerf. L’exemple fourni à l’occasion de la faillite de Boelwerf permet d’exprimer quelques points de vue sur le (non-)sens de la conservation permanente, de l’intégration et de la valorisation des archives de curatelle et des bibliothèques spécialisées. L’article plaide pour l’adoption d’une attitude critique, pour l’application cohérente d’une macro- et d’une micro-sélection (fondée sur des critères objectifs), et pour la prise de mesures mûrement réfléchies, qui soient directement proportionnelles à la valeur intrinsèque – pertinence sociale et historique – et à la valeur complémentaire des fonds et des collections concernés.
Les archives Boël à La Louvière. Un salutaire concours de circonstances
Thierry DELPLANCQ, Archiviste de la Ville et du CPAS de La Louvière
La préservation des archives industrielles sur le territoire de l’entité louviéroise fait l’objet d’une attention particulière, en raison notamment d’un partenariat instauré entre plusieurs institutions scientifiques locales. Les Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière se sont impliquées dans ce programme et conservent en leurs locaux un fonds rassemblant des archives concernant plusieurs entreprises liées d’une manière ou d’une autre aux anciennes usines sidérurgiques Boël. Rythmée par un salutaire concours de circonstances et enrichie par des campagnes photographiques, la constitution progressive du fonds Boël a été rendue possible grâce à la proactivité du service d’archives ainsi qu’à l’implication essentielle de membres du personnel de l’usine.
Over collectie-inventarisatie en beheer Rupelstreek industrieel erfgoed. Van Colibri tot een episode uit het bedrijfsarchief Verstrepen door Booms missionaris Louis Verstrepen
Patrick VAN DEN NIEUWENHOF, Zelfstandig erfgoedconsulent
Le projet Collectie-Inventarisatie en Beheer Rupelstreek Industrieel erfgoed (Collecte, inventaire et gestion du patrimoine industriel de la région du Rupel), en abrégé Colibri, a été réalisé entre 2007 et 2009 sur demande de la Province d’Anvers. Le but était d’établir un état des lieux relatif aux collections patrimoniales de la région du Rupel (Rumst, Boom, Niel, Hemiksen, Schelle). Le présent article fournit un bref compte-rendu de cette étude, en consacrant une attention particulière aux archives de l’entreprise et de la famille Verstrepen (briqueterie).
Comment préserver la mémoire du patrimoine industriel et transmettre aux nouvelles générations la fierté des hommes qui y ont travaillé
Franck DEPAIFVE, Coordinateur général, MÉTA-MORPHOSIS asbl
L’association Méta-Morphosis a pour objet la sauvegarde de la mémoire des lieux et la préservation de la fierté des hommes par l’utilisation d’outils pluri-médias. Elle cherche à sensibiliser un public large à la question du patrimoine industriel et à dénicher toutes les petites histoires qui ont fait la grande Histoire de l’Industrie.
Sauvegarde du patrimoine industriel. Le spécialiste de l’I&D au service de la mémoire de l’industrie?
Christopher BOON, Documentaliste juridique, Administrateur Association Belge de Documentation (ABD-BVD)
Cet article examine l’aspect documentaire spécifique au patrimoine industriel, principalement sous l’angle de la quantité et de la variété de documents qui ont été produits, en relevant les enjeux et les défis auxquels ce patrimoine documentaire est confronté. Dans un second temps, il s’intéresse à la manière dont le professionnel de l’I&D (Information&Documentation / Infodoc) peut s’investir et apporter son savoir-faire dans ce domaine.
Documentatie en industrieel erfgoed. Uitgeleide
Dominique J.B. VANPÉE, Informatiedeskundige, bibliothecaris-documentalist geïnteresseerde in industrieel, wetenschappelijk en technisch erfgoed
Même si les concepts de « documentation »et d’ »archéologie industrielle » ou de « patrimoine industriels » ne constituent pas des évidences, il existe d’autres problèmes tels que la périodisation et les structures organisées propres au domaine. Sur base de références bibliographiques, l’article fournit un travail historiographique et aborde quelques aspects spécifiques parfois négligés ou très actuels de ce patrimoine.
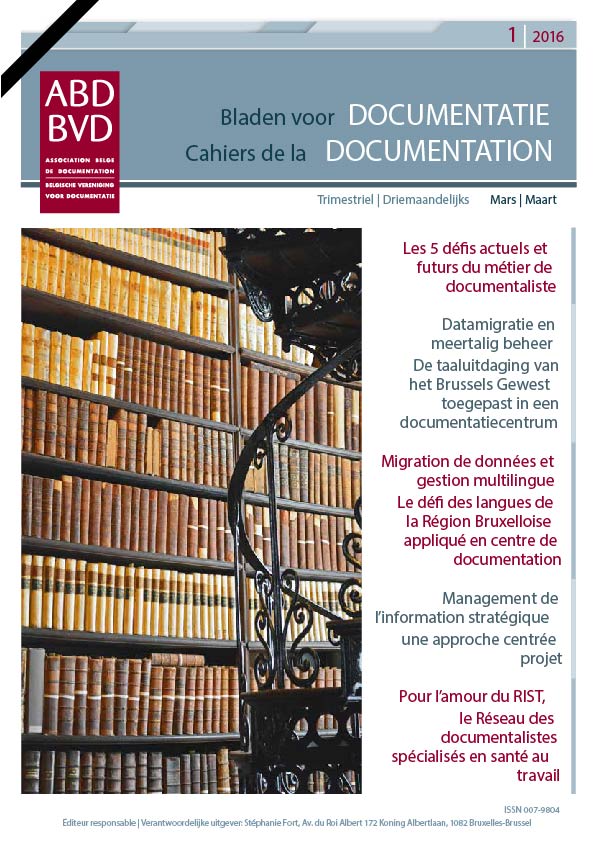 Éditorial
Éditorial
Le 19 février dernier, Umberto Eco, l’un de ces penseurs qui ont marqué notre temps, nous a quittés. Sémioticien, médiéviste, théoricien de la littérature, Umberto Eco était également pleinement engagé dans notre société.
Dans notre pays, c’est surtout en tant qu’écrivain qu’Umberto Eco est connu du grand public. Guillaume de Baskerville, l’un des personnages principaux du Nom de la rose, reste gravé dans la mémoire collective. Désireux de pénétrer au cœur d’une bibliothèque labyrinthique pour prendre connaissance d’un livre caché, le moine franciscain incarne non seulement la rationalité, mais également l’idée que la science doit être partagée plutôt que de rester enfermée dans les institutions dépositaires de la connaissance.
Au-delà de son œuvre littéraire, Umberto Eco a également montré que l’exercice de l’esprit critique demande parfois d’agir. Ainsi, il a mis fin à sa collaboration de longue date avec la maison d’édition Bompiani, dont il fut même codirecteur entre 1959 et 1975, lorsque celle-ci a été rachetée en 2015 par le groupe Mondadori, entre les mains de Berlusconi. Avec d’autres auteurs tels que Tahar Ben Jelloun, Sandro Veronesi et Hanif Kureishi, il rejoint l’éditrice Elisabetta Sgarbi, fondatrice de la nouvelle maison d’édition indépendante « La nave di Teseo », qu’il va également soutenir financièrement.
Le premier titre publié par « La nave di Teseo » est Pape Satàn Aleppe d’Umberto Eco. Cet ouvrage posthume se lit comme une dénonciation d’un monde où la pensée se trouve trop souvent réduite à l’adoption de slogans éphémères. Ce diagnostic sévère ne doit cependant pas occulter que la parution même de cet ouvrage, auprès d’une nouvelle maison d’édition, montre qu’il existe toujours des personnes prêtes à prendre l’initiative. Selon les dernières nouvelles, l’autorité de la concurrence de l’Italie invaliderait le rachat de Bompiani par Mondadori. Sgarbi peut déjà rêver de reprendre Bompiani. Une lueur d’espoir pointe à l’horizon. L’information indépendante existe toujours.
Sara DECOSTER
Les 5 défis actuels et futurs du métier de documentaliste
Jean-Philippe ACCART, Ecole hôtelière de Lausanne, directeur de bibliothèque
A l’occasion de la sortie de la quatrième édition du « Métier de documentaliste » aux Editions du Cercle de la Librairie (Paris), cet article aborde un certain nombre de points qui apparaissent comme essentiels au développement du métier de documentaliste et à son futur. Souvent décrié ou mal reconnu, ce métier, ouvert sur le public, l’accueil et les services, reste attaché à des valeurs d’échange et de partage du savoir. Il doit être encore mieux imbriqué dans la vie sociale et dans celle des organisations pour assurer son futur : dans la prise en main et la gestion de projets transversaux ; dans l’appropriation des réseaux sociaux ; avec la mise en place de services innovants. Dans cette optique, certaines notions étroitement intriquées sont donc importantes à considérer, parmi lesquelles la curation de données, la collaboration, la médiation, l’évaluation, et enfin la formation.
Migration de données et gestion multilingue : Le défi des langues de la Région Bruxelloise appliqué en centre de documentation
Dimitri PIRAUX, Spécialiste PMB – migration de données
Stephanie WOLBEEK, Responsable du service Brudoc, Centre de Documentation et de Coordination Sociales (CDCS-CMDC)
Retour d’expérience sur le projet mené par le service Brudoc du Centre de Documentation et de Coordination Sociales à propos de la fusion de deux SIGB monolingues en un SIGB bilingue, tous sous PMB. Quels sont les tenants et aboutissants d’un tel projet ? Comment le mettre en œuvre ? Avec qui ? Quels sont les bonnes pratiques à mettre en place avant, pendant et après la réalisation d’une migration de données ? Quel impact sur les tâches courantes ? Quelle plus-value sur les résultats de recherche, l’indexation, le catalogage, l’administration du SIGB. Cet article vous plonge au cœur des projets qui changent radicalement votre quotidien professionnel.
Management de l’information stratégique : Une approche centrée projet
Franck BULINGE, Maître de conférences, Docteur en sciences de l’information et de la communication, Université de Toulon
La méthode présentée dans cet article envisage la collecte et l’exploitation de l’information stratégique comme un processus dynamique englobant l’ensemble du projet de veille. L’objectif est de résoudre un problème informationnel dans le cadre d’un projet. Cette méthode prend en compte l’interdépendance des acteurs et les techniques de veille stratégique. La démarche « centrée projet » permet d’avoir une vision d’ensemble et de piloter la veille en temps réel. Elle introduit le principe d’un management du dispositif sociotechnique d’information au sein de l’organisation. Franck Bulinge était l’invité de notre Doc’Moment « Maîtriser l’information stratégique » du 4 mars 2015. Sa présentation est disponible sur notre site.
Pour l’amour du RIST : Le Réseau des documentalistes spécialisés en santé au travail
Nathalie BOONEN, Documentaliste en santé au travail, CESI asbl
L’information est désormais à la portée de tous. Le métier de documentaliste se diversifie, s’intensifie et oblige les professionnels à renforcer leurs compétences techniques et informatiques. La mise en réseau facilite la collaboration entre centres de documentation, permet l’existence d’une zone de partage, renforce les liens professionnels, donne naissance à de nouveaux projets, améliore la qualité de la veille documentaire, assure une bonne visibilité, favorise la mise en avant des compétences et du savoir-faire des documentalistes. Un exemple, celui des Services Externes de Prévention et de Protection au Travail, de documentalistes experts en santé au travail et d’un Réseau d’information spécialisé, le RIST…
 Éditorial
Éditorial
La littérature nous délivre parfois des enseignements précieux. Les romans qui mettent le livre au cœur de leur intrigue, notamment, ont un attrait particulier pour les membres de notre profession (Le Nom de la rose, d’Umberto Eco, en est l’un des exemples les plus célèbres).
Dans un autre roman paru il y a une dizaine d’années (Le Songe de Scipion), l’écrivain Iain Pears met au centre de son récit un manuscrit assez énigmatique écrit par un évêque de Vaison-la-Romaine au Ve siècle de notre ère, à la fin de l’Empire romain d’Occident. A des siècles de distance, deux érudits vont chercher à le déchiffrer : un poète du XIVe siècle qui le sauve de l’oubli durant la papauté en Avignon et la grande peste qui ravagea le Sud de l’Europe à cette époque, et un intellectuel français qui durant la seconde guerre mondiale tente à son tour d’en dégager le sens. L’une des clés de ce roman pourrait être le besoin irrépressible des hommes de sauvegarder le patrimoine culturel qui les entoure et de le transmettre aux générations suivantes. Un autre enseignement du livre montrerait que la compréhension des connaissances des anciens s’améliore au fil des siècles grâce au progrès des méthodes scientifiques.
Ces impressions sur le sens du roman sont un peu personnelles (les thèmes que développe Iain Pears concernent surtout la persistance de la barbarie et le doute que soulèvent les cas de conscience), mais s’appliquent assez bien aux sujets qu’on trouve de plus en plus couramment dans les pages des Cahiers de la Documentation : ils illustrent en effet une particularité déjà connue de notre profession, mais que le contraste entre les thèmes traités semble souligner : un mélange de tradition et de sauvegarde du passé dans la volonté de transmettre les connaissances, et un intérêt constant pour les technologies qui font progresser notre discipline.
Il n’y a aucune contradiction à cela, puisque l’objectif reste toujours le même : diffuser l’information, la culture, le savoir des autres.
C’est encore le cas pour les articles de ce premier numéro de l’année 2015 : le fascicule que vous allez lire nous fait remonter dans le temps puisqu’il retrace le parcours d’un bibliothécaire obstiné dans la sauvegarde d’un patrimoine culturel, et qu’il évoque par ailleurs le rôle des archives des villes de Gand au XIXe siècle et de Louvain dans la première moitié du XXe siècle. Mais il nous projette aussi dans le présent avec la présentation de ces logiciels désormais bien connus qui permettent à tous les chercheurs de se composer une bibliographie comme notre bibliothécaire passionné n’aurait jamais osé l’imaginer, et dans l’avenir en nous dévoilant à quoi ressembleront (ressemblent déjà dans certains lieux) nos bibliothèques et les services que les bibliothécaires prendront rapidement l’habitude d’y rendre. Ces lieux d’étude élargissent leur domaine pour donner à leurs utilisateurs les moyens les plus actuels de collecte de l’information. Comme souvent, on oscille ainsi entre des habitudes anciennes et des pratiques résolument modernes qui dans l’un et l’autre cas démontrent l’intérêt (et font le charme) de notre métier.
Philippe Mottet
Transition d’une bibliothèque vers un « learning centre »
Julien VAN BORM, Bibliothécaire en chef honoraire, Université d’Anvers
Toutes les bibliothèques doivent s’adapter aux réalités nouvelles: l’information électronique disponible 24/7 et un environnement plus varié et plus exigeant. La transformation en « learning centre » est une réponse aux nouveaux défis, mais certes pas la seule. L´article donne un aperçu des éléments qui créent un « learning centre »: services élargis, efficaces et réactifs, un lieu physique mettant davantage l’accent sur les clients que sur la collection et une intégration réelle dans le processus de l’enseignement et de la recherche (pour les institutions à la fois de recherche et d’éducation). Des exemples de création et d’opération de « learning centres » dans des pays voisins ainsi qu’un inventaire, loin d’être complet, des premières réalisations en Belgique indiquent que les « learning centres » sont devenus un atout pour le renouveau de nos bibliothèques scientifiques, qui doivent justifier leur maintien par la création d’une plus-value pour la société.
André Canonne : un bibliologue oublié ?
Benoît COLLET, Bachelier en bibliothéconomie et documentation, Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux)
André Canonne (1937-1990), ancien directeur du Centre de Lecture Publique de la Communauté Française, était un bibliothécaire engagé. Défenseur de son métier mais aussi défenseur de la sauvegarde du patrimoine documentaire et notamment à celui du Mundaneum. Le combat qu’il a mené fut de longue haleine et il a malheureusement été oublié. André Canonne était aussi un scientifique des bibliothèques, un bibliologue. Il avait pour projet une vaste encyclopédie couvrant tous les domaines liés à la documentation et plus spécifiquement au monde des bibliothèques. Cet article tente de l’expliquer de la manière la plus sobre qui soit et de lui rendre, en quelque sorte, honneur. Enfin, le fonds André Canonne de la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux) sera brièvement présenté.
Archieven op vaste grond?
De ‘definitieve’ inventarissen van het oud archief van Gent (1896) en Leuven (1929-1938) als instrumenten van archivistische vernieuwing
Timo VAN HAVERE, Praktijkassistent, KU Leuven
En 1896 parut l’Inventaire des archives de la ville de Gand. Catalogue méthodique général, de la plume de Victor Vander Haeghen. Joseph Cuvelier, de son côté, édita son Inventaire des archives de la ville de Louvain entre 1929 et 1938, en quatre volumes. Ces deux ouvrages sont toujours utilisés. Faut-il dès lors conclure qu’un ordre « définitif » a été instauré dans ces deux archives d’Ancien Régime de Gand et de Louvain ? Cet article se penche sur cette question. Après une problématisation de la notion d’ « ordre » et une brève histoire des archives de la ville de Louvain et de Gand au XIXe siècle, il s’agira de comparer les descriptions de Cuvelier et Vander Haeghen. Ces deux travaux montrent le fonctionnement d’une archivistique novatrice, dont S. Muller Fz., J.A. Feith et R. Fruin Th.Az. ont exposé les principes sur un plan international dans leur Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898).
Les logiciels de gestion bibliographique
Emmanuel DI PRETORO, Maître assistant à la Haute École Paul-Henri Spaak – Catégorie Sociale (IESSID)
 Éditorial
Éditorial
En cette année 2013, nous commémorons le 100e anniversaire de l’avant-dernier lauréat belge du Prix Nobel de la Paix. Gageons que son nom n’évoque pas grand-chose à la plupart des Belges d’aujourd’hui sauf… aux professionnels de l’information et de la documentation. En effet, en 1913, le Comité Nobel norvégien choisit de décerner la plus haute récompense à Henri La Fontaine. Oui, il s’agit bien ici du co-fondateur, avec Paul Otlet, de l’Institut international de Bibliographie et de l’homme à qui l’on doit également la Classification Décimale Universelle.
Pacifiste dans l’âme, La Fontaine a consacré une grande partie de sa vie à promouvoir la paix. En 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, il est d’ailleurs président du Bureau international de la Paix. Poste qu’il occupera de nombreuses années et qui lui vaut donc ce prix prestigieux. Après lui, le seul Belge à avoir reçu le Nobel de la Paix est le Père Dominique Pire, en 1958.
L’universalisme de La Fontaine l’a donc poussé à s’intéresser tant à l’information qu’à la paix. Un siècle après ce prix, ses valeurs et ses combats sont certainement toujours d’actualité. Le repli sur soi n’est pas souhaitable dans notre métier : les problématiques de l’I&D sont universelles et la recherche de solutions dépasse tous les clivages.
C’est donc dans cet esprit que nous vous proposons régulièrement dans ces pages des articles d’auteurs étrangers. D’ailleurs, ce numéro en est un bel exemple puisque nous publions aujourd’hui des articles en provenance de Suède, d’Afrique du Sud, du Royaume-Uni et… bien sûr, de Belgique. Raison pour laquelle, une fois n’est pas coutume, ces articles sont principalement en anglais.
L’esprit de La Fontaine est donc toujours vivant et nous espérons que ce numéro lui aurait plu, tout comme à vous, chères lectrices et chers lecteurs. Nous vous souhaitons une excellente lecture.
Guy Delsaut
When did the librarian become a librarian?
Bertil JANSSON, Doctor of Philosophy, Library and information sciences; Coordinator, Linnaeus University Kalmar / Växjö – Executive Office; Former Archivist and Head librarian, University of Kalmar
Cet article s’intéresse à la bibliothéconomie et son développement entre 1475 et 1780, tel que traité par son auteur dans la thèse de doctorat Bibliotekarien : om yrkets tidiga innehåll och utveckling (2010). Cette thèse débute par la définition de la bibliothèque comme un espace de travail à partir duquel les bibliothécaires ont créé leur future profession. La période analysée comprend 3 processus semi-parallèles en progrès, qui forment une profession complexe, allant de la routine quotidienne aux valeurs communes du concept de la bibliothèque comme une institution véhiculant des qualités. Ceci forme un point de départ à la discussion de théories sur la bibliothéconomie et se termine finalement dans des considérations auto-réfléchissantes sur la bibliothéconomie et les caractéristiques d’un bibliothécaire, proche d’un code éthique professionnel.
From coal mining to data mining: Libraries after technology replaces colliers
Derek LAW, Emeritus Professor of Informatics, University of Strathclyde – Department of Computer and Information Sciences
Cet article décrit le monde auquel étaient confrontés les bibliothécaires en 1970 et dans quelle mesure des siècles de stase furent suivies d’une période de rapide changement social, technique et professionnel. Ensuite, il expose dans les grandes lignes la contribution significative du Professeur Melvyn Collier. Il prend en considération l’incapacité de la profession à faire face adéquatement à la croissance exponentielle du matériel et des données numériques. En conclusion, il soutient qu’en retournant aux principes de base, la profession peut conserver un rôle clef et déterminant pour le futur.
Comment mettre en place une veille d’e-réputation en utilisant les outils gratuits ?
Luc HOURLAY, Bibliothécaire-Documentaliste/Webmaster, Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE)
Patrice X.CHALON, Knowledge Manager, Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE)
Michele RIGNANESE, Attaché Communication multimédia, Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Gudrun BRIAT, Communication Manager, Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE)
Dès la publication de ses premiers rapports d’étude, en 2004, le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) s’est intéressé à l’évaluation de sa propre influence. Différents projets ont donc été entrepris pour répondre à cette demande. En 2012, à la demande du service de la communication, la bibliothèque a mis en place un outil de veille de la réputation en ligne. Une structure modulaire décrivant toutes les étapes de la veille a été élaborée, et sur cette base, un outil (démonstrateur) a été construit à l’aide d’applications gratuites uniquement. Les premiers résultats sont d’emblée convaincants. Le démonstrateur ayant prouvé la plus-value d’entretenir une veille de e-réputation concernant le KCE. La prochaine étape envisagée est la poursuite du développement de l’outil, avec pour objectif la réduction maximale de l’intervention humaine pour que cette activité puisse s’inscrire sur le long terme dans une organisation de petite dimension aux ressources limitées.
An introduction to the BUFVC guidelines on audiovisual citation
Richard HEWETT, Chair Audiovisual Citation steering group, British Universities Film and Video Council (BUFVC)
Bien que l’usage de matériel audiovisuel augmente de façon exponentielle dans les activités d’enseignement, d’apprentissage et de recherche dans l’enseignement supérieur et dans la formation continuée, les normes pour référer à des documents sonores ou à des images sont souvent insuffisantes. Le British Universities Film & Video Council (BUFVC) a maintenant comblé cette lacune. L’ouvrage Audiovisual Citation: BUFVC Guidelines for referencing moving image and sound propose des conseils clairs, cohérents et complets pour citer tout type de document audiovisuel, du mashup composite YouTube au jeu vidéo. Cet article explique comment le projet a pris forme et de quelle manière il répond aux besoins très spécifiques de chercheurs, archivistes et bibliothécaires en matière de documents sonores et d’images.
Promoting awareness of information needs and realising gaps in knowledge: Examples from healthcare
Ina FOURIE, Professor, University of Pretoria – Department of Information Science
La reconnaissance du besoin d’information constitue le premier pas dans la recherche d’information. Cependant, les besoins en information ne sont souvent pas reconnus, ce qui pourrait expliquer les continuelles inquiétudes et frustrations exprimées par des personnes à la recherche d’informations, comme les patients et leurs familles. Le récit de leurs expériences, exprimées en leurs propres mots montre qu’il s’agit d’un sérieux problème. L’éducation à l’information dans le secteur des soins, comme les soins de santé, l’assistance sociale et l’enseignement peut mener à une prise de conscience de la nécessité de reconnaître le besoin d’information comme un premier pas dans la recherche d’information, ce qui permettrait de mieux aider ceux qui comptent sur le personnel soignant, l’assistante sociale ou l’enseignant pour rencontrer leurs besoins d’information. Cet article examine brièvement les enjeux d’un besoin d’information non satisfait, en utilisant les patients et leurs familles comme exemple. L’article commente également de manière sommaire l’éducation à l’information des professionnels et souligne que ceux-ci doivent prendre conscience de la nécessité de reconnaître le besoin d’information.
NUMÉRO SPÉCIAL
Outils documentaires
Ce qu’en pensent les professionnels !
 Éditorial
Éditorial
De tout temps, l’être humain a eu besoin d’outils pour faciliter son travail. Des outils pour tailler la pierre des hommes préhistoriques aux outils informatiques d’aujourd’hui, on peut dire qu’aucun métier ne se fait sans eux. De plus, ils doivent être de qualité et celle-ci est parfois difficile à estimer.
L’idée de ce numéro spécial des Cahiers de la documentation était de parler de ces logiciels, ces bases de données ou ces sources qui nous aident dans notre travail quotidien. Nous ne souhaitions pas, cependant, transformer notre périodique en un recueil de publireportages rédigés par différents fournisseurs vantant les mérites de leurs produits. C’est pourquoi nous avons fait appel à vous, il y a quelque temps déjà, pour que vous partagiez votre expérience avec nos lecteurs. D’ailleurs, qui d’autres que des professionnels de l’information et de la documentation peut avoir une meilleure vue des outils documentaires ?
Vous avez répondu à l’appel et nous vous en remercions ! Ce numéro reprend donc des présentations de systèmes de gestion de bibliothèque, d’outils de veille ou de diffusion d’information, de bases de données bibliographiques et d’encyclopédies. Certains outils sont présentés seuls, d’autres en comparaison avec leurs concurrents.
Bien sûr, ces articles reflètent de l’utilisation, parfois très spécifique, d’un ou plusieurs professionnels. Il se peut que certains producteurs ou diffuseurs de ces outils ne soient pas satisfaits de la présentation qui en est faite. Pour cette raison, nous nous engageons ici à publier tout droit de réponse qui nous serait adressé.
D’autre part, certains s’étonneront peut-être des outils qui sont présentés dans ce numéro. Un appel ayant été adressé à nos membres, nous publions les articles qui ont pu être finalisés. N’y voyez donc aucune intention de notre part de favoriser un outil plutôt qu’un autre.
Enfin, même si ce numéro ne reflète certainement pas l’ensemble du secteur des outils documentaires ou informationnels, remarquons qu’un grand nombre des outils présentés provient du monde du « libre », qui semble s’imposer de plus en plus dans les choix des professionnels de l’information.
Nous espérons que ce numéro, plus concret que d’habitude, vous permettra de découvrir de nouveaux outils et/ou de mieux connaître ceux que vous utilisez. Bonne lecture !
Guy Delsaut
Automatisering van bibliotheken en centra voor documentatie: Het ABCD systeem voor bibliotheek-automatisering en document management
Egbert de SMET, Project-coördinator, Universiteit Antwerpen
Le logiciel ABCD pour l’automatisation de bibliothèques et centres de documentation est sorti depuis trois ans et s’approche de la publication d’une version 2.0, la première mise à jour « majeure ». Les informations d’arrière-plan (histoire et technologie) les plus importantes du logiciel sont décrites avec une référence à la coopération au développement peu connue, mais significative, menée par les bibliothèques aux niveaux belge et flamand. Cet article illustre aussi que l’ABCD comme « suite logicielle » dépasse la simple automatisation de bibliothèques et peut être utilisé dans un contexte plus général d’automatisation documentaire, grâce à l’ouverture structurelle des schémas de base du système et grâce aux fonctionnalités très riches qui incluent en plus de l’automatisation de bibliothèques classique (catalogue, acquisitions, prêt…) également des possibilités comme un CMS pour la création d’un portail de bibliothèques, rendant possible, dans le module « site web », une offre intégrée de bases de données bibliographiques ou autres. L’article discute également des nouveaux développements les plus importants dans la nouvelle version 2.0 : les nouvelles versions ISIS sous-jacentes, Unicode, ainsi que l’option « bibliothèque numérique ». Finalement sont avancés quelques défis et lignes directrices permettant d’améliorer le soutien de la communauté et la distribution du logiciel, en vue d’accroître la viabilité d’un projet FOSS qui a prouvé son utilité.
Drupal, un Web CMS libre flexible à même de rencontrer les besoins des documentalistes, bibliothécaires, archivistes et knowledge managers
Patrice X. CHALON, Knowledge Manager, Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE)
Drupal est un logiciel libre de gestion de contenu Web qui, depuis sa création dans un kot étudiant en 2001, a fait son petit bonhomme de chemin pour être désormais utilisé par des sites phares tels que la Chancellerie du Premier Ministre, la Région wallonne, Le Soir ou encore… la Maison Blanche (États-Unis). De conception modulaire, disposant d’une très large communauté d’utilisateurs et de développeurs, il est aussi idéal pour développer des outils supportant le travail des documentalistes, bibliothécaires, archivistes et gestionnaires de connaissances (knowledge managers). Dans cet article, nous décrivons les concepts de base sur lesquels Drupal s’appuie (noeuds, modules, thèmes, taxonomie, distributions), puis présentons deux exemples et quatre retours d’expérience d’applications développées en interne. Enfin, nous discutons également les difficultés spécifiques au développement de sites avec Drupal, et l’intérêt du développement de sites en interne.
Une plateforme de veille réalisée avec Scoop-it
Nadine DERWIDUÉE, Experte en information et veille, Le Forem – Département des relations internationales
L’article présente l’utilisation de la plateforme Scoop.it par le Département des relations internationales du Forem. Cette plateforme de « curation » permet de diffuser les résultats de la veille internationale sur les matières emploi et formation. Elle offre de nombreux avantages : outil existant, facilité et rapidité d’utilisation, cohérence des aspects graphiques de la plateforme, outil standard très correct, absence de problème, gratuité, hébergement dans les nuages, facilité de collaboration via des suggestions, possibilité de « suivre », inclusion dans l’Intranet,… Elle présente aussi quelques inconvénients: ouverture au public, conditions générales d’utilisation, évolutions inattendues et parfois non souhaitées, aucune garantie quant à la durée de vie, possibilités de recherche peu expliquées,… L’outil est donc utile mais doit être combiné par le documentaliste avec ses compétences et sa méthode de travail plus classique.
Multiplier l’acquisition de bases de données bibliographiques pour enrichir la recherche documentaire : Mythe ou réalité ? L’exemple du domaine linguistique et littéraire
Sara DECOSTER, Responsable scientifique, Université de Liège (ULg) – Bibliothèque ALPHA
Stéphanie SIMON, Responsable scientifique, Université de Liège (ULg) – Bibliothèque ALPHA
Muriel van RUYMBEKE, Directrice, Université de Liège (ULg) – Bibliothèque ALPHA
Cet article propose une analyse approfondie de quatre bases de données bibliographiques sous abonnement disponibles à l’Université de Liège, sur deux plateformes différentes, dans le domaine des études linguistiques et littéraires. Les outils concernés offrent une couverture générale du domaine, au sens où ils ne sont pas spécialisés dans une période chronologique ou une langue particulière. Les quatre bases de données analysées sont MLA International Bibliography et Communication & Mass Media Complete (CMMC), accessibles via Ebsco, ainsi que Francis et Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) sur la plateforme ProQuest. L’objectif de l’article est d’évaluer le bénéfice que l’utilisateur peut tirer de ces produits. Afin d’y parvenir, l’analyse suit des axes centrés sur le contenu et la complémentarité des ressources ainsi que sur les fonctionnalités proposées. Les résultats de ce travail peuvent alimenter une réflexion sur l’évolution de la bibliothéconomie et sa place dans le monde de la recherche et de l’enseignement.
Scopus et WorldCat : Regards croisés sur deux outils bibliographiques
Philippe MOTTET, Documentaliste, Université de Liège (ULg) – Bibliothèque des Sciences et Techniques
Ninfa GRECO, Directrice, Université de Liège (ULg) – Bibliothèque des Sciences et Techniques
Les outils de recherche bibliographique, imprimés puis électroniques, ont longtemps été le domaine réservé de sociétés commerciales qui proposaient des produits clé sur porte, multidisciplinaires ou spécialisés. Ils restent incontournables pour la plupart des institutions scientifiques par la qualité de leur contenu, la précision de leurs systèmes d’interrogation et la facilité de traiter et de sauvegarder les résultats des recherches réalisées. Ce monopole a été remis en question par l’accessibilité, toujours plus grande, et gratuite, de l’information sur Internet. Parmi les nombreux outils bibliographiques actuellement disponibles, nous avons choisi de comparer un système commercial traditionnel, utilisé dans les universités de la Communauté française de Belgique : Scopus, et une solution issue du monde des bibliothèques, consultable gratuitement, du moins partiellement, sur Internet : WorldCat. La comparaison des deux produits a donné lieu à des résultats parfois inattendus.
Face-à-face entre Wikipédia et l’Universalis en ligne : Peut-on tenter une comparaison ?
Guy DELSAUT, Rédacteur en chef des Cahiers de la documentation, Association belge de Documentation (ABD-BVD)
Cet article tente de comparer la version francophone de Wikipédia et la version en ligne de l’Encyclopædia Universalis. Ces deux encyclopédies se différencient dans leur modèle : l’une est libre et collaborative, l’autre est une source de référence depuis des décennies et écrite par des auteurs de renom. Le nombre d’articles, leurs sujets, leur mise à jour, leur neutralité sont autant de sujets qui les différencient. Face à l’un des sites les plus visités au monde, l’Universalis, qui a publié son ultime édition papier en fin d’année 2012, pourra-t-elle encore longtemps rivaliser avec Wikipédia ? Et cette dernière pourra-t-elle faire taire définitivement ses détracteurs et neutraliser les vandales qui discréditent le travail bénévole de ses milliers de contributeurs ?
 Éditorial
Éditorial
Ce premier numéro de l’année 2013 s’ouvre sur l’article d’Akémi Roberfroid et de Julien Lecomte sur les complémentarités entre les journalistes et les documentalistes. Ce n’est pas la première fois que les Cahiers de la documentation évoque cette profession connexe à la nôtre. Ces deux métiers sont différents mais ils utilisent la même matière première : l’information ! Tout bon journaliste, tout bon documentaliste ou tout bon bibliothécaire connaît l’importance de celle-ci mais il doit faire face, depuis quelques années, à un nouveau prédateur : le pollueur d’information.
En effet, l’avènement du Web et, encore plus celui du Web collaboratif, a permis à tout un chacun de devenir un producteur d’information. Du garde-champêtre passionné d’oiseaux à la directrice des Ressources humaines soucieuse de la formation de ses employés, en passant par l’adolescente passionnée de jeux vidéo ou le pensionné racontant son « Mai 68 », tout le monde peut partager son savoir dans des blogs, sur Facebook, Twitter, Wikipédia,… Ces personnes n’ont pas toujours l’éthique d’un documentaliste ou d’un journaliste mais certains partagent leurs connaissances avec passion. Mais ce n’est pas le cas de tous…
Par l’expression « pollueur d’information », je vise ceux qui, sciemment, écrivent ou diffusent de fausses informations, juste par plaisir (à supposer qu’on trouve du plaisir à désinformer) ou dans le but de « faire le buzz », comme on dit.
On se souviendra de l’annonce de la mort de la Reine Fabiola en 2009, annoncée via le service Ihavenews.be de l’agence Belga, de cette vidéo sur YouTube montrant un aigle soulevant un enfant dans un parc de Montréal, en fin d’année 2012, ou de l’annonce, via Twitter, de l’inondation de la salle des marchés de Wall Street suite à l’ouragan Sandy, reprise par CNN, puis démentie.
Parfois, ces fausses informations proviennent même de personnes censées avoir une bonne culture informationnelle. Citons ce professeur de lettres parisien qui, voulant piéger ses élèves, a diffusé en début d’année 2012 de fausses informations sur un poète tant sur Wikipédia que sur différents forums ou, plus récemment encore, ce journaliste de la RTBF modifiant le parti d’Elio Di Rupo sur sa page Wikipédia, juste pour réaliser quelques « expériences probantes » (sic).
Ces exemples montrent, faut-il le rappeler, que l’information doit toujours être vérifiée mais ils montrent aussi qu’il y a une éducation à faire. À côté de l’infobésité, sujet du prochain Inforum, cette pollution constitue certainement l’un des défis majeurs de nos métiers. Tout professionnel de l’information, au sens large, se doit de lutter contre cette dérive.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce premier numéro des Cahiers et je vous donne rendez-vous en juin pour un numéro spécial autour des produits documentaires.
Guy Delsaut
Journaliste et documentaliste : Quelle complémentarité ?
Akémi ROBERFROID, Bachelière en bibliothéconomie; Documentaliste, Etopia
Julien LECOMTE, Titulaire d’un Master et de l’Agrégation en information et communication; Chargé de communication, Université de Paix
Cet article, s’appuyant sur certaines dérives observées dans l’exercice du métier de journaliste, vise dans un premier temps à éclairer les modifications du contexte informationnel, liées en partie aux nouvelles technologies : multiplicité croissante des énonciateurs et des sources documentaires, partage de données en temps réel et focalisation sur l’actualité, uniformisation de l’information… Ensuite, il expose la complémentarité des missions et compétences des journalistes et documentalistes, tout en soulignant les rapports au temps propres à chaque métier et la difficulté d’une coopération, due à des méthodes de travail et des objectifs partiellement différents. En guise de conclusion, il énonce plusieurs enjeux pour le documentaliste : d’une part, ceux-ci réaffirment la logique qui sous-tend le métier en termes de démarche critique et de rigueur, et d’autre part, ils questionnent diverses voies pour enrichir ses pratiques au quotidien, en insistant sur la veille et le partage des méthodes.
Digital Humanities en de wetenschappelijke bibliotheek van de toekomst
Demmy VERBEKE, Faculteitsbibliothecaris Letteren, KU Leuven
Le pronostic que la bibliothèque du futur sera une bibliothèque sans livre revient régulièrement. Cette contribution examine plus en détail les arguments pour et contre cette position, ainsi que les défis et opportunités qui s’offrent dans ce contexte aux bibliothèques scientifiques dans le domaine des sciences humaines. Comme ces bibliothèques continueront à jouer un rôle de soutien dans la recherche à part entière, elles devront devenir des partenaires des projets numériques. Il va de soi que de nombreux obstacles devront être surmontés, mais une réorientation des moyens en personnel et de l’espace de la bibliothèque, où il faut conserver un équilibre entre les besoins des étudiants et ceux des chercheurs, pourra sans doute fournir (une partie de la) solution.
Faire circuler les savoirs : Le courtage du savoir et la médecine translationnelle
Morgan MEYER, Chercheur, Centre de Sociologie de l’Innovation, École des Mines de Paris – ParisTech
Cet article se focalise sur deux domaines où la mise en circulation des savoirs scientifiques est particulièrement saillante : le courtage du savoir et la médecine translationnelle. Les courtiers du savoir (knowledge brokers) sont des personnes ou des organisations qui font circuler le savoir et créent des liens entre les chercheurs et leurs différents publics. En discutant de l’invisibilité et de l’interstitialité de ces courtiers, l’article soutient que leurs pratiques et leurs outils doivent être analysés. L’article soutient que ces courtiers du savoir ne font pas seulement circuler les savoirs, mais qu’ils produisent également un nouveau type de savoir : le « savoir négocié ». Dans un deuxième temps, l’article se concentre sur la médecine translationnelle. La volonté de traduire et rendre mobile des connaissances biomédicales se heurte à des discontinuités – disciplinaires, organisationnelles, linguistiques, culturelles et politiques – entre la biologie et la pratique médicale. La médecine translationnelle est généralement imaginée comme une solution à cette discontinuité, car elle se situe « entre » deux mondes et permet de les connecter.
Bibliografische ondernemingen rond 1900 (deel 3): De historiografie van de beweging
Paul SCHNEIDERS, Documentatiehistoricus op rust
Les lacunes dans l’historiographie de l’information et du mouvement documentaires sautent aux yeux lorsqu’on considère le nombre d’études consacrées à celle des bibliothèques. Elle ne reçut que très peu d’attention de la part de Clio, malgré l’émergence de l’ « information documentaire » en tant que science dès les années 60, et ce depuis la première tentative de rédaction d’une histoire de la documentation par Paul Otlet en 1934 – dans son Traité de la Documentation. Dans les années 50, l’opportunité d’une histoire de la documentation fut cependant largement exprimée. Ce n’est qu’aux États-Unis d’Amérique et en République fédérale d’Allemagne qu’une amorce d’exercice d’histoire de l’information documentaire vit le jour, au début des années 80.
Audiovisual citation: A project update
Sian BARBER, Lecturer in Film, Queen’s University Belfast – School of Creative Arts; Leader of the British Universities Film and Video Council steering group on AV citation
Les systèmes de notations existants se révèlent inadéquats pour la citation d’images animées et de média sonores tels que les videocasts, la télévision en streaming, les fichiers sonores, les séquences d’archives non-cataloguées, les contenus amateurs hébergés en ligne ou les enregistrements radiophoniques non-diffusés. Un groupe de travail britannique, subsidié par le Higher Education Funding Council for England (HEFCE) et coordonné par le British Universities Film and Video Council, étudie ce problème. Le rapport, établi par la responsable du groupe de pilotage, Sian Barber, fournit un bilan intermédiaire de ce projet.
Samarcande : Plus de deux millions de titres au bout de l’index…
Alexandre LEMAIRE, Responsable de la cellule TIC, Fédération Wallonie-Bruxelles – Service de la lecture publique
Fin 2011, à l’occasion de la Fureur de lire, le portail des catalogues collectifs des bibliothèques publiques de la Communauté française a été mis en ligne. La multitude des services et fonctionnalités de cette base de données donnant accès à plus de deux millions de documents et dotée d’un OPAC de nouvelle génération ainsi que de nombreuses fonctionnalités Web 2.0 est désormais à la disposition des bibliothécaires et des citoyens. Samarcande est par ailleurs en permanente évolution…
Compte rendu
Google : Trucs et astuces pour les professionnels de l’Infodoc – Focus sur ses fonctions avancées et sur son actualité chargée
Arnaud SEEUWS, Documentaliste, Centre Antipoisons
