Comment enrichir vos longues soirées d'hiver ?
Pour patienter pendant la petite pause des Fêtes de fin d’année, et après la parution du numéro spécial audiovisuel des Cahiers de la Documentation, nous vous proposons de (re)découvrir la présentation des collections « non-film » de la Cinematek, qui avait été faite par Jean-Paul Dorchain durant le Doc’Moment d’avril 2014. Au plaisir de vous retrouver en 2016 !
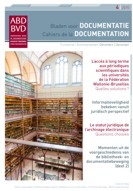 Éditorial
Éditorial
Le 13 novembre 2015 a sidéré Paris, l’Europe et le monde. Les attentats, qui ont coûté la vie à 130 personnes et ont fait plus de 350 blessés, ont inéluctablement changé la face du monde tel qu’on l’a connu.
De nombreuses questions fusent, impérieusement. Comment assurer la paix et la sécurité ? Comment préserver les valeurs fondamentales de notre société ? Comment éviter des drames futurs ? Quels équilibres géopolitiques faut-il trouver pour recouvrer la stabilité mondiale, et construire un monde où il fait bon vivre pour chacun ?
Toute cette problématique est extrêmement difficile, et il n’existe pas de réponse simple ni définitive.
Dans un tel contexte, les enjeux de l’information s’avèrent à la fois complexes et stratégiques. S’il est impossible de collaborer efficacement sans un échange aisé de l’information, tant sur un plan international qu’en entreprise, il est tout aussi important de protéger les données et d’éviter que des personnes non autorisées puissent y accéder.
Une information fiable, dont l’intégrité est garantie, constitue un instrument précieux pour se former une opinion ou pour prendre une décision en connaissance de cause. C’est grâce à l’information que nous pouvons vivre selon la raison.
Ce constat est pertinent pour chacun, au quotidien. C’est après avoir examiné les faits, en les ayant considérés de plusieurs points de vue, que nous pouvons formuler des avis judicieux. C’est également ainsi que nous pouvons contribuer à un monde meilleur.
Sara DECOSTER
L’accès à long terme aux périodiques scientifiques électroniques dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Quelles solutions ?
Aude ALEXANDRE, Attachée, Direction du Réseau des Bibliothèques de l’Université de Liège
L’accès à long terme aux périodiques scientifiques électroniques pose des problématiques concrètes spécifiques, qui dépassent celles de la conservation des données numériques. Après une synthèse des différents risques et concepts liés à l’accès pérenne, cet article examine en particulier les questions juridiques et contractuelles ainsi que les différentes solutions d’archivage externes dédiées à la préservation des e-journaux (LOCKSS, CLOCKSS, Portico). Le constat posé est qu’il n’existe à l’heure actuelle pas de solution miracle, mais bien un ensemble d’actions possibles et de solutions matures et complémentaires. Une échelle de stratégies concrètes a été recommandée aux universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2014, qui ont commencé à les mettre en place.
Informatieveiligheid bekeken vanuit juridisch perspectief
Johan Vandendriessche, Advocaat-vennoot, Crosslaw CVBA; Gastprofessor ICT-recht, Universiteit Gent (UGent)
La sécurité de l’information n’est toujours pas abordée de manière coordonnée sur le plan juridique. Cela ne signifie cependant pas qu’il n’existe pas de lois et de règlementations relatives à la sécurité de l’info À côté d’un devoir général de diligence applicable à tous, il existe de nombreuses obligations spécifiques en lien avec la sécurité de l’information. La tâche ardue du responsable de la sécurité de l’information consiste à identifier et appliquer correctement ces règles. Le devoir de sécurité le plus largement applicable se trouve dans la loi sur le traitement des données à caractère personnel. Celle-ci ne prévoit cependant pas, pour le moment, la nomination d’un « security officer » ou un devoir de notification en cas de faille de sécurité. Dans le cadre de la révision du cadre juridique applicable aux traitements de données à caractère personnel, beaucoup d’attention est consacrée à un probable élargissement des dispositions relatives à la sécurité de l’information, notamment par la nomination d’un « data protection officer » et l’établissement d’un devoir de notification en cas de violation.
Le statut juridique de l’archivage électronique : Questions choisies
Amandine PHILIPPART de FOY, Avocate au barreau de Bruxelles ; LL.M candidate, Université de Melbourne
Bernard VANBRABANT, Avocat – Of Counsel, Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick ; Chargé de cours, Université de Liège (ULg)
La valeur juridique des archives électroniques d’entreprise constituées de scans de documents papier, ainsi que leurs conditions d’archivage, feront l’objet de cet article. Des réponses concrètes seront fournies aux questions pratiques. Une entreprise peut-elle recourir à l’archivage électronique? L’archive électronique suffit-elle, ou faut-il conserver la version papier du document ? L’entreprise est-elle autorisée à archiver elle-même ses documents ou doit-elle recourir aux services d’un tiers ? Quelles sont les conditions auxquelles sont soumis les prestataires de services d’archivage électronique ?
Momenten uit de voorgeschiedenis van de bibliotheek- en documentatiebeweging (deel 2)
Paul SCHNEIDERS, Documentatiehistoricus op rust
Cet article sur les antécédents du mouvement des bibliothèques et de la documentation approfondit la période 1830-1880. Il s’agit d’un moment important de professionnalisation du métier de bibliothécaire, destiné à être exercé sur des bases plus scientifiques. Aux États-Unis, le service à l’usager se trouve désormais au centre des préoccupations. Par ailleurs de nouveaux outils, tels que les index des publications périodiques voient le jour. C’est dans ce contexte qu’il faut situer l’entreprise bibliographique qu’est l’International Catalogue of Scientific Literature de la Royal Society. Le développement de ces ressources doit permettre aux chercheurs de garder la maîtrise de la production scientifique, qui se fait de plus en plus abondante. Dans cette optique, diverses institutions mettent également en place une politique d’échanges.
NUMÉRO SPÉCIAL
L’audiovisuel sous les projecteurs
 Éditorial
Éditorial
Chers lecteurs, nous espérons que la période estivale fut belle et enrichissante pour vous tous.
Pour la clôturer agréablement, nous vous proposons ce numéro spécial des Cahiers de la Documentation, axé sur l’audiovisuel au sens large. En effet, à l’heure où certains supports se révèlent de plus en plus rapidement obsolètes, comment gérer de manière optimale l’information, la documentation, les archives, en particulier lorsqu’il s’agit de sons et d’images ? Dans cette publication très dense, vous trouverez foule de détails pratiques et techniques sur l’audio, la photo et la vidéo.
L’audiovisuel est aujourd’hui incontournable, et il nous semblait utile de nous attarder sur les acteurs de l’information et de la documentation qui manipulent au quotidien l’audiovisuel sous toutes ses formes. Qui sont les spécialistes de l’information audiovisuelle ? Quels sont les projets en cours et à venir de ces spécialistes ? Comment appréhendent-ils leur métier ? Quels sont les outils utilisés par ces professionnels ? Comment les adaptent-ils à leur environnement spécifique ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre grâce aux consœurs et confrères qui ont accepté pour l’occasion, de partager leur expérience au sein de nos Cahiers. Nous les remercions chaleureusement d’avoir, l’espace de quelques lignes, ouvert leur antre informationnelle.
Une petite parenthèse pour rappeler que le site web de l’ABD-BVD est désormais accessible à tous en ligne. Vous y trouverez notamment les articles publiés dans nos Cahiers de la Documentation entre janvier 2013 et décembre 2013, ainsi que les sommaires des numéros de 2014 et 2015. Les différentes éditions des Inforum depuis 1996 sont également accessibles, de même que les présentations des Doc’Moments (anciennement « réunions mensuelles ») ayant eu lieu entre 2013 et 2015. Nos administrateurs mettent tout en œuvre pour compléter le plus rapidement possible les différentes rubriques du site et vous offrir une documentation riche et aboutie.
Nous en profitons également pour annoncer la reprise de nos Doc’Moments. Au plaisir de vous retrouver, et d’ici là, nous vous souhaitons une très bonne lecture !
Christopher BOON
Catherine GÉRARD
Natacha WALLEZ
Avant-propos
Christopher BOON, Catherine GÉRARD, Natacha WALLEZ, Rédacteurs en chef
Le plan PEP’s : numériser pour préserver et valoriser les patrimoines culturels
Jean-Louis BLANCHART, Directeur de la délégation générale à la numérisation des patrimoines culturels, Administration générale de la culture du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Le plan PEP’s est le plan de numérisation des patrimoines culturels adopté par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2007. Il a pour objectif de numériser les patrimoines culturels afin d’en assurer leur préservation à long terme et leur valorisation via un accès en ligne par le biais du portail numeriques.be. Ce plan est mis en œuvre et géré par la délégation générale à la numérisation des patrimoines culturels, qui est un service de l’Administration générale de la culture du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Numérisation des images des télés locales : à la recherche de l’image perdue
Michael MERCIER, Coordination projet NÉPAL, Fédération des télés locales
Julie VERSLYPE, Coordination Brigade du Tigre, Fédération des télés locales
Sauver les archives audiovisuelles des télévisions locales francophones, en péril depuis de nombreuses années. Protéger des méfaits du temps leur patrimoine, construit jour après jour durant plus de 30 ans, et dans lequel le grand public aime se replonger avec nostalgie. Faire revivre les moments forts des régions, des communes, des villages ou les heures de gloire de personnalités locales. Alimenter la télévision de demain avec des images d’hier. Voilà les multiples objectifs du projet de numérisation NÉPAL mis en place en 2010 à la Fédération des télés locales. 1 Fédération, 12 télévisions, 12 localisations, 12 méthodes de travail, 37 années d’archives. Un sacré défi !
Het digitale VRT archief, van band tot bestand
Jan VANREGENMORTER, Hoofd Documentatie & Archieven, Vlaamse Radio en Televisieomroep (VRT)
« L’avenir sera numérique ou ne sera pas », un credo de la VRT en 2006. Déjà à l’époque, il apparaissait clairement qu’en tant que service public de diffusion moderne, nous ne pouvions pas rater le train du digital. Progressivement, nous avons commencé à produire de manière numérique, d’abord pour la radio, ensuite pour la télévision, et simultanément l’appareillage analogique disparut du marché. En vue de pouvoir utiliser de manière aisée l’énorme archive de diffusion en format analogique et de mieux la valoriser, la numérisation s’imposa là aussi. Prudemment, les premiers projets de numérisation à petite échelle démarrèrent, puis prirent la direction de la numérisation de masse. Dans les prochaines années, nous numériserons toujours plus afin de nous débarrasser au final de tout le matériel audiovisuel analogique. La numérisation n’a pas seulement un impact sur la réutilisation, mais aussi sur le processus de production, sur les collaborateurs impliqués dans la production et sur les archivistes et le processus d’archivage en bout de chaîne. Cette voie une fois empruntée, il n’y aura pas de retour en arrière possible, et il faudra en permanence veiller à l’intégrité des données numérisées.
Preserving Local Television: Prioritization by Format
Siobhan HAGAN, Audiovisual Archivist, University of Baltimore Langsdale Library
Les chaînes de télévision locales ont couvert et continuent de relater récits et événements tant régionaux que nationaux, tout au long de l’histoire de ce médium de communication de masse, et constituent une part importante de notre héritage culturel global. Des efforts accrus doivent être consacrés à la sauvegarde du reliquat des images vidéo historiques diffusées, avant qu’elles ne soient à jamais perdues. Etant donné les ressources limitées des dépôts d’archives audiovisuelles, les efforts de préservation devraient à l’heure actuelle se focaliser sur le format le plus ancien, et le plus à risque : le Quadruplex 2 pouces (2” Quad). L’article dresse un bref historique de ce format vidéo et illustre comment une petite université publique dans une ville ouvrière américaine a initié des démarches en vue de la préservation et de l’accès à ses collections au format 2” Quad.
Fabriquer une histoire et une mémoire sonore urbaine : archivage, exploitation, restitution
Séverine JANSSEN, Coordinatrice, Bruxelles Nous Appartient-Brussel Behoort Ons Toe (BNA-BBOT)
Flavien GILLIÉ, Ingénieur du son, Bruxelles Nous Appartient-Brussel Behoort Ons Toe (BNA-BBOT)
Lionel MAES, Designer graphique et développeur, La Villa Hermosa
Les forces et enjeux historiques sont partout. Pourtant, nulle histoire ne répertorie la totalité des forces et enjeux simultanés qui se jouent et se sont joués en elle. Toute histoire est amputée d’une partie d’elle-même, offre des béances: ce que serait une histoire totale n’est concevable que d’un point de vue extérieur à l’histoire elle-même, extérieur à nous-mêmes. C’est pourtant au cœur de ces béances que les cartes de l’histoire présente peuvent être rebattues, que des formes historiques inédites peuvent s’expérimenter. Ainsi en va-t-il du travail mené par BNA-BBOT : historiciser, archiver dynamiquement un ensemble local d’expériences dites. Le ressort de cette micro-histoire est le son, son écriture la voix. La voix comme micro-trace irréductible à toute frappe textuelle, à toute présence visuelle. Collection indéfinie de voix et de sons surgis d’un temps vécu, la collection sonore de BNA-BBOT forme une biographie vivante et organique de la ville. Elle dit la ville telle qu’elle est parfois, telle qu’elle aurait pu être, telle qu’elle pourrait être. Quelles en sont les limites, quelles en sont les modalités opératoires, comment offrir à ces archives mineures des conditions de pérennité, d’audibilité et de rivalité avec les archives majeures ?
Les collections non-film de la Cinémathèque royale de Belgique
Jean-Paul DORCHAIN, Responsable des collections non-film, Cinémathèque royale de Belgique
Le Centre de documentation de la Cinémathèque royale de Belgique collecte, inventorie, indexe, conserve, numérise et met en accès dans sa bibliothèque une des plus riches collections en Europe de documents sur le cinéma, tant en format papier qu’en format numérique. Cet article présente les différentes topologies patrimoniales et les activités du Centre de documentation.
De filmcollectie van het Koninklijk Belgisch Filmarchief
Bruno MESTDAGH, Hoofd digitale filmcollectie, Koninklijk Belgisch Filmarchief
Tout qui a au moins une fois assisté à une des séances du Musée du Film, maintenant mieux connu sous le nom de Cinematek, se demandera peut-être d’où proviennent tous ces films. Se cachent-ils dans les caves de la Cinematek, à l’abri derrière le sourire de la dame de l’accueil ? Non, des centaines milliers de bobines de films et de fichiers numériques sont collectés, conservés, inventoriés et apprêtés en vue de leur projection dans un des trois dépôts de la Cinémathèque royale de Belgique. Au même endroit se trouve un département de restauration où les films les plus précieux et les plus fragiles sont digitalisés et restaurés.
La cinémathèque égyptienne : une nécessité ou une option ?
Marwa EL SAHN, Directrice du Centre d’Activités Francophones (CAF), Bibliotheca Alexandrina
Assurer la pérennité et la mise en valeur d’un patrimoine cinématographique requiert un ensemble de facteurs œuvrant dans une même direction. De longue date, l’Égypte a mis en place les différentes institutions nécessaires au maintien de sa tradition cinématographique. L’auteure nous livre ses réflexions sur la nécessité d’une vision politique globale afin de voir aboutir concrètement cette mission de sauvegarde.
Les archives de Ciné-Télé-Revue : 70 ans de rêve en images
Geoffroy VERMEREN, Responsable “Gestion des contenus”, Éditions Ciné-Revue SA
À l’heure où la presse quotidienne fait pâle figure dans son modèle économique qui se dégrade, les magazines télé n’échappent pas, eux non plus, à la règle. Fort de plus de 70 ans de présence en librairie, l’hebdomadaire belge Ciné-Télé-Revue continue pourtant de faire rêver ses lecteurs au travers de nombreux reportages consacrés aux mondes people, du cinéma et de la télévision. C’est dans un tel contexte que doivent aujourd’hui évoluer et innover ses documentalistes-iconographes, confrontés quotidiennement aux nouvelles technologies et à l’évolution des canaux de diffusion. Aujourd’hui, les contenus du bon vieux magazine papier doivent être déclinés sur le web, sur smartphones et tablettes avec, à la clé, la nécessité d’adjoindre aux compétences purement documentaires, des compétences photographiques et de gestion de droits d’auteur. Comment d’une part gérer les milliers de documents photographiques anciens qui constituent les archives du magazine, et d’autre part accueillir de nouveaux documents numériques provenant de sources très diverses? C’est là tout le défi du service de gestion des contenus.
Digitale duurzaamheid en het behoud van audiovisueel erfgoed
Rony VISSERS, Coördinator PACKED vzw – expertisecentrum digitaal erfgoed
En matière de conservation d’objets informationnels audiovisuels, à l’opposé des objets patrimoniaux traditionnels, il y a lieu d’opérer une distinction entre d’une part la conservation du contenu et d’autre part la conservation du support. Pour les institutions du patrimoine culturel, ce qui importe le plus souvent est de conserver le contenu, et non le support. Cette distinction est importante, car la conservation des supports pose certains défis à la conservation du contenu. À l’heure actuelle, la stratégie la plus importante pour la conservation (et la valorisation) des objets informationnels audiovisuels est très souvent la numérisation. La préservation numérique génère elle-même une série de nouveaux défis. Elle exige non seulement une nouvelle expertise, qui doit en permanence être actualisée, mais elle occasionne également des coûts récurrents qui, en raison de l’ampleur et de la complexité des fichiers de données audiovisuelles, peuvent devenir considérables. Ceci constitue souvent un obstacle. En Flandre et à Bruxelles, quelques organismes spécialisés offrent cependant au secteur culturel de l’aide dans une série de domaines comportant conseil et services de support, il s’agit entre autres de l’asbl PACKED, du VIAA et de la Cinémathèque royale de Belgique.
The European Audiovisual Observatory: A goldmine of information on the audiovisual industries – made in Europe…
Alison HINDHAUGH, Information Officer, European Audiovisual Observatory
L’Observatoire européen de l’audiovisuel est une mine d’or d’informations sur les industries audiovisuelles en Europe. Cinéma, télévision, vidéo et services à la demande sont analysés d’un point de vue économique et juridique. Découvrez quels types d’informations vous pouvez obtenir auprès de cette institution unique qui fait partie du Conseil de l’Europe à Strasbourg.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en pratique
Frédéric VERGEZ, Conseiller/Documentaliste, Conseil supérieur de l’audiovisuel
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est l’autorité administrative indépendante chargée de réguler le secteur audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles : télévisions, radios, WebTV, web radios, câblodistributeurs, opérateurs de réseaux… Il veille à ce que ces différents acteurs respectent les obligations légales auxquelles ils sont soumis. Son Centre de Documentation assure à la fois un rôle interne et un support pour les utilisateurs externes.
European Commission’s progress reports on digitisation of the European cultural (and film) heritage
Svetlana YAKOVLEVA, Master in Law and Economics (LL.M) ; Research master student, Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam
Cet article synthétise deux rapports d’avancement de la Commission européenne dans le domaine de la préservation numérique du patrimoine européen culturel (et filmographique). Le premier rapport révise et évalue les progrès de la numérisation du patrimoine culturel, qui s’est déroulée entre 2011 et 2013, suite à l’adoption en 2011 de la Recommandation de la Commission européenne sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique. Le deuxième rapport fait suite à la Recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le patrimoine cinématographique. Il se concentre sur les progrès, les défis et les risques rencontrés durant le processus de numérisation du patrimoine cinématographique en 2012-2013. Même si les deux rapports démontrent que certains progrès ont été réalisés dans les domaines concernés, ils reconnaissent aussi que ce progrès est encore limité et que la numérisation reste toujours un défi.
Biblio-Jack : le b.a.-ba des bibliothèques de l’UCL en vidéo
Marine FINFE, Bibliothèque de droit de l’Université Catholique de Louvain (UCL)
Carole KOJO-ZWEIFEL, Bibliothèque de droit de l’Université Catholique de Louvain (UCL)
Christine LANNERS, Bibliothèque des sciences de la santé de l’Université Catholique de Louvain (UCL)
Sophie PATRIS, Bibliothèque des sciences de la motricité de l’Université Catholique de Louvain (UCL)
En 2014, une équipe de bibliothécaires des bibliothèques de l’Université catholique de Louvain (BIUL) décide de réaliser des vidéos ludiques et originales pour répondre aux questions récurrentes de leurs jeunes utilisateurs. Le support vidéo, populaire et facilement accessible auprès des étudiants via Youtube, a paru être un excellent complément aux formations existantes tout en permettant de rafraîchir et rajeunir l’image des bibliothèques. Un an plus tard, les quatre vidéos de la série Biblio-Jack sont mises en ligne et remportent un beau succès, à tel point que quatre nouvelles vidéos sont mises en ligne à la rentrée 2015-2016. Cet article a pour but de retracer les différentes étapes de cette entreprise (recherches préliminaires, rédaction de scénarios, budgétisation, tournage, montage, promotion), de mener une réflexion sur l’impact auprès du public et de proposer quelques pistes de bonnes pratiques basées sur l’expérience acquise.
Présentation du master en Gestion globale du numérique (GGN)
Chantal HARTMAN, Responsable de la coordination pédagogique du master GGN, Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine (HELB)
Une formation nouvelle à la convergence de plusieurs métiers du numérique, toutes disciplines confondues qui répond à des besoins nouveaux. Il s’agit d’un master spécifique qui, outre les connaissances pointues et en permanence mises à jour sur tous les aspects des filières numériques, comprend des accents prospectifs sur les mutations profondes que génère le numérique sur la société.
Avis personnel d’une étudiante en master GGN : une formation innovante en quête de performance
Géraldine GELAI, Étudiante en 2e master GGN, Haute École Libre de Bruxelles
Le nouveau master en Gestion globale du numérique est une toute nouvelle formation proposant des cours diversifiés comme l’audiovisuel, la 3D, l’informatique ou encore l’archivage numérique. Cet article présente mon point de vue personnel sur la formation dispensée.
The fake digital revolution
Mauro BOTTARO, Audiovisual Expert
L’objet de cet article d’opinion est le rôle que la photographie a pu avoir vis-à-vis de la réalité. Les partisans de la révolution numérique voient manifestement ce rôle de manière négative et ils l’estiment effacé par un système qui, au lieu d’être fondé sur l’idée de l’empreinte et de la traçabilité directe, comme la photographie analogique, est fondé sur le principe du transfert numérique.
 Éditorial
Éditorial
Le beau temps s’installe, on reprend le temps de flâner dans les parcs et de sortir les barbecues. Pas de doute, l’été approche et comme chaque année l’Inforum investit les locaux de la KBR. Au moment où nous rédigeons ces lignes, le programme vient d’être diffusé et les premières inscriptions sont déjà enregistrées. À l’affiche cette année, The I&D puzzle : new pieces to solve it: l’archivage numérique de la British Library, la présence sur le web des bibliothèques publiques, les conséquences du web sauvage sur notre organisation, les nouveaux outils de veille sur les réseaux sociaux, les ressources cachées de la recherche par image, etc. Bref, un portrait chamarré de l’impact des nouvelles technologies sur nos métiers et nos processus de travail, accompagné de trucs, astuces et méthodes pratiques qui ouvrent nos horizons professionnels.
L’été, c’est aussi une période de renouveau et après des mois de gestation, le nouveau site web de l’ABD-BVD vient d’être lancé : plus convivial, plus moderne, plus clair et surtout à votre service ! Vous y découvrirez en un coup d’œil les prochaines activités de notre association, vous pourrez vous inscrire aux prochaines conférences, vous abonner aux flux RSS pour être tenu au courant des parutions d’offres d’emploi et bien d’autres choses encore !
De la nouveauté, de la variété et du concret, à l’image de notre profession en constante mutation, c’est aussi ce que vous propose le présent numéro des Cahiers de la Documentation.
Bonne lecture à tous !
Anne-Catherine DEMEULDER
Chercheur en botanique, contributeur et utilisateur de Wikipedia : Un défi à relever
Régine FABRI, Chercheur, Fédération Wallonie-Bruxelles, Jardin botanique national de Belgique
L’auteur apporte son témoignage de contributrice à Wikipedia. Elle évoque notamment la difficulté pour des scientifiques de ne pas pouvoir invoquer l’argument d’autorité face à des non spécialistes. Un sondage effectué au sein d’un échantillon de chercheurs en botanique révèle que tous les chercheurs interrogés utilisent Wikipedia; un quart seulement d’entre eux y ont déjà contribué, mais les trois quarts considèrent que cela pourrait faire partie des missions d’une institution scientifique. Enfin le profil des contributeurs en botanique est analysé. 12 % se présentent comme des spécialistes et c’est parmi eux que se trouvent les contributeurs les plus actifs. Les rôles des scientifiques et des non spécialistes s’avèrent complémentaires : la relecture par les seconds apportant le recul dont pourraient manquer les premiers tandis que les premiers enrichissent par leur expertise les contributions des seconds. En conclusion, le paradoxe que représente l’utilisation de Wikipedia par des chercheurs qui n’y contribuent guère est mis en évidence.
The Pisa Declaration: An Open Access Roadmap for Grey Literature
Dominic FARACE, GreyNet International, Grey Literature Network Service
À l’occasion de la proclamation de la Déclaration de Pise pour l’élaboration de politiques en faveur des ressources en littérature grise, l’auteur revient brièvement sur le processus d’élaboration de ce texte innovant et en récapitule les points principaux.
Déclaration de Pise pour l’élaboration de politiques en faveur des ressources en littérature grise
La littérature grise suédoise : Une mine de renseignements pour le chercheur en sciences sociales
Marie-Pierre RICHARD, Fonctionnaire territoriale chargée de mission, Docteure en science politique, Université de Lille 2 – Centre d’Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS)
Pour qui fait une recherche sur une thématique suédoise dans les sciences sociales la littérature grise est non seulement incontournable, mais essentielle. La Suède est en effet une terre d’élection de la littérature grise compte tenu du volume que celle-ci occupe, de sa qualité et de sa fiabilité ainsi que des conditions d’accès aisées qu’elle offre. Une des caractéristiques de la littérature grise suédoise est l’abondance des documents émis par les institutions politiques, administratives et sociales, nationales et locales, qui ont fait de la transparence un véritable dogme dans un pays où le citoyen dispose de droits étendus à l’information et détient d’importants pouvoirs de contrôle de la qualité du service public.
NUMÉRO SPÉCIAL
Inforum 2012
« Alt+0169 »: Copyright v. copywrong
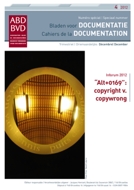 Éditorial
Éditorial
Le numéro des Cahiers de décembre devient petit à petit un classique consacré au dernier Inforum. Un autre grand classique est, telle une tirelire en ces temps de crise, le casse-tête auquel le coordinateur de cette journée d’étude est confronté en vue de faire surgir de son imagination quelques mots sensés pour cet édito.
Tout d’abord merci pour votre présence en masse, plus de 250 participants ont répondu à l’appel dont environ 85 % de membres de l’ABD-BVD. Différentes associations sœurs – tant de Belgique que de l’étranger – se sont également manifestées.
Pour l’organisation de la grand-messe de l’ABD-BVD, votre préférence dans un choix de date va plutôt vers la fin du mois de mai que fin avril. Veuillez donc d’ores et déjà noter dans vos agendas que l’Inforum 2013 se déroulera le jeudi 30 mai, à la Bibliothèque royale de Belgique, comme le veut la tradition.
Nous espérons bien évidemment que, en vue d’assister à cette journée, non seulement la date mais également le thème abordé récolteront vos faveurs. Un sujet, à priori pas évident, mais d’un intérêt certain pour un large éventail de métiers de l’I&D, représentés au sein de l’Association belge de Documentation. Notre inspiration provient, en premier lieu, des formulaires d’évaluation que vous remplissez après chaque Inforum. À côté de vos appréciations sur les différents intervenants et le déroulement de la journée, il vous est donné la possibilité de suggérer un thème pour l’Inforum suivant ou pour une de nos réunions mensuelles.
À l’issue de l’Inforum 2011, il s’est avéré que nombre d’entre vous marquait un intérêt pour approfondir la problématique du copyright, que ce soit de manière générale, dans un aspect en particulier, en rapport avec le segment professionnel dans lequel nous évoluons ou la logique en elle-même. Le problème, même si c’est un problème de luxe, est la grande variété au sein du copyright et ses différentes branches. Il nous fut donc difficile de nous limiter. En témoigne le nombre exceptionnel de huit orateurs qui sont venus en parler. À la lumière de l’influence qu’exerce l’Europe, il fut de notre devoir d’en inviter un représentant. Vraisemblablement nous avons mis la barre un peu haut en demandant un des commissaires responsables : Neelie Kroes, comme Commissaire européen chargé du calendrier numérique, ou Michel Barnier, responsable du marché intérieur. Suite à un échange de mails et de coups de fil, nous avons heureusement réussi à convaincre un collaborateur de la DG Marché intérieur de tenir une conférence. Ensuite, il y eut la veille de l’Inforum 2012, un moment de lobbying de l’IFLA et d’EBLIDA devant le Parlement européen, ce qui nous donna l’occasion idéale d’obtenir un résumé de première main. D’où l’intérêt d’avoir réuni huit orateurs autour de ce sujet intéressant.
Le copyright est une matière qui évolue constamment, d’où également le contenu des articles qui change par rapport à ce qui a été présenté le 31 mai 2012. Donnons quelques exemples. Le 27 octobre 2012 est paru dans le Journal Officiel de l’Union Européenne., la Directive 2012/28/EU du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant le l’utilisation des œuvres orphelines. Celle-ci est évoquée dans l’article qui s’y rapporte. La Commission continue bien évidemment ses investigations en la matière, d’où la demande de Pierre-Yves Andrau de pouvoir finaliser son texte plus tard.
Nous nous sommes, à présent, penchés sur de potentiels sujets avancés à la fin de l’Inforum 2012. Après avoir observé et discuté des différentes suggestions, nous avons décidé de dédier l’Inforum 2013 (le 30 mai donc) à l’ »information overload » : face à l’immense masse d’information numérique qui nous arrive via Internet, nous sentons-nous à l’aise face à ce phénomène, arrivons-nous à rester critique ou sommes-nous victimes de crises de panique ? En ce moment, nous partons activement à la recherche d’orateurs et les contactons dans l’espoir de vous présenter à nouveau, comme les précédentes années, un programme exceptionnel afin de vous revoir en nombre.
Il ne me reste plus qu’à remercier tout un chacun qui a contribué à faire de l’Inforum 2012 un moment passionnant : en premier lieu les orateurs, la Bibliothèque Royale de Belgique et son directeur général, Patrick Lefèvre, pour la location des facilités, le soutien logistique, les interprètes et les hôtesses, le service catering pour avoir séduit l’intérieur des participants et sans oublier le Conseil d’Administration de l’ABD-BVD pour la confiance qu’il nous a accordé dans l’organisation de cette journée.
Après la rédaction de cet édito, il ne nous reste plus que l’honneur de vous souhaiter une pétillante fin d’année au nom du Conseil d’Administration de l’ABD-BVD. Nous espérons que vous embrassez les fêtes de fin d’année dans une atmosphère détendue ; que ce soit l’occasion pour vous de mettre de côté vos soucis professionnels pour un moment. Bien évidemment, nous espérons vous revoir à l’Inforum 2013, de préférence comme membre de notre association. Mai 2013 se situe encore loin dans le temps mais il est inutile d’attendre jusque là pour se rencontrer, d’où l’importance d’attirer votre attention sur les réunions mensuelles que notre association organise régulièrement et où un thème actuel lié à notre profession est proposé. Une excellente fin d’année !!!
Marc VAN DEN BERGH
Web 2.0 : Nouveaux usages, nouveaux droits ?
Michèle BATTISTI, Responsable veille juridique, Association des Professionnels de l’Information et de la Documentation (ADBS)
Révision drastique ou simple évolution du droit d’auteur ? La question s’impose à l’heure où s’estompent les frontières entre les sphères privée et publique, les usages professionnels et non professionnels ou encore le jeu actif et passif des acteurs, remettant ainsi en question les qualifications juridiques traditionnelles. Comment réguler les tensions, particulièrement fortes en ce moment, entre la diffusion des connaissances et les modèles d’affaires, la liberté d’expression et les limites à apporter à certaines dérives ? Lois, contrats, usages : toute une panoplie de ressources juridiques peut être déployée pour faire émerger un droit 2.0 adapté à ce nouvel environnement.
A picture is worth a thousand words: Perikelen van portretrecht
Bert DEMARSIN, Docent, Hogeschool-Universiteit Brussel (HUBrussel); Vicedecaan, Hogeschool-Universiteit Brussel (HUBrussel) – Katholieke Universiteit Brussel (KUBrussel) – Faculteit Rechten; Geaffilieerd onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) – Centrum voor Rechtsmethodiek; Coördinator Art, Law & Management Research Programme, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
Cette contribution donne un bref aperçu du droit à l’image : une question juridique importante pour qui souhaite utiliser du matériel photographique (numérique) à des fins documentaires. En premier lieu, le droit à l’image est considéré comme un droit de la personnalité en tenant compte des récents développements au niveau international des droits de l’homme. L’exposé donnera ensuite des précisions sur les fondements du droit de la personnalité, sur le matériel photographique protégé par le droit à l’image et sur les titulaires jouissant de ce droit. En outre, l’auteur analyse le contenu de la protection offerte par le droit à l’image, les règles régissant les preuves de violation éventuelle ainsi que la prévention et la répression de telles infractions. Enfin, il commente la pratique contractuelle en termes d’exercice du droit à l’image.
De Europese Richtlijn verweesde werken: Gewikt, gewogen maar te licht bevonden
Joris DEENE, Advocaat, Docent en Juridisch adviseur, Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S)
La Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines (ci-après « la Directive ») a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 27 octobre 2012. L’objectif de cette directive est d’offrir une sécurité juridique à certaines organisations culturelles qui souhaitent numériser des œuvres orphelines et les mettre à disposition en ligne. La Directive repose sur une recherche diligente des titulaires de droits et une reconnaissance mutuelle par les États membres du statut d’œuvre orpheline. Dans cet article, l’auteur analyse la préhistoire de cette Directive, ainsi que son contenu. La conclusion est que la Directive, tant du point de vue du champ d’application que du contenu, n’atteint pas son objectif.
Le droit d’auteur et le droit sui generis sur les bases de données : Quinze ans plus tard : un succès ou un échec ?
Estelle DERCLAYE, Professor of Intellectual Property Law, University of Nottingham – School of Law
La directive harmonisant le droit d’auteur sur les bases de données et créant un nouveau droit (le droit sui generis) fut adoptée en 1996 et transposée dans les États membres de l’Union européenne en 1998. Cet article évalue, quinze ans plus tard, si elle fut un succès ou un échec. Cette directive confirma le statu quo en ce qui concerne le droit d’auteur pour les bases de données. Cependant, elle renforce le droit d’auteur des producteurs de base de données en ne prévoyant que peu d’exceptions et en admettant le cumul de protection avec d’autres droits similaires. Le droit sui generis souffre des mêmes défauts et de bien d’autres. En ce sens, la directive est plutôt un échec. Néanmoins, au fil des années, la Cour de justice de l’Union européenne réduisit quelques aspects surprotecteurs du droit sui generis et clarifia la notion d’originalité en droit d’auteur. En ce sens, l’harmonisation est un succès. Toutefois, le droit sui generis fut adopté sans études empiriques, et c’est avant tout ce qui manque encore aujourd’hui pour déterminer si son introduction était bien nécessaire.
Adapter le droit d’auteur à l’environnement numérique : Le rôle des associations de bibliothèques et d’EBLIDA
Vincent BONNET, Directeur, Bureau européen des Associations de Bibliothèques, d’Information et de Documentation (EBLIDA)
La montée en puissance des technologies de l’information et le développement d’Internet, combinés à l’accroissement de nouveaux usages, remettent en question la pérennité du système actuel de droit d’auteur. Dans ce contexte, les associations de bibliothèques ont un rôle important à jouer. Au niveau national, elles mènent un travail de fond et de proximité avec les élus. Dans les forums internationaux, elles assurent la représentation des bibliothèques. En Europe, le Bureau européen des Associations de Bibliothèques, d’Information et de Documentation (EBLIDA) assume cette mission en développant notamment une campagne sur les livres numériques en bibliothèques. À travers cette campagne, EBLIDA accompagne les représentants politiques dans leurs questionnements et ouvre le dialogue avec les organisations représentatives des intérêts des éditeurs et détenteurs de droit. Par ce processus, EBLIDA s’engage au bénéfice des citoyens européens pour leur assurer un accès libre à l’information et garantir la visibilité des bibliothèques sur l’agenda européen.
Compte rendu
Information for sustainable development in a digital environment: SCECSAL 2012 20th edition
Egbert de SMET, Projectcoördinator – academisch medewerker (ZAP) « Informatie- en Bibliotheekwetenschap » – Universiteit Antwerpen – Instituut Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW) – Departement Universiteit & Samenleving (U&S)
 Éditorial
Éditorial
Quel que soit notre âge, le mois de septembre reste toujours associé à la rentrée des classes. Difficile de l’ignorer : grandes surfaces et autres commerces nous rappellent dès le début du mois d’août, voire plus tôt, que ce grand moment approche…
Traditionnellement, c’est donc également le moment de publier les nouveaux dictionnaires, augmentés de nouveaux mots qui, d’après les Larousse, Van Dale et autres éditeurs spécialisés, sont entrés dans notre vocabulaire. Ces dernières années, les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent une part importante de ces nouveaux mots. Deux sites Web focalisent d’ailleurs toutes les attentions cette année : Facebook et Twitter. Il est vrai qu’à l’heure où les journaux font les gros titres sur un tweet de la Première dame de France et que certains hommes politiques mesurent leur popularité au travers de leur nombre d’amis sur Facebook, il serait malheureux qu’on ne puisse pas « tweeter » ou partager ses sentiments sur le « mur » de ses « amis » sans s’attirer les foudres des linguistes.
Il y a déjà quelques années, le verbe « googelen » apparaissait dans la langue néerlandaise, avec comme définition « chercher sur Internet », réduisant ainsi la recherche sur Internet à l’utilisation d’un moteur de recherche et pas n’importe lequel : Google. Si aucun équivalent ne s’est imposé dans la langue française, Twitter a pu imposer le verbe « twitter » ou « tweeter » dans le Petit Larousse 2013.
Mais le plus étonnant est certainement l’apparition de nouvelles significations pour des mots dont on croyait si bien connaître la définition. Ainsi, cette même édition du Larousse définit le mot « ami », comme un « membre d’un réseau social auquel un autre membre accorde l’accès à ses données personnelles ». Ou comment un site internet a influencé la signification d’un mot si ancien.
Dans cette optique, on peut suggérer aussi d’autres nouvelles définitions. « Chance (avoir de la) » signifierait « afficher directement le résultat le plus pertinent d’une recherche sur Internet ». « Statut » pourrait vouloir dire « commentaire transmis par le membre d’un réseau social à ses amis, dans le but d’informer, de partager ses sentiments ou simplement de faire sourire ». Et en y réfléchissant, vous trouverez certainement d’autres mots, d’autres définitions pour les prochaines éditions des dictionnaires. N’hésitez pas à les partager avec vos amis et collègues. Même si dans ces pages, vous ne trouverez malheureusement aucun bouton « Partager » ; le partage d’information faisant partie intégrante de la culture de notre profession et de notre association depuis 1947. Nous n’avons pas attendu les réseaux sociaux pour cela.
Pas besoin non plus de bouton pour les articles de ce numéro. C’est très simple, nous vous les recommandons… tous !
Guy DELSAUT
Het moet wèl ergens over gaan
John MACKENZIE OWEN, Emeritus hoogleraar informatiewetenschap, Universiteit van Amsterdam (UvA)
En 1983, l’auteur publiait un article d’opinion dans le périodique Open sous le titre : Het technologische einde van de bibliotheek. Le contenu : en raison des développements technologiques, la bibliothèque « physique » pourrait devenir superflue. L’auteur y revient dans son discours d’adieu, ici transposé en un article. Ces développements technologiques ont été bien plus importants que ce qui avait été prévu. Mais le comportement changeant des utilisateurs fut encore plus déterminant que la technologie : les compétences en information, qui étaient jadis des compétences professionnelles, sont maintenant des compétences générales. Une grande partie de la littérature scientifique ne se trouve plus dans les bibliothèques physiques mais quelque part dans le « cloud ». Les étudiants vont bien encore étudier ensemble dans les bibliothèques mais ils profitent encore à peine des publications qui y sont disponibles… L’auteur plaide également pour une base empirique solide de la recherche en sciences humaines et appelle les bibliothécaires à une présence plus appuyée dans le débat public sur la société de l’information.
Vers une nouvelle définition de la littérature grise
Joachim SCHÖPFEL, Maître de conférences, Université Lille Nord de France
L’article contient une synthèse des travaux sur le concept de la littérature grise, les résultats d’une enquête et une analyse de la définition de référence (définition de New York). Les nouvelles technologies et les nouveaux modes de diffusion sur le web posent un problème pour l’interprétation traditionnelle de la littérature grise. L’article discute trois nouveaux attributs (qualité, propriété intellectuelle, médiation) et propose une nouvelle définition (définition de Prague) qui ajoute ces nouveaux attributs à l’approche économique de l’ancienne définition. D’après cette nouvelle définition, la littérature grise correspond à tout type de document produit par le gouvernement, l’administration, l’enseignement et la recherche, le commerce et l’industrie, en format papier ou numérique, protégé par les droits de propriété intellectuelle, de qualité suffisante pour être collecté et conservé par une bibliothèque ou une archive institutionnelle, et qui n’est pas contrôlé par l’édition commerciale.
La division Bétons-Granulats de Lafarge stimule la transmission des bonnes pratiques
Laurent SOUNACK, Chef d’enquête, Collaboratif-info
Lafarge, leader mondial des matériaux de construction présent dans 21 pays, a mis en œuvre un programme de gestion des connaissances pour accroître le partage des bonnes pratiques. Ce programme a été lancé en 2005 et a pris une nouvelle dimension en 2011 lors du passage de IBM Domino à Knowledge Plaza, plate-forme collaborative de gestion de l’information. Les 12 000 documents déjà présents dans la base ont été importés dans Knowledge Plaza et les utilisateurs ont pu trouver plus facilement l’information présente et faire des recherches multilingues. Ce projet s’est accompagné d’un vaste plan de communication et de gestion du changement afin que chacun se rende compte de l’importance du partage de connaissances et soit intimement convaincu de son utilité.
Bibliografische ondernemingen rond 1900 (deel 2): De beweging als cultuurhistorisch verschijnsel
Paul SCHNEIDERS, Documentatiehistoricus op rust
Sur fond de mouvements qui déterminèrent la conjoncture de l’époque – le positivisme, l’essor des journaux et des revues, l’impérialisme, la seconde révolution industrielle et ses laboratoires, les influences américaines, l’intervention étatique, les deux cultures scientifiques et la mécanisation – émergent clairement des personnes, des activités et des projets au sein du mouvement bibliographique et documentaire en tant que phénomène historico-culturel. Dans le contexte belge apparaissent par exemple les visions de Ferdinand Vander Haegen et Michel-Félix Mourlon au sein de l’Académie des sciences de Belgique.
La numérisation des archives cinématographiques : Une nouvelle vie pour le patrimoine ?
Gabrielle CLAES, Conservateur (1989-2011), Cinémathèque royale
Vouées prioritairement à la conservation des films et à la valorisation du patrimoine cinématographique, les premières cinémathèques ont vu le jour dans les années 30. Pendant un siècle, les films furent réalisés et diffusés sur un support-pellicule, matière fragile et à terme périssable. Aux fins de leur conservation à long terme, les cinémathèques ont développé des techniques spécifiques dont l’efficacité est reconnue. À partir des années 90, les technologies numériques occupent une place grandissante dans la fabrication des films et dans leur diffusion, jusqu’à remplacer totalement la pellicule. Les cinémathèques doivent se doter désormais d’une expertise nouvelle (équipements, formation de personnel…) afin d’assurer au cinéma numérique une survie pérenne. En terme de connaissance et de diffusion du patrimoine cinématographique, les technologies numériques offrent des possibilités inédites, depuis le DVD jusqu’à l’internet. En concertation avec l’industrie du cinéma et les ayants droit des films, il s’agit aujourd’hui pour les cinémathèques de renforcer leur rôle en matière de conservation et de transmission du patrimoine cinématographique.
Compte rendu
Bibs & docs & marketing
Arnaud SEEUWS, Documentaliste, Centre Antipoisons
Compte rendu
Interopérabilité et enjeux actuels du records management
Valentin CAMPION, Étudiant, Master en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication – Université Libre de Bruxelles (ULB)
NUMÉRO SPÉCIAL
Sur les traces de…
Paul Otlet
 Éditorial
Éditorial
Comme vous le savez tous, chaque métier a son saint-patron. Les comptables ont donc saint Matthieu, les pâtissiers ont saint Honoré, les chasseurs ont saint Hubert, les mineurs ont sainte Barbe, les écoliers ont saint Nicolas, etc., etc. Vous en connaissez sûrement d’autres.
Et nous dans tout ça ? Qui donc est le saint-patron des bibliothécaires, documentalistes, archivistes, rangeurs de livres ou autres veilleurs ? Et bien, nous avons saint Paul ! L’apôtre ? Non, lui, à son époque, les bibliothèques devaient être aussi courantes que les trains qui circulent les jours de grève générale. Saint-Paul-de-Vence, peut-être ? Non, ça, c’est une ville ! Saint Paul Heyvaert, alors ? On se rapproche mais ce n’est pas à lui que je pensais. En fait, je voulais parler de Paul Otlet.
Vous me direz que, jusqu’à preuve du contraire, il n’a pas encore été canonisé et, à moins que Benoît XVI fasse des heures supplémentaires à la bibliothèque vaticane, il y a peu de chance qu’il en ait entendu parler. Admettons ! C’est vrai aussi que contrairement à son acolyte, Henri La Fontaine, il n’a même pas eu les honneurs du prix Nobel. Et pourtant, c’est son nom que les professionnels de l’info-doc ont surtout retenu.
Même si ce numéro des Cahiers ne va pas faire l’hagiographie de ce personnage, nous espérons quand même qu’il permettra au Vatican d’enfin s’intéresser à lui. On imagine déjà le président de l’ABD-BVD aux côtés des souverains, du Premier Ministre et des grands de ce monde lors de la béatification de Paul Otlet au Vatican.
Mais, assez déliré ! Avant de vous plonger dans les très intéressants articles que nous avons rassemblés pour vous, je vous invite à lire l’avant-propos rédigé par les deux initiateurs de ce numéro spécial, à savoir Christopher Boon et Dominique Vanpée, que je tiens à remercier pour tout le travail accompli. Et j’espère que, là-haut, Saint Paul vous en est reconnaissant également.
En attendant, je vous souhaite une très bonne lecture.
Guy DELSAUT
Avant-propos
Christopher BOON et Dominique J.B. VANPÉE, Membres du Comité de publication
Paul Otlet en het Mundaneum : Meer dan een papieren erfgoed…
Dominique J.B. VANPÉE, Lid van het Publicatiecomité van Bladen voor Documentatie, Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD)
Paul Otlet ne doit pas sa carrière qu’à ses origines. C’est par ses études et sa première expérience professionnelle qu’il aura trouvé sa muse dans la bibliographie. Celle-ci, mais aussi la catalographie, la documentation ainsi que la création d’associations et de musées ou encore l’utilisation de nouveaux artefacts spécifiques (fiche, catalogues à tiroirs, microfilms,…), l’auront rapproché de l’objectif de sa vie, le Mundaneum, édifié au rang de modèle conceptuel et contextuel.
Classer : de l’archive à l’action
Delphine GARDEY, Professeure ordinaire en histoire contemporaine; Vice-doyenne de la Faculté des Sciences économiques et sociales, Université de Genève
Les technologies du classement sont profondément transformées à la fin du 19e siècle, et ces transformations sont au cœur d’une révolution managériale qui réorganise profondément l’économie. Cet article essaie de caractériser au mieux l’existence d’un « ancien régime des gestes de classement ». Contemporain de la fiche cartonnée, le « document » fait son apparition ainsi que la documentation comme science nouvelle, faisant du livre un format dépassé. Pour une grande part – et au-delà des technologies du classement –, c’est par un travail d’organisation hygiénique et rationnel de l’espace que les capacités de traitement systématique de l’information opèrent.
Le texte intégral n’est pas disponible en ligne
Die Brücke : A German contemporary of the Institut International de Bibliographie
Markus KRAJEWSKI, Associate Professor of Media History, Bauhaus-Universität Weimar
Au cours du 19e siècle, l’utilisation permanente, et non plus occasionnelle, de fiches d’indexation pour le catalogage de grandes collections de livres s’est répandue dans les bibliothèques européennes avant de traverser l’océan Atlantique pour atteindre le nouveau monde. Cet article est consacré aux effets de cette technique de stockage (de l’information) lorsque les institutions se sont emparés de la connaissance de la méthode et de ses promesses (et surtout celle de standardisation universelle) pour imposer le catalogue sur fiches comme base indispensable de leur propre travail. Le cas précis de « Die Brücke » (« Le Pont ») est examiné : ce comité allemand, ne se référant non pas à des transferts d’information transatlantiques ou transeuropéens, mais bien à des échanges mondiaux entre centres d’activité scientifique, avait pour objectif d’établir des connexions entre des îlots de savoir et de collecter l’information bibliographique relative aux éléments dispersés des sources mêmes du travail intellectuel.
Les réalités d’une aventure documentaire
Stéphanie MANFROID, Responsable des archives, Mundaneum
L’histoire du Mundaneum, ou plutôt de l’Office International de Bibliographie, a généré une littérature abondante depuis son apparition en 1895. La Classification Décimale Universelle (CDU) a fort logiquement focalisé l’attention des professionnels du secteur de l’information, de la documentation et de la communication. On connaît plus rarement l’étendue des collections que la CDU a permis de développer. Le centre d’archives actuel préserve avec enthousiasme cet héritage multiple composé d’archives et de collections particulières. Cet aperçu permet de mieux cerner cette réalité patrimoniale.
Bibliografische ondernemingen rond 1900 (deel 1): Eenheid in verscheidenheid
Paul SCHNEIDERS, Documentatiehistoricus op rust
Les mouvements bibliographique et documentaire forment une unité dans la diversité, entre autres du fait d’un appareil terminologique qui peut donner lieu à des acceptations différentes. Leur enchevêtrement s’exprima par un changement brusque, autour de 1900, qui se joua sur le terrain de la fourniture d’information formelle et scientifique. Nous aborderons ici la question des problèmes terminologiques, la chronologie du mouvement ainsi que les relations au sein du mouvement bibliographico-documentaire. Les méthodes modifiées dans la pratique scientifique, les nouveaux supports d’information, les nouveaux terrains de la recherche et une nouvelle politique, tant de la part des autorités que dans la vie d’entreprise, donnèrent naissance à ce mouvement. Nous l’examinerons à la lumière de la « théorie de l’échec » et de la bibliothèque spécialisée.
Une nouvelle édition abrégée de la Classification Décimale Universelle
Benjamin PEIFFER, Membre de l’Universal Decimal Classification Advisory Board; Bibliothécaire, Bibliothèque Chiroux (Province de Liège); Lauréat du Prix ABD 2011
La huitième édition abrégée de la Classification Décimale Universelle (CDU) en français est disponible. De nouveaux sujets y ont été ajoutés et l’index a été largement complété. Un travail de fin d’études, récompensé par le prix ABD-BVD 2011, a préparé la mise à jour de cette édition en collaboration avec l’Universal Decimal Classification Consortium (UDCC). Ce travail avait pour but d’augmenter l’édition suivante et de l’améliorer par une révision de la sélection des références et par un enrichissement en notes et exemples. L’avis de professionnels a également été recueilli à cet effet. Ce travail de mise à jour a coïncidé avec le projet de mise en ligne d’un résumé de la CDU. Il s’agit de l’UDC Summary réalisé parallèlement au travail sur l’édition abrégée. La sélection des indices et la vérification des traductions constitué les tâches les plus minutieuses et les plus ardues de la mise à jour.
Hubris or Utopia? : Megalomania and imagination in the work of Paul Otlet
Wouter VAN ACKER, Doctor-assistent, Universiteit Gent – Vakgroep Architectuur & Stedenbouw
Le documentaliste et internationaliste Paul Otlet (1868-1944) est décrit par différents auteurs et commissaires d’expositions comme un penseur utopiste et visionnaire. À son époque également, Otlet fut souvent critiqué du fait de sa mégalomanie. Cet article confirme l’ »hybris » dans son caractère, mais fournit également une interprétation nouvelle et plus positive de son utopisme. Dans cette interprétation, l’accent est mis sur le caractère anticipatif et organisé de l’imagination d’Otlet, qui lui permit d’explorer de nouvelles possibilités d’organiser la connaissance.
Paul Otlet dans l’histoire de la bibliologie
Robert ESTIVALS, Professeur émérite, Université de Bordeaux 3; Professeur Honoris Causa – Association Internationale de Bibliologie (AIB)
La démarche de Paul Otlet peut se lire à travers différents angles de la bibliologie actuelle. L’auteur présente dans cet article sa position sur Paul Otlet et son influence dans l’histoire de la bibliologie. Il y aborde un certain nombre de questions. Comment Otlet ouvre-t-il la voie de la documentologie en tant que précurseur des sciences de l’information et de la communication ? Quelle est la nature de ses relations avec certains de ses contemporains, tel que Roubakine, fondateur de la bibliologie psychologique, ou Röthlisberger, fondateur de l’histoire cyclique internationale de la production des imprimés ? … et de certains de ses précurseurs dont Peignot, Namur, Hesse, Brunet dans son œuvre bibliologique ?
Paul Otlet, an encounter
Warden Boyd RAYWARD, Emeritus professor, University of Illinois – School of Library and Information Science and University of New South Wales – School of Information Systems, Technology and Management
L’auteur décrit comment il s’est intéressé à Paul Otlet et raconte quelques-unes de ses propres recherches et publications sur la vie et le travail d’Otlet comme pionnier du développement des idées sur la société moderne de l’information. Il discute aussi de l’importance des collections et du personnel du « nouveau » Mundaneum, musée-archives créé à Mons avec le soutien de la Communauté française de Belgique, insistant sur le potentiel de leur nouvelle coopération avec Google.
Filmer Paul Otlet
Françoise LEVIE, Cinéaste – Biographe
En 2000, l’auteur, Françoise Levie, réalise un film documentaire sur Paul Otlet intitulé L’Homme qui voulait classer le Monde. Dans cet article, elle raconte comment naquit l’idée du film, comment fut construit le scénario à partir du contenu anarchique d’une centaine de caisses à bananes et les découvertes majeures qui en découlèrent. Elle relate également quelques anecdotes des derniers témoins qu’elle a pu rencontrer. Depuis, le film a fait le tour du monde dans les universités spécialisées dans les sciences de l’information et remporta de nombreux prix.
ABD-BVD in de archieven van Georges Lorphèvre in het Mundaneum te Bergen: De Belgische Vereniging voor Documentatie geïnitieerd door Paul Otlet
Jacques HENRARD, Lid van het Publicatiecomité van de Bladen voor Documentatie, Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD)
Dominique J.B. VANPÉE, Lid van het Publicatiecomité van de Bladen voor Documentatie, Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD)
À Mons, le Mundaneum conserve de nombreuses archives. C’est ainsi qu’il dispose aussi d’un certain nombre d’entre elles léguées par Georges Lorphèvre, qui fut non seulement le secrétaire de Paul Otlet, mais devint également le premier secrétaire général de l’Association Belge de Documentation (ABD-BVD). Dans ces archives, nous sommes allés à la recherche des origines de l’ABD-BVD. Nous avons constaté que déjà en 1945 – soit quelques années avant la publication officielle des statuts de l’ABD-BVD au Moniteur Belge, laquelle eut lieu en 1947 – une association avait été fondée et que celle-ci avait succédé à une autre, créée dès 1943 par Paul Otlet lui-même sous l’appellation de Commission Belge de Classification et de Documentation.
Il y a 10 ans disparaissait la FID (1895-2002)… Ou l’internationalisme associatif au service de la communauté de l’I&D
Christopher BOON, Documentaliste juridique
Au même titre que le Répertoire bibliographique universel ou la Classification Décimale Universelle, l’Institut International de Bibliographie, qui deviendra finalement la Fédération Internationale d’Information et de Documentation (FID), a été un des piliers de l’organisation bibliographique mondiale rêvée par ses créateurs, Paul Otlet et Henri La Fontaine. L’article se veut un bref regard en arrière sur quelques péripéties de cette association. Il y sera question de quelques étapes historiques importantes, du rôle primordial assuré par les associations internationales dans la réalisation d’une communauté de professionnels de la documentation, et des raisons qui ont conduit au déclin et à la disparition de la FID.
Let’s DICE : Bibliothèque numérique, apprentissage automatique et interface 3D
Éric BRIYS, Co-fondateur, Cyberlibris et Professeur-Associé, Ceregmia – Université des Antilles et de la Guyane
Richard NOCK, Ceregmia – Université des Antilles et de la Guyane
Toute bibliothèque est un tribut à la géométrie. Une bibliothèque municipale est ordonnée selon les principes de la géométrie euclidienne. Les étagères y sont parallèles. Les livres y sont rangés par les bibliothécaires en fonction de leurs métadonnées thématiques. À angle droit avec les étagères sur lesquelles ils reposent, ils attendent patiemment d’être lus. Cette géométrie soignée est fort pratique. Elle facilite nos déambulations et nos découvertes. Mais qu’en est-il d’une bibliothèque numérique ? À quelle géométrie obéit-elle ? En quoi la découverte de cette géométrie intime permet-elle d’envisager de nouvelles pratiques bibliothécaires, de nouveaux modes de découvertes des livres ? Nous montrons dans cet article qu’une bibliothèque numérique est gouvernée par la géométrie non-euclidienne. Cette nouvelle géométrie est à la base même de nouvelles techniques d’apprentissage automatique et de nouvelles interfaces de recherche dont nous montrons les nombreuses applications possibles.
 Éditorial
Éditorial
En décembre dernier, nous vous avions proposé un numéro spécial consacré à l’Inforum 2011. Par cette tradition de transformer en articles les présentations de notre journée d’étude annuelle, nous voulons montrer notre attachement à faire écho dans nos pages des autres activités de l’ABD-BVD.
Comme vous l’aurez certainement remarqué, il n’est, en effet, pas rare qu’un article fasse également référence à une conférence donnée dans le cadre de nos réunions mensuelles. Cet exercice permet aux membres, qui n’ont pas toujours l’occasion d’assister à nos manifestations, de pouvoir rester informés du sujet traité. Pour le présent numéro, un jeune professionnel nous a écrit deux comptes rendus des réunions mensuelles de la fin de l’année 2011, l’un portant sur le livre électronique et l’autre sur la curation. Vous les trouverez en fin de publication.
En parlant de jeunes professionnels, une autre activité de notre association s’adresse particulièrement à eux : c’est notre traditionnel Prix ABD. Parmi les candidats de son édition 2011, le jury avait noté plusieurs travaux qui, même s’ils n’ont pas décroché le prix (il faut bien choisir), étaient de qualité suffisante pour que l’on puisse imaginer que leurs auteurs soient invités à en résumer les points forts dans un article pour les Cahiers de documentation. Vous retrouverez les articles de deux jeunes auteurs dans ce numéro.
Cette édition est donc placée en grande partie sous le signe des interconnexions entre les activités de notre association. Nous espérons ainsi pouvoir vous rencontrer lors de nos réunions mensuelles ou de l’Inforum, le 31 mai prochain à la Bibliothèque royale de Belgique -pendant lequel sera d’ailleurs remis le Prix ABD 2012.
Un mois plus tard, en juin, les Cahiers vous emmèneront sur les pas de Paul Otlet mais ceci est une autre histoire. En attendant, nous vous souhaitons une excellente lecture.
Guy DELSAUT
L’EAHIL fêtera ses 25 ans à Bruxelles lors de son 13e Congrès
Patrice X. CHALON, Knowledge Manager, Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE)
Ghislaine DECLÈVE, Directeur de la Bibliothèque des Sciences de la Santé, Université catholique de Louvain (UCL) – Bibliothèque des Sciences de la Santé
L’Association Européenne pour l’Information et les Bibliothèques de Santé (European Association for Health Information and Libraries – EAHIL) regroupe plus de 1400 membres issus de 25 pays. Cette association fut fondée en 1987, suite à un premier congrès qui réunit 300 bibliothécaires européens de la santé dans la capitale européenne une année auparavant. Congrès et colloques sont en effet les activités phares de cette association qui revient en Belgique ce mois de juillet pour fêter son 25e anniversaire. L’occasion pour nous de nous repencher sur sa création et ses activités.
La veille spécifique des sites Web : Une méthodologie d’approche pour un retour sur investissement en ligne gagnant !
Denis LAVERDISSE, Business Analyst Risque de crédit, BNP Paribas
Cet article propose une synthèse de l’ensemble des méthodes mises à disposition des gestionnaires de site Web afin de surveiller leur activité en ligne et de dégager des données-clés. Celles-ci permettront d’optimaliser les performances d’un site, c’est à dire de déterminer les actions à prendre pour que les internautes réalisent les actions souhaitées par le gestionnaire du site. Dans cet article, il est également question de placer dans un cadre conceptuel et global, les concepts de « Web metrics », de « Web analytics » ou encore d’ »utilisabilité ». Ces termes, nous les intégrons dans un concept que nous avons nommé : « Veille spécifique d’un site Web ». Celui-ci est le processus complet de récolte, de mesure, d’analyse, de présentation, et d’optimisation des données issues d’un site Web et de son environnement.
Les sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC) : Spécificités disciplinaires et scientifiques
Jonathan EHRENFELD SOLÉ, Assistant de cours, Université libre de Bruxelles (ULB) – Département de l’Information et de la Communication
À travers une analyse transversale cet article se concentrera sur les questions que les sciences de l’information et de la communication (SIC), en tant que discipline universitaire, permettent de traiter. Cette approche permet de définir les SIC selon les problèmes qu’elles se posent, la façon de les poser au regard d’autres disciplines connexes et leur dépendance des nouvelles technologies. Néanmoins, la profusion d’analyses déployées par les chercheurs pour tenter de définir les SIC met en évidence des formulations dont la construction repose sur un flou terminologique. Ainsi les concepts et modèles proposés ici sont justifiés par leur adéquation avec le contexte de ce travail et ne proposent qu’un panorama du champ disciplinaire afin de montrer ce que les SIC recouvrent aujourd’hui.
Netwerk van managers van informatie centra (NIC): Van projectontwikkelaar tot discussiegroep
Charles L. CITROEN, Voormalige Secretaris (1973-2008), Netwerk van managers van Informatie Centra (NIC)
Le Netwerk van managers van Informatie Centra (NIC) est une association de managers néerlandais de l’information responsables de la gestion de l’information au sein de leur organisation. À l’origine, en 1973, le NIC a été créé pour permettre l’accès en Europe aux fichiers en ligne des Chemical Abstracts. Après la disparition de cette raison d’être, l’organisation a cependant décidé de perdurer avec un nouvel objectif : le partage et l’échange de connaissance et d’informations relatives aux processus internes d’information des différentes organisations. Il devint ainsi possible de confronter des processus semblables à l’expérience de l’un ou de l’autre. La composition de l’ensemble des membres évolue régulièrement suite à des réorganisations. L’association compte actuellement 14 membres issus du monde des entreprises, du (semi) public et d’institutions d’enseignement.
Doc en stock
Library of the von Karman Institute for Fluid Dynamics : 55 ans dans le vent et les turbines
Christopher BOON, Membre du Comité de publication des Cahiers de la Documentation, Association Belge de Documentation (ABD-BVD)
Cet article traite de la bibliothèque/centre de documentation scientifique et technique de l’Institut von Karman de Dynamique des Fluides (VKI), fondé en 1956, et qui possède des collections spécialisées en matière de mécanique des fluides, de recherche en aéronautique, aérospatiale et propulsion.
Compte rendu
E-books – Nouvelles pratiques, nouveaux usages : et nous ?
Arnaud SEEUWS, Documentaliste, Centre Antipoisons
Compte rendu
La curation – Vieille lune ? Nouveaux outils
Arnaud SEEUWS, Documentaliste, Centre Antipoisons
 Éditorial
Éditorial
L’année 2009 s’achève et c’est l’occasion de regarder quelque peu en arrière. Notre association poursuit sans relâche ses missions avec un rythme toujours croissant et une certaine satisfaction par rapport au travail réalisé. Cette année écoulée aura été riche en manifestations et évènements qui ont permis aux membres de se rencontrer, d’échanger leurs pratiques et de se tenir au courant des évolutions constantes de notre profession. En effet nous leur avons proposé durant cette année neuf réunions mensuelles aux sujets variés et notre incontournable Inforum en avril 2009 a rassemblé pas moins de 179 participants. Nous tenons également à offrir à nos membres le fruit de la veille professionnelle et le résultat des recherches en Belgique ou à l’étranger à travers nos publications : l’ABD-Info et nos Cahiers.
Parmi nos activités, il ne faut pas oublier le Prix ABD qui, chaque année, récompense un travail de fin d’études inédit en sciences de l’information et de la documentation. Le concours est accessible aux diplômés de l’enseignement supérieur ayant présenté leur mémoire au cours de l’année académique précédente.
Créé en 1987 puis interrompu pendant quelques années, c’est en 1997 que Marc Vandeur, maître de conférence à l’ULB, lui donne sa forme actuelle. C’est en 2003 que je reprends l’organisation annuelle du Prix dont je m’occupe toujours à ce jour. Marc Vandeur et moi-même avons toujours été particulièrement sensibles à l’importance de la promotion du travail des jeunes diplômés puisque nous sommes tous deux enseignants et que nous avons obtenu tous deux ce prix en 1987 et 1989. Nous estimons que les diplômés d’aujourd’hui feront les professionnels de demain, d’où l’importance de les mettre à l’honneur.
En novembre 2008, trois jeunes diplômés nous ont proposé le fruit de leur travail. La qualité des travaux était assez remarquable et le jury a eu beaucoup de difficulté à élire un seul de ces travaux. Après plusieurs lectures et réunions d’évaluation, les membres du jury ne sont pas parvenus à départager deux candidats et ont alors décidé d’octroyer le prix ex-æquo. Il s’agit de deux diplômés de la Haute École de Namur, Isabelle Debrichy et Thomas Bihay. Nous sommes très heureux de vous présenter dans ce présent numéro un résumé et un avant-goût du fruit de leurs recherches.
Pour poursuivre, Dominique Vanpée nous sensibilise à la fiabilité des informations sur Internet à l’heure où l’on peut trouver tout et n’importe quoi sur le web.
Pour compléter ces lectures, vous trouverez un article d’Antonin Benoît Diouf sur la normalisation de la description des ressources électroniques. Enfin, un article original présentant le processus EBLIP qui permet d’améliorer la pratique dans les bibliothèques et les services d’information en confrontant les meilleures preuves et idées disponibles dérivées d’une expérience professionnelle.
Au nom du comité des publications, je vous souhaite une excellente lecture et une très belle année 2010.
Isabelle SOMVILLE-CORNET
Analyse et mise à jour d’un répertoire spécialisé en ligne : Pistes d’amélioration
Thomas BIHAY, Lauréat du Prix ABD-BVD 2009 ; Étudiant en Information et Communication, Université catholique de Louvain (UCL)
Les répertoires de sites spécialisés occupent, à l’heure actuelle, une grande importance dans la recherche d’information. Afin de les maintenir à jour, qu’ils évoluent et qu’ils s’adaptent aux nouvelles technologies du Web, une évaluation fréquente est nécessaire. Afin de la mettre en oeuvre, il est essentiel de mettre en place une méthodologie et des critères d’évaluation pertinents. La méthodologie et les critères sélectionnés dans cet article ont été mis en place afin d’analyser et de réaliser une étude sur le répertoire du portail EchosDoc. Cet article est divisé en quatre chapitres principaux. Le premier offre une réflexion sur l’importance des répertoires spécialisés dans notre société. Le deuxième explique les choix qui ont précédé la mise en place de la méthodologie utilisée pour l’étude et le troisième les choix des différents critères et étapes pris en compte lors de la réalisation de celle-ci. Enfin, le quatrième chapitre offre une dernière réflexion sur les possibilités qui pourraient être mises en place à l’aide de différents types de logiciel.
Quelques outils qualité au service de la bibliothéconomie…
Isabelle DEBRICHY, Lauréate du Prix ABD-BVD 2009 ; Collaboratrice au Cabinet de Philippe Henry, Ministre wallon en charge de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
Dans le domaine de la qualité, aucun centre de documentation accessible à tous n’existe en Belgique. Le Mouvement Wallon pour la Qualité (MWQ), se voulant être l’organe de référence en matière de gestion totale de la Qualité en Région wallonne, désire offrir à chacun le droit à l’information dans cette thématique. L’objet du travail de fin d’études de l’auteur a été de contribuer à la mise en place concrète d’un centre de documentation ainsi que la mise en route d’un système de gestion documentaire au sein du MWQ. Implantation matérielle, inventaire des documents existants, élagage, choix et installation du système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) PMB, élaboration d’outils bibliothéconomiques d’indexation : liste d’autorité et plan de classement, catalogage, équipement et rangement constituent l’essentiel de ce projet qui a été mené avec l’aide de certains outils et méthodes empruntés au domaine de la qualité.
Gegevens en informatie op het internet – Wat met « waarheid », « werkelijkheid » en « vertrouwen »?: Een aanzet tot literatuurstudie
Dominique J.B. VANPÉE, Thesaurusbeheerder, Antigifcentrum
Dans ce court article, nous traitons, à travers la litérature récente, de la qualité des données et de l’information sur Internet, alors que nous considérons maintenant que la connexion à Internet est un droit fondamental pour pouvoir accéder à cette information et la communiquer. Car tout ne dépend-il pas de la confiance que nous accordons à l’information et les données que nous trouvons sur Internet ?
Normes et standards pour la description et l’accès aux ressources électroniques dans les bibliothèques : Approche classique et « moderne »
Antonin Benoît DIOUF, Chef du Service Acquisitions-Traitement, Université Gaston Berger – Bibliothèque centrale
Le traitement documentaire dans les bibliothèques obéit à une réglementation sous forme de normes. Classiquement les règles de description bibliographique étaient édictées et ne s’appliquaient en général que pour les documents imprimés. Avec l’apparition des documents sur support numérique, ces normes se sont très vite retrouvées inefficaces : comment pouvaient-elles en même temps décrire et rendre accessibles des publications qui n’étaient pas localisables physiquement comme les imprimés ? Il fallait donc imaginer d’autres règles de description et d’accès pour ces types de documents. Cet article se propose d’exposer les différentes initiatives qui ont été prises pour résoudre ce problème.
EBLIP – Evidence-based library and information practice : Un paradigme à explorer
Ghislaine DECLÈVE, Directeur de la bibliothèque de médecine, Université catholique de Louvain (UCL) – Bibliothèque de médecine
La médecine factuelle engage les professionnels de la santé à prendre des décisions fondées sur des faits pertinents, documentés et connus. L’EBLIP (evidence-based library and information practice) s’est constituée sur cette base et vise à équiper les professionnels de l’information d’outils méthodologiques adéquats pour mener une re-cherche de qualité dont les résultats serviront de base à une prise de décision en gestion de l’information et de la documentation ainsi qu’à alimenter d’autres recherches. Cet article est une synthèse narrative qui introduit au paradigme de l’EBLIP, en présente la courte histoire, les définitions, la méthodologie et l’évolution. Il conclut que le paradigme EBLIP évolue actuellement d’un modèle dérivé purement de la médecine factuelle vers un autre plus complexe, enrichi tant par la pratique professionnelle que par des courants issus des sciences humaines.
NUMÉRO SPÉCIAL
Inforum 2009
I&D: It’s all about people
 Éditorial
Éditorial
Depuis de nombreuses années déjà, nous avions le projet de mettre les articles des Cahiers de la documentation en accès libre sur notre site, un an après leur publication sur papier. C’est aujourd’hui devenu réalité !
En effet, depuis quelques jours, vous pouvez lire ou relire, sur notre site, les articles publiés dans nos pages depuis l’année 1999 jusqu’au n° 3 de l’année 2008. À chaque parution d’un nouveau numéro sur papier, nos archives en ligne seront également enrichies d’un nouveau numéro.
Nous avons profité également de ce nouveau service pour revoir quelque peu la section du site consacrée aux Cahiers, en la rendant plus logique, plus cohérente, plus… oserions-nous dire… plus parfaite.
Un outil de recherche a également été ajouté afin de faciliter la recherche dans les articles en ligne.
Cette mise à disposition n’a pu être possible qu’avec l’accord des auteurs et nous tenons à les en remercier. Certains n’ont malgré tout pas pu être contactés. Si l’un d’eux ne souhaite pas que son article soit disponible sur Internet, il peut nous contacter et nous le retirerons de notre site.
Comme vous le voyez et nos fidèles membres le savent bien, le conseil d’administration de l’ABD-BVD essaie le plus possible de suivre l’évolution de notre métier ou même de la devancer, le plus souvent possible de se renouveler et le moins possible de se répéter dans les sujets traités dans les Cahiers de la documentation, les thèmes des réunions mensuelles ou des Inforum ou dans les orateurs invités.
Une petite nouveauté, presque inutile à mentionner, s’est également produite lors de l’Inforum 2009. Pour la première fois, notre journée d’étude annuelle a été organisée sous un titre unique : I&D: it’s all about people. Ce titre n’a pas été choisi par hasard. Nous, professionnels, savions naturellement cela depuis longtemps mais nous souhaitions encore mettre cette idée sous les projecteurs. Selon les formulaires d’évaluation des précédents Inforum, nos membres étaient demandeurs de sujets touchant plus aux aspects humains que technologiques. Nous avons tenté de les regrouper comme thème de notre dernier Inforum. L’information, dans notre secteur, est évidement un aspect sérieux, nous en sommes tous convaincus, mais nous oublions souvent que la diffusion de la bonne information à l’utilisateur dépend, pour une grande part, d’une question bien posée et de l’interaction entre le fournisseur et le demandeur. La satisfaction en est l’élément essentiel. Dans une période où la formation continue doit se dérouler tout au long de la vie, de nécessaires formations devront contribuer à l’amélioration du service. Un service qui pourra compter sur les réseaux nécessaires nous permettra de trouver l’information adéquate. Comme nous les disions lors de l’Inforum 2009 : « It’s all about people » et cela vaut tant du côté de l’offre que de la demande.
À peine une édition de l’Inforum est-elle terminée que l’on pense déjà à l’édition suivante. L’inspiration pour les sujets potentiels est trouvée, comme nous l’avons déjà mentionné, dans les formulaires d’évaluation. De là, il est apparu que vous souhaitez un Inforum plus orienté sur la pratique quotidienne. C’est pourquoi, encore une fois ici, nous innovons. La préparation des Inforum précédents était toujours l’activité d’un groupe de travail, au sein de l’ABD-BVD, dont les membres tentaient de trouver un sujet et partaient chercher des orateurs renommés ou, inversement, quelqu’un connaissait le spécialiste d’un sujet particulier et la journée d’étude se construisait autour de cela.
Pour encore mieux rencontrer les souhaits de nos membres, nous pensons organiser un échange d’expériences, bien construit autour d’un thème central. Nous pensons à un échange d’idées autour de l’importance de l’information, du centre d’information et des professionnels de l’I&D : les initiatives qui ont été prises pour promouvoir la visibilité au sein de l’organisation ou même en dehors, la réalisation de valeur ajoutée par les fournisseurs de services auprès des utilisateurs ou même comment devenir indispensable à l’organisation. Un sujet qu’on peut rattacher à celui de 2009.
C’est la deuxième année consécutive que nous publions ici un numéro spécial consacré au dernier Inforum, pour lequel les orateurs ont accepté d’encore une fois exposer leur position dans un article. Nous voudrions remercier chacun d’eux pour l’effort, qu’il ne faut surtout pas sous-estimer, d’avoir encore rédigé un texte en plus de la préparation de leur exposé. N’oublions pas non plus de remercier la Bibliothèque royale de Belgique, non seulement pour l’infrastructure mise à notre disposition pour nos Inforum mais également pour le message qui ouvre traditionnellement cette journée, ainsi que les sponsors sans qui tout cela ne serait pas possible.
Il nous reste encore à vous souhaiter une agréable lecture et surtout n’oubliez pas : l’Inforum 2010 est programmé le jeudi 29 avril 2010. Vous trouverez certainement encore une petite place dans vos agendas pour noter cette date.
Marc VAN DEN BERGH et Guy DELSAUT
Profitez-en ! / Geniet ervan!
Discours d’introduction de Vincent MAES, Président, Association Belge de Documentation
Les négociations informationnelles : Face à face et/ou électronique
Yves-François LE COADIC, Professeur émérite de science de l’information, Conservatoire National des Arts et Métiers
La satisfaction du besoin d’information de leurs usagers constitue l’alpha et l’oméga des professionnels de l’information et de la documentation. Pour l’atteindre, une difficile négociation doit s’effectuer. On l’étudiera pas à pas à travers l’analyse des interactions informationnelles des usagers avec les documentalistes-bibliothécaires (f-négociation) et/ou avec les systèmes électroniques d’information (e-négociation). La première forme de négociation est un des actes de communication humaine les plus complexes. Les recherches sur les usages et les usagers de l’information ont contribué à mieux la connaître. La deuxième forme de négociation qui connaît un développement important amène à l’invention de nouvelles structures de dialogue. Dans les deux cas, des formations à ces négociations sont nécessaires et devraient être intégrées dans les cursus professionnels.
Regards sur la satisfaction des usagers
René PATESSON, Professeur, Université Libre de Bruxelles, Centre de Psychosociologie de l’Opinion (CPSO)
La satisfaction des usagers paraît être la mesure de la perception de la qualité et de la pertinence des actions menées pour eux ainsi que du bien-être qu’ils ressentent dans leurs rapports avec l’organisation. Mais est-ce aussi simple qu’il y paraît ? Le développement des études de satisfaction est à mettre en relation avec différents déterminants du fonctionnement de base de l’organisation, voire de son existence. Elle prend place dans les tableaux de bord de sa gestion et devient un critère d’évaluation de son fonctionnement interne avec les conséquences qui peuvent en découler. La mesure de la satisfaction soulève généralement de nombreuses questions sur la structure et l’activité même de l’entité qui sera évaluée, pour en construire – dans le questionnaire – une représentation acceptable à soumettre aux interviewés dont les résultats seront admis par l’organisation. Elle pose également des problèmes méthodologiques, en particulier dans l’usage des questionnaires. Elle nécessite également un regard attentif sur les réactions possibles des interviewés et leur maîtrise. Un dernier exemple en guise de conclusion montre que la mesure de la satisfaction des services d’une bibliothèque publique amène à se poser des questions sur l’évolution même de la notion de bibliothèque.
Social networking as a business information tool
Arthur WEISS, Managing Partner, Aware
La visibilité des sites Web dédiés aux relations entre les individus (les réseaux sociaux) s’est fortement accrue ces dernières années. Bien que les plus connus de ces sites – MySpace et Facebook – soient à l’origine simplement destinés à des échanges grand public, certains d’entre eux ont un but commercial et peuvent servir à des relations d’affaires et à différentes applications commerciales, telles que l’intelligence économique, la chasse aux cadres ou la recherche d’expertises. Le souci pour certains de proposer une information détaillée sur leur profil a facilité cette évolution, malgré les risques d’intrusion dans leur vie privée.
Spoetnik: Een online cursus web 2.0 voor bibliotheekmedewerkers
Alice DOEK, Hoofd Informatiediensten, Bibliotheek Universiteit van Amsterdam
Une formation en ligne sur les nouvelles applications du web a été organisée en 2008 à la bibliothèque de l’université d’Amsterdam. Les collaborateurs de la bibliothèque ont ainsi acquis la connaissance et l’expérience pratiques du web 2.0, et ont réfléchi à la manière de l’appliquer dans leur travail. Sous le nom de Spoetnik, le cours était basé sur le concept existant 23things. Quelques dizaines de collaborateurs ont suivi entièrement Spoetnik et se sont montré enthousiastes par sa forme et son contenu. Grâce à ce cours, de services basés sur le web 2.0. ont pu être développés à la bibliothèque. Trois autres bibliothèques universitaires aux Pays-Bas imitent la formation Spoetnik. L’article envisage les facteurs de succès.
Apprendre à apprendre : Maîtrise de l’information et apprentissage tout au long de la vie
Abdelaziz ABID, Consultant, Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO)
Jacques HENRARD, Membre du Comité de publication des Cahiers de la documentation, Association Belge de Documentation (ABD-BVD)
Tout au long de la vie, plus on apprend et plus on connaît, mais surtout plus vite on maîtrise et acquiert des capacités, habitudes et attitudes d’apprentissage efficaces plus on maîtrise l’information. L’aptitude à utiliser ces capacités, habitudes et attitudes permet de prendre des décisions judicieuses sur les plans personnel et familial comme sur les plans de la santé et du bien-être, de l’éducation, de la citoyenneté et de l’emploi. La formation à la maîtrise de l’information constitue une compétence clé dans l’environnement changeant et compétitif du 21e siècle. Elle constitue le socle des sociétés du savoir que l’UNESCO promeut depuis le Sommet mondial sur la société de l’information.
