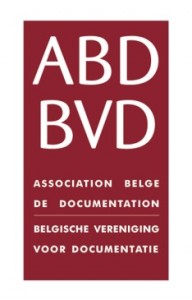Décembre 2011 - La curation : V(i)eille lune ? Nouveaux outils ?
Curation : Convergence des tendances de sélection, organisation et mise à disposition de l’information
par Fabienne Vandekerkove, Chief Knowledge Officer, Knowledge Plaza, et Grégory Culpin, Business Developper, Knowledge Plaza
Curation : prendre le train en marche ou le regarder passer ?
par Pierre-Yves Debliquy, Fondateur de Brainsfeed
Le concept de curation (ou la sélection des contenus en ligne les plus pertinents, leur mise en valeur et leur partage) fait débat. S’agit-il d’une nouvelle approche, de nouveaux outils, de nouvelles demandes de la part de nos utilisateurs, d’un nouveau métier ? Ou d’un nouveau terme “à la mode” pour (re)nommer des aspects déjà couramment couverts par notre activité documentaire ?
Lieu : WTC III
NUMÉRO SPÉCIAL
Inforum 2011
I&D: for dummies???
 Éditorial
Éditorial
Une fois de plus, nous avons le plaisir de vous offrir un numéro thématique dédié à l’Inforum qui s’est tenu au mois de mai dernier. Pour les non-membres qui consulteraient par hasard ce numéro : sous l’appellation Inforum se cache l’activité principale de l’Association Belge de Documentation, une journée d’étude sur des sujets d’actualité brûlants, un moment de diffusion des connaissances et de partage d’expériences pour les collègues du secteur, ainsi qu’une excellente opportunité pour la création de réseaux.
Après vérification : en 2008, nous décidions –tout en espérant que comme l’Inforum, ceci devienne une tradition – de consacrer systématiquement un numéro thématique des Cahiers de la Documentation au dernier Inforum. Je me souviens encore que le rédacteur en chef de cette publication, à qui je voue un énorme respect pour le travail effectué au sein de l’ABD-BVD, me proposa prudemment de consacrer un numéro par an à l’Inforum. Une idée bien évidemment positive puisque chaque membre mais également tout professionnel qui feuillette ces Cahiers, peut relire les thèmes traités durant cette journée, et ceci même d’un point de vue différent de l’auteur/orateur pendant son exposé. Si j’avais su à l’époque qu’il me demanderait chaque année d’écrire l’éditorial, j’aurais sans aucun doute tenté de le faire changer d’avis. Néanmoins, nous célèbrerons l’an prochain un numéro jubilaire, le cinquième dans la série consacrée à l’Inforum.
À la clôture de chaque Inforum, nous vous présentons un formulaire d’évaluation. Formulaire dans lequel, cette année, hormis les questions usuelles concernant les exposés et l’organisation, nous vous posions deux questions orientées sur le meilleur moment pour organiser cette journée (avril ou mai) et votre opinion sur une après-midi d’études ou un Inforum sur le droit d’auteur. Suite à ce questionnaire, je peux d’ores et déjà vous annoncer que nous discuterons de copyright le 31 mai 2012. Des discussions au sein du groupe de travail Inforum, il ressort qu’une fois de plus, des orateurs venus de Belgique et de l’étranger viendront approfondir le sujet. Les spécialistes que nous avons contactés jusqu’à maintenant font autorité en la matière. En sus, nous allons tenter de vous amener la cerise sur le gâteau. Nous espérons réussir cette mission, de plus amples informations filtreront une autre fois.
Mais revenons à l’Inforum 2011 – I&D : for dummies ???-, un titre qui passe en revue quelques nouvelles tendances ou nouveaux instruments de travail potentiels pour nos différents métiers touchant à l’I&D. Le titre n’a effrayé personne ; que du contraire : la fréquentation fut une des meilleures des dix dernières années. Un titre qui nous a permis d’appréhender des sujets fort diversifiés : comment développer un dépôt institutionnel, quid d’une bibliothèque sur Twitter, les possibilités d’un service de questions/réponses virtuel, les codes QR et le cloud computing pour les centres d’information. Un autre exposé prévu sur les systèmes intelligents d’information et de communication et leur impact sur notre vie (professionnelle) de tous les jours et les possibilités futures n’a pu se tenir. Le chaos provoqué par la circulation automobile le matin de l’Inforum – j’en ai également fait les frais – a empêché l’orateur d’arriver à temps des Pays-Bas vers Bruxelles.
En bref, trop de sujets hétéroclites pour trouver un titre fédérateur et donc un titre qui annonce d’emblée qu’il ne faut pas sous-estimer les tâches de plus en plus évoluée, doublées de moyens technologiques complexes.
Vous êtes encore sceptiques ? Épluchez ce numéro (et bien sûr également tous les autres) des Cahiers de la Documentation et je suis convaincu que vous approuverez le sens caché de ce titre.
Merci pour votre présence en nombre ainsi que vos évaluations très positives, qui nous ont plus que contentés car, après toutes ces années, nous avons réussi le pari de vous offrir un forum où vous pouvez échanger vos expériences le plus simplement du monde.
Notre gratitude s’exprime en premier lieu envers les orateurs et les modérateurs sans qui cette journée n’aurait pas lieu d’être.
Les exposés, le lunch et la réception de clôture nécessitent quelques salles. Nos remerciements vont à la Bibliothèque Royale de Belgique, en particulier au directeur général qui, avec bienveillance, nous met cette infrastructure à disposition. Cette année, nous avons également eu la possibilité, pendant les pauses, de visiter le Librarium, un espace d’exposition permanent et unique au sein de la Bibliothèque Royale, qui traite de l’histoire du livre et de l’écrit.
Merci également aux interprètes, aux hôtesses, au traiteur et à l’assistance technique pour l’épatant soutien logistique qu’ils fournissent. L’apport du groupe de travail Inforum de l’ABD-BVD a permis de réaliser toute cette organisation. Merci à chacun de nos membres et surtout au Conseil d’Administration de l’ABD-BVD qui m’accorde une fois de plus sa confiance pour la préparation de l’Inforum 2012.
La qualité sera non seulement au rendez-vous lors de notre prochain Inforum mais également pendant les réunions mensuelles. Nous espérons évidemment que ces Cahiers de la Documentation répondent pleinement à vos attentes.
Marc VAN DEN BERGH
OAI-PMH for dummies : Comment mettre en place un dépôt institutionnel avec des ressources limitées ?
Patrice X. CHALON, Knowledge Manager, Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE)
Luc HOURLAY, Bibliothécaire/Webmaster, Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE)
En 2006, le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE), institution fédérale belge nouvellement créée, a évalué l’opportunité de mettre en place un dépôt institutionnel conforme au protocole OAI-PMH. Compte tenu des ressources limitées, mettre en place un logiciel spécifique n’a pas été l’option retenue ; l’utilisation du processus de description des rapports dans le système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) a été identifiée comme l’option offrant le meilleur rapport coût/bénéfice. En 2010, PMB, le SIGB libre utilisé au KCE, a acquis la fonction de serveur OAI-PMH. Cela a permis au KCE d’exposer ses rapports aux agrégateurs de métadonnées, mais également d’envisager le développement de ses propres agrégateurs pour des domaines spécifiques. Dans cet article, nous décrivons le processus ayant abouti à la création d’un dépôt institutionnel au départ d’un SIGB. Nous discutons également le défi que représente la mise en place d’agrégateurs.
Twitterende bibliotheken: Een praktische handreiking
Wilma VAN DEN BRINK, Informatiespecialist Maatschappij en Recht, Hogeschool van Amsterdam
Twitter semble le nouveau moyen miracle pour entrer en contact et forger des liens avec le groupe cible. De ce fait le nombre de bibliothèques qui ouvrent un compte Twitter est en forte augmentation. Mais ces espérances sontelles atteintes ? L’article traitera de la façon dont les bibliothèques et les spécialistes de l’information font usage du réseau social Twitter. En outre, il offrira une aide pratique aux organisations qui cherchent à s’engager stratégiquement sur ce réseau.
Les nouveaux usages numériques : Les services questions/réponses virtuels
Jean-Philippe ACCART, Directeur des études, Universités de Berne et Lausanne – Programme Master ALIS
Le service de référence virtuel séduit de plus en plus les bibliothèques ou d’autres services d’information (publics et parfois privés) qui y voient un excellent moyen d’être présents sur Internet et d’assurer leur promotion, dans une démarche marketing. Il offre de nombreux avantages, un des plus évidents étant un contact direct facilité avec l’utilisateur, et une possibilité d’anticiper ses attentes en matière d’information au vu des questions posées. Les technologies actuelles, incluant celles du Web 2.0, développent des applications intéressantes en vue de créer un service virtuel efficace et attractif : les possibilités de contacts, d’échanges sont multiples. Les professionnels de l’information s’engageant dans cette voie ont la possibilité de proposer un service de référence virtuel simple ou plus élaboré. Tant en France qu’en Europe et dans le monde, les services de référence virtuels se mettent en place, se développent, ou s’organisent en réseaux collaboratifs.
Een nieuwe wind: Bibliotheken en cloud computing
Matt GOLDNER, Product & Technology Advocate, OCLC
De nombreuses entreprises et organisations optent pour le cloud computing, un nouveau modèle technologique pour les services informatiques. Cela leur permet d’abandonner l’hébergement de multiples serveurs et équipements et de ne plus devoir sans cesse réagir à l’abandon de hardware, aux installations de logiciels, aux mises à jour et aux problèmes de compatibilité. Pour beaucoup d’organisations, le cloud computing peut simplifier les processus et leur faire épargner du temps et de l’argent. Cet article définit le cloud computing et montre comment il se distingue d’autres sortes d’automatisation. Il explique aussi comment des solutions à base de cloud computing pourraient apporter aux bibliothèques des avantages dans trois domaines importants : technologie, données et communauté.
Codes QR : Un gadget ou un nouvel outil ?
Philippe ALLARD, Chef de projet chargé de la gestion de la Cellule Web de la Ville de Bruxelles, GIAL
Créé au Japon en 1994, le code QR se répand en Europe. S’agit-il d’un simple gadget dont usent les publicitaires et autres communicateurs pour attirer le geek ? Ou ce code 2D peut-il être concrètement utilisé dans nos bibliothèques et centres de documentation pour livrer une information enrichie ? On verra que ces codes QR sont faciles à produire et peuvent être lus par une masse grandissante d’utilisateurs de smartphones. Les usages dans le monde de la communication et du commerce peuvent utilement inspirer le secteur public et, en particulier, les professionnels de la documentation.
Nouvelles offres, nouveaux services
par Perla Van Belle et Olivier Van Kerkhove (Swets)
De la bibliothèque euclidienne à la bibliothèque numérique
par Eric Briys (Cyberlibris)
Les nouvelles possibilités offertes par le livre numérique redessineront-elles profondément notre relation avec nos utilisateurs ? Nous apporteront-elles l’opportunité de leur proposer de nouveaux services et de (re)valoriser notre rôle ?
Lieu : Bibliothèque royale de Belgique (KBR)
par Claire Pascaud, directrice de la Bibliothèque de l’Académie royale de Belgique
La Bibliothèque de l’Académie royale de Belgique a procédé à l’intégration de l’ancienne Bibliothèque d’histoire locale de Dexia (ancienne bibliothèque du Crédit communal de Belgique) soit plus de 45.000 ouvrages et 70.000 cartes postales. Après une présentation des services et de l’organisation de sa bibliothèque, Mme Pascaud nous a fait part de ses retours d’expérience concernant cette importante opération d’intégration dans leur fonds et dans leur catalogue en ligne.
Lieu : Bibliothèque de l’Académie royale de Belgique
 Éditorial
Éditorial
Cet été, le temps d’un long week-end, la presse belge francophone a cessé d’exister… du moins sur Google.
Pour ceux qui n’aurait pas suivi l’affaire « Copiepresse vs. Google », voici un petit résumé des faits. Copiepresse, la société de gestion des droits de éditeurs de la presse quotidienne belge francophone et germanophone, s’oppose depuis des années à la diffusion des articles de leurs affiliés sur le service Google News, contestant notamment la mise en cache des articles et la diffusion de larges extraits sans qu’aucun accord n’ait été négocié. Un jugement favorable aux éditeurs a été rendu en 2006 et confirmé en mai 2011. Menacé d’astreintes importantes, le géant américain a décidé de retirer toute référence aux sites de ces éditeurs, non seulement dans Google News mais aussi dans leur moteur de recherche. Le 15 juillet, un internaute cherchant le site du Soir ou de La Libre Belgique ne pouvait plus les retrouver via le moteur de recherche le plus utilisé du monde. La presse belge crie au scandale et parle alors de « boycott », voire de « censure ». Trois jours plus tard, Google rétablissait les liens dans son moteur de recherche. Affaire réglée ! Du moins pour l’instant car d’autres procédures judiciaires sont annoncées[1].
Il n’est évidemment pas de mon ressort de commenter une décision de justice. Je ne souhaite pas plus m’étendre sur les pratiques souvent critiquées de Google. On est ici face à un problème complexe mêlant droit d’auteur et intérêts économiques, sans compter les débats sur une certaine vision du Web. Cependant, je voulais faire part de mon interrogation sur la politique des journaux belges francophones. Depuis des années, leur devise semble être « Pour vivre heureux, vivons cachés ». En effet, si les journaux belges francophones sont absents de Google News, ils sont également absents des agrégateurs internationaux. Les professionnels de l’information, à l’étranger, sont ainsi privés de sources de qualité sur notre pays. Quant aux professionnels belges, dont la portée des recherches dépasse très souvent les frontières de notre petit pays, ils sont souvent obligés de payer deux abonnements, l’un à agrégateur international et à un intégrateur belgo-belge.
Rappelons que l’intérêt d’avoir recours à ces agrégateurs permet, non seulement une recherche sur plusieurs sources à la fois, mais aussi d’établir efficacement et facilement une veille sur un sujet. La politique des éditeurs rend ce travail plus compliqué et plus cher.
Pourtant, des négociations semblent possibles puisque les journaux flamands, eux, sont présents tant dans Google News, que dans les agrégateurs internationaux. La presse francophone est-elle plus rebelle ? Moins flexible quant à ses droits ? Plus gourmande ? Ou n’a-t-elle pas encore intégré le passage au numérique ? On est en droit de se poser la question.
Plaidons donc pour que la presse belge francophone intègre, enfin, les agrégateurs internationaux, qu’ils soient gratuits ou payants, professionnels ou grand public. À force de se marginaliser, ces journaux perdront tant le grand public que les documentalistes et ce ne sera pas rendre justice à tous ces journalistes qui, chaque jour, nous informent et font un travail remarquable.
[1] Cet éditorial a été écrit le 14 août. Une procédure pour dommage et intérêt devrait être engagée par Copiepresse, le 8 septembre.
Guy DELSAUT
Le journalisme d’investigation et l’accélérateur de particules informatives
Marc VANESSE, Ancien journaliste au quotidien Le Soir (1989-2008), Chargé de cours en journalisme d’investigation et déontologie de l’information, Co-fondateur du Lemme (Laboratoire d’études sur les médias et la médiation), Université de Liège
Comme forme la plus achevée du métier d’informer, le journalisme d’investigation exige une parfaite maîtrise de l’ensemble des techniques journalistiques les plus poussées pour traquer le secret partout où il se trouve. Mais à chaque étape de son enquête, a fortiori depuis l’irruption des outils numériques, le journaliste doit pouvoir s’appuyer sur des sources fiables et des documents incontestables. D’où la nécessité de travailler en parfaite harmonie avec des documentalistes passionnés par l’actualité. Et par la quête de vérité.
Impala, 20 ans en ligne droite dans un monde de l’information en évolution rapide
Jan CORTHOUTS, Diensthoofd van Anet Bibliotheekautomatisering, Universiteit Antwerpen (UA)
Julien VAN BORM, Ere-hoofdbibliothecaris, Universiteit Antwerpen (UA)
Michèle VAN DEN EYNDE, Anciennement Hoofd van de Interbibliothecair Leenverkeerdienst, Universiteit Antwerpen (UA), et Coördinator van Impala (jusque fin avril 2011). Aujourd’hui pensionnée.
Impala, le système belge pour le prêt interbibliothèques (PIB) et la fourniture de documents, a été développé par l’Universiteit Antwerpen et fut accepté comme système national en 1991. Vingt ans plus tard, dans un monde de l’information qui évolue très vite, il est toujours opérationnel et continue à fonctionner sur les mêmes bases qu’au départ. Cependant, il fonctionne en version web depuis 1998 et la fourniture électronique de documents a été ajoutée en 2001. Cet article donne un aperçu des possibilités d’Impala et fournit en même temps des statistiques qui donnent une idée du PIB en Belgique.
Unicat revisited: Belgische collectieve catalogus opnieuw beschikbaar
Jan CORTHOUTS, Hoofd Anet Bibliotheekautomatisering, Universiteit Antwerpen (UA)
Unicat est le portail qui, en Belgique, donne accès aux collections des bibliothèques scientifiques – environs 13 millions d’enregistrements. Unicat a été réalisé par les bibliothèques universitaires belges, en collaboration avec l’entreprise danoise SemperTool. Cet article se concentre sur la genèse de Unicat, avec ses prédécesseurs tels que le Catalogue Collectif des Titres (CCT) et le Catalogue Collectif Belge (CCB) et met en évidence les différentes fonctions du portail, dont l’intégration dans Impala. L’article indique aussi comment d’autres bibliothèques peuvent inscrire leurs collections dans Unicat. Le modèle commercial d’Unicat est basé sur une participation aux coûts en proportion du nombre d’enregistrements délivrés. Le projet est réalisé par un groupe de travail technique – comprenant des représentants de la Bibliothèque royale et des bibliothèques universitaires – et est contrôlé par un groupe pilote comprenant notamment des représentants du Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk (VOWB) et de la Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (BICfB).
Un consommateur informé en vaut deux : Le rôle du CRIOC
Sylvie MEJBLUM, Responsable presse, Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs
(CRIOC)
Réjane DETHISE, Documentaliste, Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs
(CRIOC)
Le CRIOC, Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs, réalise des études scientifiques et analyse l’information sur différentes matières en lien avec la consommation, particulièrement celles abordées au sein de commissions telles qu’entre autres, le Conseil de la Consommation, le Conseil fédéral du Développement durable, la Commission des Assurances et les groupes de travail en lien avec l’alimentation, les assuétudes l’énergie etc. Le CRIOC publie aussi des articles sur ses différents sites. Il informe le citoyen dans tous les domaines qui touche à la consommation afin de rendre le citoyen plus avisé et critique. L’information est relayée de manière claire sur le site en des termes abordables pour le consommateur (par exemple, la vulgarisation des articles juridiques). Le centre de documentation a une fonction de conservation de la littérature grise consumériste dont le fonds a été créé en 1975 et permet de retracer l’histoire des organisations de consommateurs et de la consommation en général. Il a une fonction de diffusion d’une information actualisée et spécialisée (lecture de la presse, dépouillement de périodiques spécialisés, documentation juridique, actions des organisations de consommateurs, etc.).
par Frédéric Lemmers, KBR, Numérisation – Digitalisering
Depuis 2007 la KBR mène deux projets de numérisation massive : la numérisation de sa cartothèque (rétroconversion de plus de 1.5 millions de références de notre catalogue) et la numérisation avec OCR d’une quarantaine de quotidiens belges (plus de 3 millions de pages). Après sa participation à différents projets européens de numérisation et l’accord du niveau fédéral pour un partenariat avec le secteur privé, la KBR a lancé un programme interne de numérisation massive d’œuvres imprimées et de collections de microfilms. Cette présentation analysera les différents aspects à prendre en considération dans la réalisation d’un tel projet interne de numérisation massive.
Lieu : Bibliothèque royale de Belgique (KBR)
NUMÉRO SPÉCIAL
Info & éthique : Y a-t-il une ligne rouge ?
 Éditorial
Éditorial
Les jardiniers le savent : même un jardin sauvage, pour montrer toute sa beauté, a besoin de travail et du respect de certaines règles en harmonie avec la nature. Il en va de même avec l’information. De plus en plus, la tendance est de croire que la quantité remplace la qualité et que de l’espace informationnel largement ensemencé, les TIC sortiront toujours la réponse adéquate. Mais comme la plus belle fleur peut être étouffée par les herbes folles bien avant d’atteindre sa splendeur, l’information la plus subtile peut échapper à celui qui la cherche, perdue dans le verbiage et l’insignifiance conjugués, et cela, dans le meilleur des contextes de comportements adéquats. Que dire alors dans le cas de pratiques déviantes dont l’objectif est de travestir ou de détourner l’information ?
Aveuglés par un technocentrisme béat, nous adoptons volontiers des systèmes et des pratiques qui sont censées nous faciliter la vie en ne pensant que très rarement aux conséquences néfastes qu’ils pourraient avoir. Une pause est parfois nécessaire pour arrêter cette course effrénée et pour réfléchir à ce qui est bon, à ce qui l’est moins et à ce qui est inadmissible. Le moralisme n’est guère à la mode en ce 21e siècle. Nous parlerons donc dans ce numéro de sa version douce : l’éthique.
Se conformer à des règles qui balisent et qui encadrent un travail est certes positif mais il ne faudrait pas que cela se limite à des recommandations rédigées sous forme de codes auxquels tout le monde est censé adhérer, que personne ne lit et qui ne conduisent à des sanctions que dans les cas très graves qui finissent devant la justice.
Malgré le scepticisme que certains peuvent afficher à l’égard de la notion-même, il nous a semblé indispensable de lui consacrer tout un numéro de notre revue. Ce numéro nous le dédions à Maud Scheuren qui nous a quittés l’année dernière et qui, comme en ont témoigné ses proches et ses amis, avait placé sa courte existence et sa vie professionnelle sous le signe de la probité, de la disponibilité et du service.
Simone JÉRÔME
Library ethics on an international level: IFLA and its committee on « Free Access to Information and Freedom of Expression » (FAIFE)
Hermann RÖSCH, Professor of Information Science, Cologne University of Applied Sciences
L’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) a mis en place le Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE) pour souligner son engagement éthique et promouvoir la liberté intellectuelle et la mission essentielle des bibliothèques en tant que portes du savoir et des idées. Les activi-tés de la FAIFE vont de la collecte d’informations sur l’état du monde en termes de libre accès à l’information et de liberté d’expression (World Report) à l’élaboration de divers manifestes (p.ex. Internet Manifesto) et de matériel pédagogique approprié. Un de ses derniers projets a pour objectif la création d’un code international de déontologie pour les bibliothécaires. Le premier numéro de la FAIFE Newsletter a été lancé récemment. Conjointement à la présence de la FAIFE sur Facebook, Twitter, etc, cela permet d’envoyer des nouvelles, de réagir immédiatement si nécessaire et d’inviter les gens à interagir et à participer à des débats sur le sujet. L’objectif global est d’élever le niveau de sensibilisation à l’éthique dans le monde des bibliothèques, de renverser les modes anciens et nouveaux de la censure et de surmonter toute menace à la liberté intellectuelle.
Digital ethics
Rafael CAPURRO, Direktor, Steinbeis-Transfer-Institut Information Ethics (STI-IE)
L’éthique numérique traite de l’impact des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sur nos sociétés et plus généralement sur l’environnement. L’éthique numérique des média s’intéresse plus explicitement aux questions éthiques concernant Internet et l’information de réseau ainsi qu’aux média de communication tels que les téléphones portables et la navigation mobile. Cet article introduit d’abord l’impact des TIC sur notre société et l’environnement. Des questions telles que la vie privée, la surabondance d’information, l’addiction à Internet, le fossé numérique, la surveillance et la robotique seront abordées d’un point de vue interculturel. Le message de cet article est que la réflexion éthique peut et doit contribuer à trouver des solutions durables aux défis technologiques de l’ère numérique.
Article rédigé suite à la conférence donnée par l’auteur dans le cadre du 2009 Global forum on civilization and peace organisé par l’Academy of Korean Studies, du 1er au 3 décembre 2009, à Séoul. Il a déjà été publié sur le site personnel de l’auteur et est reproduit avec son autorisation.
Ethics, social media and mass self-communication
Robert W. VAAGAN, Associate Professor, Oslo University College – Faculty of Journalism, Library and Information Science
Un modèle révisé de l’éthique en matière d’information est présenté. Il peut s’avérer utile dans l’analyse des défis éthiques, dans ce que Manuel Castells décrit comme un système émergent d’ »auto-communication de masse » dans lequel les media sociaux jouent un rôle-clé. Le modèle identifie trois sources ou spécificités de notre ère de l’information qui débouchent sur cinq problèmes éthiques liés à cinq droits individuels. Alors que le système d’autocommunication de masse est envisagé quelque peu différemment par des théoriciens tels que Castells, Jenkins ou Lyon, la réflexion éthique associée au passage du web 2.0 au web 3.0 dépend du poids relatif accordé aux théories normatives de la vertu, du devoir et de la conséquence.
Le documentaliste et l’éthique
Jean-Philippe ACCART, Directeur des études, Universités de Berne et de Lausanne – Master of Advanced Studies in Archives, Librarianship and Information Science (MAS ALIS) – Programme de formation continue en archivistique, bibliothéconomie et sciences de l’information
Cet article donne les grands principes fondamentaux servant à l’élaboration d’un code de déontologie pour les professionnels de l’information et les documentalistes : par rapport à l’utilisateur, à l’employeur, à l’information et à la profession. La plupart des associations professionnelles ont rédigé leur code déontologique. L’exemple du Euro-pean Council for Information Associations (ECIA) est celui le plus souvent cité.
Waarom een gedragscode voor informatieprofessionals?
Steven VAN IMPE, Consulent wetenschappelijk werk, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Lid van de werkgroep Beroepscode voor Informatieprofessionals, Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD)
Depuis 2009, la Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) s’active à la mise au point d’un code de bonne conduite pour les professionnels de l’information, un document avec des directives morales pour tous ceux qui travaillent dans une bibliothèque. Cet article analyse le contexte local et international de ce code. La façon dont il a vu le jour est examinée. Une partie importante de l’article expose les raisons de la nécessité ou de l’utilité d’un tel document. Divers exemples montrent clairement qu’un tel code est bien plus qu’une simple vue de l’esprit : ce sont là des valeurs dont les collaborateurs de bibliothèques ont déjà bien souvent été implicitement invités à adopter, de manière qu’elles soient appliquées tant en interne que vis-à-vis de leurs clients et des autorités. Ainsi, le code devient un bon moyen pour professionnaliser davantage le secteur.
Cet article a déjà été publié dans META, n° 5 (juin 2010). Il est reproduit avec l’aimable autorisation de la VVBAD.
After de code: Actions to put a code of ethics into real practice
Jorge CANDÁS ROMERO, Member of Ethics Group, Asociación Española de Documentación e Información (SEDIC)
Le code de déontologie ne peut être perçu que comme la première étape des démarches éthiques d’une asso-ciation professionnelle. Il définit le cadre des décisions éthiques, mais il ne permet pas, à lui seul, de résoudre les dilemmes éthiques, et ne peut pas être donné aux praticiens sans précautions concernant son esprit et son utilisa-tion. Il doit aussi être mis à disposition des membres et être fonctionnel. Quatre actions principales (avec leurs avantages et inconvénients) sont proposées dans cet article : la création de lignes directrices pour l’utilisation et l’interprétation du code, l’établissement d’un groupe d’experts chargé de conseiller les membres, l’élaboration de réponse aux comportements non éthiques et la promotion du code. L’objectif est de constituer les fondements de la déontologie de l’association professionnelle, prêts à l’emploi pour résoudre les dilemmes éthiques qui se posent à la profession et aux praticiens.
Les dangers de la désinformation : Appel au sens critique, aux documentalistes et experts
Christiane DE CRAECKER-DUSSART, Licenciée en Histoire et Bibliothécaire-documentaliste
Willy DE CRAECKER, Ingénieur civil et Conseiller technique
Près de 40 ans d’expérience en information, documentation, lectures, consultations, études, analyses, audits et publications, débouchent sur un constat alarmant : l’information se double très souvent d’une désinformation ou de manipulation du public visé, qui peut prendre de multiples formes. Cette situation a toujours existé, mais prend des proportions inégalées au 21e siècle, vu l’explosion actuelle des réseaux mondiaux d’information. Le texte décrit les nombreux dangers de la désinformation et les graves menaces qu’elle fait peser dans tous les domaines. Après l’historique et les concepts, l’article traite des processus, influences et conséquences des manipulations. Il propose des solutions pour les vaincre, en particulier des méthodes permettant d’aiguiser et d’exercer le sens critique salu-taire et en appelle aux professionnels, notamment bibliothécaires, documentalistes et experts indépendants et com-pétents. Le tout est illustré de 3 exemples pratiques détaillés et complété d’un glossaire et de notes.
Éthique et informatisation
Michel VOLLE, Économiste
L’informatisation a donné naissance à un alliage entre le cerveau humain et l’ordinateur et fait émerger un continent, le « cyberespace », où se manifestent des possibilités et des risques nouveaux. Il en est résulté une transformation des techniques de production, du contenu des emplois, de la sociologie et de l’organisation de l’entreprise. Il en résulte l’exigence d’un « commerce de la considération » dans les rapports des entreprises avec leurs agents opérationnels, leurs partenaires, leurs fournisseurs et leurs clients. Rares sont cependant les entreprises qui ont pris la mesure du phénomène. Cette évolution, que l’on peut juger positive, s’accompagne par ailleurs de dangers nouveaux : la concurrence est très violente, la fraude et la criminalité tirent parti de l’informatique avec la complicité de quelques « pays voyous » et banques « fantômes ». L’exigence éthique se manifeste donc en plein, qu’il s’agisse du corps des règles et des lois ou des comportements individuels.
Lanceurs d’alerte : Des vigilants parmi nous
Jacques TESTART, Directeur honoraire de recherches, Institut national de la Santé et de la Recherche médicale (Inserm), Président, Fondation Sciences citoyennes
Ceux qui révèlent le risque d’une certaine pratique ou d’un produit technologique pour la santé et l’environnement (les « lanceurs d’alerte ») sont des « vigiles » qu’il importe de protéger de la répression, par justice sociale comme pour encourager de tels comportements. Mais il faut aussi protéger l’alerte elle-même c’est à dire évaluer sa pertinence et prendre des mesures proportionnées à la menace. Or, les intérêts particuliers, souvent économiques, qui font taire le lanceur d’alerte sont aussi présents chez ceux qui produisent l’expertise sur la dangerosité de la technologie suspectée. Il importe donc de disposer d’une autorité pouvant imposer à la fois des règles déontologiques pour assurer l’objectivité de toute expertise et la protection de tout lanceur d’alerte de bonne foi.
Mésusages informationnels et plagiat : Réflexions autour de quelques effets secondaires du Web 2.0
Daniel PERAYA, Professeur, Université de Genève – Unité des TEChnologies de Formation et d’Apprentissage
Claire PELTIER, Auxiliaire de recherche et d’enseignement, Université de Genève – Unité des TEChnologies de Formation et d’Apprentissage
Face au phénomène du plagiat, les universités répondent le plus souvent par la détection et la sanction systé-matique des cas de fraude. Les causes possibles sont attribuées à l’apparente facilité d’accès à l’information au-jourd’hui ainsi qu’aux mutations sociétale (consumérisme effréné) et académique (massification et hétérogénéité du public étudiant). Après avoir replacé le Web 2.0 dans le contexte d’évolution des techniques et des technologies et présenté leur impact sur les connaissances, nous montrerons que derrière le plagiat comme dénomination générique on trouve plusieurs formes de mésusages informationnels, intentionnels ou non, et que ceux-ci peuvent être consi-dérés comme des effets secondaires négatifs, symptomatiques d’une surabondance d’information de qualité inégale et d’un manque de repères entraînant une mauvaise transposition des pratiques courantes du Web 2.0 dans la sphère académique. Enfin, nous évoquerons succinctement notre contribution à l’émergence d’une culture informa-tionnelle chez nos étudiants de l’Université de Genève.
Alternatieve vormen van kernfusie: Een merkwaardig geval van hebzucht
Mathieu SNYKERS, Doctor in de Wetenschappen
Il arrive également que les scientifiques témoignent de cupidité, ce qui peut nuire à leur attitude critique. C’est ce qui s’est produit lorsque Pons et Fleischmann déclarèrent avoir trouvé une nouvelle forme de fusion nucléaire. Ils choisirent le media grand public et non la publication traditionnelle avec « peer review » dans une revue scienti-fique. Même s’il apparut assez rapidement que la recherche n’avait pas été effectuée correctement, un grand nombre de chercheurs furent captivé par le battage de la fusion à froid. Après plus de vingt ans certains cher-cheurs continuent à y croire. L’auteur – qui travaillait au Centre d’Étude de l’Énergie nucléaire, à Mol – décrit com-ment les chercheurs peuvent se faire induire en erreur par leur propre orientation psychologique.
Doc en stock
Het documentatiecentrum van het Vlaams Vredeinstituut: Meer dan een bibliotheekfunctie?
Dominique J.B. VANPÉE, Lid van het Publicatiecomité van Bladen voor Documentatie, Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD)
Organisé avec le soutien de
Programme
MATIN
Modératrice : Evelyne Luctkens, project & bid manager International Organisations, I.R.I.S. Solutions & Experts S.A., Louvain-la-Neuve
ACCUEIL
INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
par Patrick Lefèvre, directeur général de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR), représenté par Marc D’Hoore,
et Marc Van den Bergh, coordinateur de l’Inforum 2011
OAI-PMH FOR DUMMIES : COMMENT METTRE EN PLACE UN DÉPÔT INSTITUTIONNEL AVEC DES RESSOURCES LIMITÉES ? UNE ÉTUDE DE CAS
par Patrice X. Chalon, knowledge manager, Centre fédéral d’expertise des soins de santé, Bruxelles
En 2006, le KCE, institution fédérale belge nouvellement créée, a évalué l’opportunité de mettre en place un dépôt institutionnel répondant au standard d’interopérabilité OAI-PMH. Dans cet exposé, nous décrivons comment et pourquoi, le KCE a développé un dépôt institutionnel au départ de son Système Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB). Nous discutons également le défi que représente la mise en place de méta-dépôts (agrégateurs), avec deux exemples : belge et européen.
PAUSE
LA BIBLIOTHÈQUE SUR TWITTER
par Wilma van den Brink, informatiespecialist Maatschappij en Recht, Hogeschool Amsterdam (Pays-Bas)
Twitter semble le nouveau moyen miracle pour entrer en contact et forger des liens avec le groupe cible. De ce fait le nombre de bibliothèques qui ouvrent un compte Twitter est en forte augmentation. Mais ces espérances sont-elles atteintes ? La présentation traitera des idéaux et des résultats réels des bibliothèques nationales et internationales sur Twitter. Ensuite on se concentrera sur les facteurs de succès du Musée Boerhave sur Twitter et l’on verra dans quelle mesure les bibliothèques peuvent tirer des leçons de l’approche virtuelle des clients par le monde du musée. A la fin de la présentation, on esquissera une image réaliste de l’utilisation de Twitter comme moyen de communication par les bibliothèques à l’époque actuelle et l’on fournira des fils conducteurs pratiques pour le futur.
LES NOUVEAUX USAGES NUMÉRIQUES : LES SERVICES QUESTIONS/RÉPONSES VIRTUELS
par Jean-Philippe Accart, directeur des études, Master of Advanced Studies in Archives, Library and Information Science, Universités de Berne et de Lausanne (Suisse)
L’usager numérique est une des composantes actuelles du paysage professionnel des documentalistes et des bibliothécaires : de plus en plus présent sur Internet, il est essentiel qu’il trouve une réponse – virtuelle – si le besoin s’en fait sentir. Les services Questions/Réponses en ligne qui se développent à l’heure actuelle sont une réponse possible de la part des bibliothèques et des services de documentation et pourquoi pas d’archives. Poursuivre la relation de service créée avec l’usager de manière virtuelle est un des défis actuels pour les professions de l’information. Cette présentation aborde ces sujets, en dressant également un panorama de l’environnement numérique.
LUNCH
APRÈS-MIDI
Modératrice : Sylvia Van Peteghem, hoofdbibliothecaris Universiteit Gent
REMISE DU PRIX DE L’ASSOCIATION BELGE DE DOCUMENTATION
par Isabelle Somville-Cornet, présidente du jury du prix ABD-BVD
Lauréat : Benjamin Peiffer, Bachelier en bibliothéconomie à la Haute école de la Province de Liège
Titre du mémoire présenté : Mise à jour et révision de l’édition abrégée de la classification décimale universelle en vue d’une réédition.
“CLOUD COMPUTING” POUR LES BIBLIOTHÈQUES
par Annette Dortmund, product manager OCLC, Oberhaching (Allemagne)
De plus en plus d’applications deviennent disponibles, dans des domaines divers – le “cloud computing” est devenu une expression connue. Mais est-il également utile pour les bibliothèques de mettre leurs systèmes de gestion et leurs données en ligne ? Quels avantages ce nuage offre-t-il lorsqu’il s’agit d’applications web pour la gestion de la bibliothèque ou les services aux utilisateurs? Et quelles sont pour une bibliothèque les nouvelles opportunités de coopération et de réseau que cette technologie apporte ? La présentation donne une vue générale des développements et des considérations dans le domaine du “cloud computing” pour les bibliothèques et indique quels bénéfices cette nouvelle génération d’applications bibliothéconomiques peut nous offrir.
PAUSE
CODES QR. UN GADGET OU UN NOUVEL OUTIL ?
par Philippe Allard, chef de projet GIAL, chargé de gestion site web de la Ville de Bruxelles, journaliste
Créé au Japon en 1994, le code QR se répand en Europe. S’agit-il d’un simple gadget dont usent les publicitaires et autres communicateurs pour attirer le geek ? Ou ce code 2D peut-il être concrètement utilisé dans nos bibliothèques et centres de documentation pour livrer une information enrichie ?
CLÔTURE
par Marc Van den Bergh, coordinateur de l’Inforum 2011
QUAND L’INTERNET DES OBJETS RENCONTRE CELUI DES GENS, OU LES SERVICES « INVISIBLES » DE SYSTÈMES INTELLIGENTS
par Hans Appel, professor Computer Science & Sensor Technology, Hanze University of applied sciences, Groningen (Pays-Bas)
Nous sommes en 2011, nous laissons derrière nous la vieille et traditionnelle automatisation administrative et nous sommes ouverts à de nouvelles idées fraîches. De nos jours, chaque nouveau produit, chaque nouveau service contient à peu près un élément qui a à voir avec les technologies de l’information et de la communication. Nous fonçons de plus en plus vers un monde de systèmes intelligents et sensibles à l’environnement. Les ordinateurs pénètrent plus avant dans la capillarité de la société. Les ordinateurs reçoivent des sens, ils apprennent à sentir. Un monde de communautés et de foules (NOUS sommes plus futés que MOI), avec des senseurs et des déclencheurs. Un monde qui est agréable, attirant et où l’on se sent invité à être en contact avec la passion de l’orateur : « computer since ». Nous allons explorer ce monde. Regarder ce que l’on innove et comment, et ce que cela signifie pour nous tous. Pour nos occupations de tous les jours, mais aussi pour les possibilités futures. « Thinking out of the box » est le thème du jour !
Initialement prévu à 14h, l’exposé n’a pas pu avoir lieu.
RÉCEPTION
par Sara Lammens, responsable du département Communication de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR)
La KBR dispose d’un espace audiovisuel permanent de découverte des cultures du livre et de l’écrit : le “Librarium”. Mme Lammens nous a présenté cette magnifique réalisation et son rôle dans le cadre de la politique d’ouverture et de promotion de la KBR vers de nouveaux publics. Eglantine Lebacq et Nel Van Steenhuyse en ont assuré la visite commentée, par groupes linguistiques.
Lieu : Bibliothèque royale de Belgique (KBR)
 Éditorial
Éditorial
Vous le savez certainement, les Cahiers de la documentation ne sont pas uniquement composés d’articles de fonds. En effet, à la fin de chaque numéro, vous pouvez découvrir différentes rubriques. Si elles ne sont pas toujours toutes présentes, elles sont régulières et font partie intégrante de notre trimestriel. Je voulais profiter de ce premier numéro de l’année pour rappeler le principe de ces différentes rubriques.
Commençons par la plus récurrente : Regards sur la presse. Elle se compose des résumés des articles que nous avons trouvé les plus intéressants parmi la littérature professionnelle. Le Documentaliste-Sciences de l’information, Lectures, Information – Wissenschaft & Praxis ou le tout nouveau Meta (dont nous saluons la naissance) sont quelques exemples de revues que nous suivons. Ajoutons que cette rubrique a été gérée pendant de nombreuses années par Jacques Henrard, qui a aujourd’hui laissé la coordination à Natacha Wallez. On ne remerciera jamais assez Jacques pour le travail qu’il accomplit pour les Cahiers et pour l’ABD en général.
Côté livres, deux rubriques se complètent. D’une part, Nouvelles parutions annonce de manière synthétique les nouveaux ouvrages dans notre domaine et que nous recevons en service de presse. D’autre part, Notes de lecture pose un regard critique sur des livres récents ou moins récents lus par différents professionnels.
Les conférences sont également une source importante de formation continue. Dans les Cahiers, nous accueillons régulièrement les écrits d’orateurs qui ont accepté de transformer leur exposé – oral – en texte – écrit. À côté de ces articles, la rubrique Compte rendu apporte une vue plus extérieure et rapporte ce qui a été dit lors d’une conférence ou d’un colloque mais ne sont pas l’œuvre d’un orateur mais bien de quelqu’un du public.
Enfin, le « petite dernière », Doc en stock, vous présente des bibliothèques, services de documentation ou d’archives, à travers leurs services et leur histoire. Ici aussi, c’est l’angle externe qui a été privilégié : ces présentations étant la résultante d’une visite et de recherches documentaires.
Tout comme les articles, ces rubriques existent grâce à la bonne volonté de leurs auteurs et chacun d’entre vous peut, s’il le souhaite, participer à ces rubriques. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.
Nous vous donnons rendez-vous au mois de juin pour un numéro spécial autour de l’éthique et de l’information.
Guy DELSAUT
E-infrastructuren voor cultureel erfgoed
Rosette VANDENBROUCKE, GRID Coordinator, Belnet, Vrije Universiteit Brussel – BEGrid
Elena PHALET, Wetenschappelijke medewerker, Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI)
Les e-Infrastructures européennes et même mondiales (réseaux, infrastructures informatiques distribuées, infrastructures data) ont progressé cette dernière décennie. Elles ouvrent de nouvelles perspectives pour la recherche dans tous les domaines. Bande passante, capacité de calcul et de stockage au service de la recherche n’ont jamais jusqu’ici été si importantes. Le secteur culturel est à ce jour moins familiarisé à cette nouvelle offre, mais va s’y adapter. Des projets internationaux dans les domaines des arts et de sciences humaines relèvent le défi de ces nouvelles technologies. En particulier le projet DC-NET (Digital Cultural Heritage Network) a pour but de déterminer comment les e-infrastructures nationales et internationales peuvent apporter une valeur ajoutée au secteur du patrimoine culturel et baser leurs priorités de recherche sur les nouvelles perspectives qu’ouvre l’usage des einfrastructures.
Zoeken naar juridische informatie in de EU: Steeds meer bomen maar nog te weinig bos
Marc van OPIJNEN, Sr. adviseur rechtsinformatica, Raad voor de rechtspraak – spir-it
Pour que les citoyens et les juristes puissent jouer pleinement leur rôle au sein de l’Union européenne (UE), il convient de leur fournir un accès aux informations juridiques de l’UE et de tenir compte de leur besoin d’informations juridiques provenant des autres États membres. Ces dernières années, le nombre d’initiatives visant à rendre ces informations accessibles sur Internet se sont multipliées. Toutefois, l’accès à ces informations s’avère souvent difficile : les données sont à peine mises en relation les unes avec les autres, les sources d’information ne sont pas clairement identifiées, les métadonnées ne sont pas harmonisées et les banques de données ne peuvent souvent pas être consultées au moyen des critères les plus évidents pour les juristes. Le présent article se penche sur les principales sources d’information. Plusieurs problèmes d’interopérabilité sémantique y sont illustrés à l’aide de cas concrets. Ensuite, l’article aborde plusieurs évolutions prometteuses à plus long terme.
L’enquête française « Métiers Salaires 2010 » de l’ADBS
Loïc LEBIGRE, Responsable du service emploi-formation, Association des Professionnels de l’Information et de la Documentation (ADBS)
Cet article donne les principaux résultats de l’enquête 2010 sur les métiers, les rémunérations, les pratiques, les niveaux de formation, etc. organisée, en France, par l’Association des Professionnels de l’Information et de la Documentation (ADBS). 2820 professionnels de l’information et de la documentation y ont répondu à l’aide d’un formulaire en ligne. Les résultats sont confrontés à ceux de 2005 et montrent l’évolution de la profession, ces 5 dernières années. Une attention particulière a été apportée aux jeunes professionnels, issus de la « Y-génération ».
Article rédigé suite à la présentation donnée par l’auteur dans le cadre de la réunion au Parlement européen, à Bruxelles, organisée conjointement par l’ABD-BVD et l’ADBS, le 28 janvier 2011.
Compte rendu
Journée d’étude à la Bibliothèque du Parlement européen, à Bruxelles
Carole GUELFUCCI, Responsable Documentation, Darrois Villey Maillot Brochier (Paris)
Compte rendu
Lecture, bibliothèque et société : Colloque APBD organisé en hommage à André Canonne
Michel MUYLAERT-GOBERT, Documentaliste, Université Libre de Bruxelles (ULB)