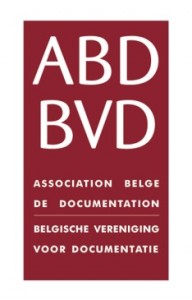Cahiers de la Documentation 2007/1 (mars 2007)
 Éditorial
Éditorial
Le jeudi 26 avril prochain aura lieu une des activités phares de l’Association. Il s’agit, vous l’avez deviné, de l’Inforum.
Le thème choisi cette année : Le documentaliste 2.0 : un second regard sur les nouvelles technologies s’avère, comme à l’habitude, parfaitement dans l’air du temps. Il n’y a pas un mois sans Web 2.0, une semaine sans wiki, pas un jour sans blog… En professionnels de l’information, nous sommes en bonne position pour ne pas succomber aux sirènes technologiques et pour exercer le sens critique qui fait partie de nos compétences essentielles.
Le succès de l’édition 2006 avait mis la barre très haut… Toutefois, l’équipe organisatrice est confiante : nous croyons que le programme de cette année est à la mesure du défi ! Jugez-en plutôt :
Nous laissons le redoutable honneur d’entamer les hostilités à David Tebbutt, collaborateur régulier de l’Information World Review (notre Financial Times, en quelque sorte). Il définira d’abord ce que sont ces technologies, qu’on dit nouvelles. Il passera en revue quelques acronymes à la mode et évaluera leur apport pour les professionnels de l’information.
Rien de tel qu’un exemple. Et quel outil plus familier qu’une classification ? Or, même dans ce domaine où la Belgique peut s’enorgueillir d’illustres précurseurs, il y a du nouveau… Céline Van Damme, de la Vrije Universiteit Brussel, exercera pour nous son sens critique sur ces développements récents qui ont pour doux noms : folksonomies et ontologies.
Pas vraiment nouveau, le phénomène du logiciel libre dépasse le simple attrait du gratuit. Qui, mieux que nous, savons que le gratuit peut se révéler très coûteux en final ? Longtemps limité aux nerds, geeks et autres techies, confiné aux structures dites désargentées, le logiciel libre a atteint, d’après Diane Revillard, auteur d’un Livre Blanc intitulé Organisations et logiciels libres1, la maturité suffisante pour être pris en considération dans le cadre d’une stratégie de développement technologique de toute organisation.
Mais revoilà le Web 2.0… Laissons Kristof Michiels nous décoder cette version. N’avions-nous pas rêvé d’associer plus étroitement nos utilisateurs au développement de nos services, voire de les y faire participer ? Voici peut-être le moyen d’y arriver…
Tout ceci semble donc bien prometteur… Mais, est-ce à notre portée, à nous, utilisateurs ‘normaux’ de technologies, qui avons dû nous former parfois sur le tas, qui ne disposons que de notre curiosité bien professionnelle ? Et aussi de notre sens critique qui l’est peut-être un peu trop parfois ? Nous avons pensé qu’un échange mutuel pourrait être très bénéfique. Partageons nos expériences, nos espoirs et nos déceptions aussi ! Pour animer la journée, et particulièrement cette session, deux grands formats : Jean Michel, qu’on ne présente plus, ou alors juste pour rappeler que cet ancien Président de l’ADBS a été nommé par les professionnels de l’information comme l’une des 5 personnalités les plus influentes des vingt dernières années2, et Inge Van Nieuwerburgh, coordinatrice de la Bibliothèque Digitale de l’Université de Gand, qui sait ce que bibliothèque et technologie veulent dire…
J’espère que vous partagerez notre enthousiasme quant à cette journée…
De plus c’est gratuit (pour les membres) ce qui ne gâte rien…
Vous ne manqueriez pas ça tout de même ?
Au plaisir de vous y rencontrer…
Vincent MAES
L’Association Belge de Documentation dans le processus de certification européenne des compétences
Isabelle SOMVILLE-CORNET, Maître-assistante, Haute école namuroise catholique (HENaC) – Baccalauréat en bibliothéconomie et documentation
En mars 2006, l’Association Belge de Documentation (ABD-BVD) a présenté à ses membres la certification européenne des compétences en Information & Documentation (I&D) et ses outils de certification que sont l’Euroréférentiel et l’Eurocertificat. Ces initiatives s’inscrivent dans les contextes nationaux et européen de certification des compétences acquises par la pratique professionnelle. Qu’est-ce que la certification, pourquoi se faire certifier, comment se faire certifier en I&D en Belgique ? Quelle est la place de l’ABD-BVD dans ce processus ?
International Transport Research Documentation (ITRD) : Un réseau de spécialistes de l’information et du transport
Jésica DE SALVADOR, Documentaliste, Centre de Recherches Routières
Cet article a pour objectif de présenter et de promouvoir l’International Transport Research Documentation (ITRD) mais aussi et surtout de décrire un système international quadrilingue de collaboration en matière de documentation. Après un bref aperçu historique sur la création du réseau, l’article expose le mode de fonctionnement du système, tant au point de vue de la gestion administrative et financière qu’au niveau purement documentaire à savoir logiciel documentaire interne de travail, mode d’échange des notices, outil terminologique et base de données bibliographiques qui en ressortent.
Le coût du libre accès dans le cas du modèle hybride
Caroline COLLETTE, Responsable scientifique, Université de Liège – Bibliothèque des Sciences et Techniques
Le mouvement du libre accès prône un modèle de communication garantissant un accès libre et universel aux résultats de la recherche. Dans ce contexte, des éditeurs de revues « traditionnelles » proposent aux auteurs de payer des frais afin que leur article soit directement en accès libre. Ce nouveau modèle d’accès à l’information dénommé « optional open access fee », s’est fortement développé l’année dernière. Cet article présente ce nouveau schéma de publication et par un calcul simple essaye de comparer le coût d’accès à l’information suivant ce modèle et celui de l’accès par abonnement institutionnel. Les informations utilisées pour réaliser cette estimation sont basées sur des données provenant de l’Université de Liège.
La classification de la Bibliothèque du Congrès : Coffre au trésor ou mirage ?
Virginie TACQ, Gestionnaire de l’information, Université Catholique de Louvain (UCL) – Bibliothèque de psychologie et des sciences de l’éducation
Cet article constitue le deuxième volet d’une série d’articles consacrés à la Classification de la Bibliothèque du Congrès. Après avoir examiné la structure de cette classification ainsi que celle de ses cotes de rangement, c’est au tour des avantages et des inconvénients d’être mis en évidence. En effet, chaque classification possède ses points forts et ses points faibles et la LCC ne fait pas exception. Il est important de les connaître afin de comprendre les conséquences, positives ou négatives, de l’application de cette classification. Par exemple, la langue véhiculaire qu’est l’anglais ne sera sans doute pas adaptée à tous les publics. De même, les nombreux domaines traités ou le niveau de précision peuvent être un obstacle à la mise en œuvre du système de rangement. Cependant les avan-tages ne seront pas pour autant absents des propos de l’auteur : les gains de temps dus à la récupération des don-nées et aux différents outils disponibles ne sont pas à négliger. Ces outils, qui facilitent considérablement la tâche du bibliothécaire, feront d’ailleurs l’objet d’une courte présentation.
Compte rendu
Archives d’entreprises, entre gestion patrimoniale et veille technologique
Véronique FILLIEUX et Evelyne VANDEVOORDE, Université catholique de Louvain (UCL) – Service des Archives
Présentation et premiers bilans du projet « DOCUPOLE » : cours d’initiation à la recherche documentaire en ligne développé par le groupe de travail « Bibliothèques » du Pôle universitaire européen Bruxelles/Wallonie
par François Frédéric, responsable des Formations à la Bibliothèque des Sciences Humaines (ULB)
 Éditorial
Éditorial
C’est la fin de l’année. Déjà ! Une année étrange où les saisons paraissent s’affoler, canicule en juillet, averses en continu au mois d’août, et, alors que les températures sont anormalement hautes pour la saison mais faut-il s’en réjouir, voilà que ce sont les mauvaises nouvelles qui se mettent à pleuvoir. On ne parle plus guère en cette fin novembre que fermetures d’usine et pertes d’emploi.
Cela nous amène à réfléchir sur l’emploi dans les métiers de la documentation, sa stabilité, son évolution. Bien sûr, le secteur ne fait guère de bruit mais cela ne signifie pas que des drames n’y sont pas vécus. Un service de documentation qu’on ferme, cela ne fait que quelques personnes qui perdent leur emploi, pas de quoi faire la une des journaux et pourtant pour celui qui le vit, il n’y a aucune différence. Dans ma longue carrière, j’en ai observé beaucoup des fermetures de ce genre ; des collègues très qualifiés se sont parfois retrouvés sans emploi. Il est vrai toutefois que la rapide mutation du secteur a aussi créé de nouveaux postes et que, parmi les personnes touchées, la plupart, en particulier les plus qualifiées, ont retrouvé du travail.
Cela nous suggère deux réflexions. La première, c’est que le secteur de l’information qui ‘bouge’ énormément, qui se modifie au gré des avancées technologiques, requiert toute notre attention. Nous ne devons pas nous contenter d’assimiler les nouvelles techniques et de les appliquer sans exercer notre esprit critique. Nous devons étudier leur mise en œuvre, leurs conséquences sur l’organisation du travail et sur le marché de l’emploi. Nous devons nous intéresser de près aux évolutions politiques, économiques et sociales et à leurs conséquences sur nos professions. Nous devons être les secteurs de notre avenir.
La deuxième réflexion concerne la compétence. Dans un monde devenu compétitif jusqu’à outrance, c’est presque devenu une question de survie. Il nous faut acquérir de nouveaux savoirs, créer de nouveaux services pour que la responsabilité de notre avenir ne nous échappe pas
Bonnes fêtes à tous.
Simone JÉRÔME
Open Access : Why should we have it?
Alma SWAN, Director, Key Perspectives
L’Open Access consacre la disponibilité libre, immédiate, permanente et sans restriction d’une recherche via Internet. Il s’applique généralement à des articles que leurs auteurs offrent en temps normal à des périodiques scientifiques sans aucune contrepartie financière à seule fin de réclamer l’antériorité de leurs découvertes, d’en obtenir le crédit et d’assurer leur visibilité dans leur communauté de pairs. Les auteurs tirent de tout évidence profit de cette démarche mais il en va de même pour les institutions de recherche, pour les nations et pour la société toute entière en raison de la vitrine, de la valorisation et de la plus grande efficacité qu’elle offre à la recherche. La raison pour laquelle la littérature scientifique mondiale devrait être en ‘Open Access’ repose sur quatre arguments. À cause d’une visibilité accrue, ces articles ont un meilleur impact de citation. Leur délai de parution raccourcit le cycle d’une recherche et augmente son efficacité. De nouveaux outils logiciels peuvent suivre à la trace les citations dans la littérature et découvrir des relations nouvelles entre articles et sujets de recherche ; le suivi, l’évaluation et la gestion de la recherche en est amélioré. Enfin, de manière assez prometteuse, une nouvelle génération de technologies informatiques basées sur la sémantique peuvent travailler sur de vastes ensembles de documents scientifiques pour en extraire des idées nouvelles et créer une nouvelle information à partir d’informations existantes sans liens entre elles, du moins en apparence.
In oorlogsnood : Over het dagboek van Virginie Loveling
Bert VAN RAEMDONCK, Waarnemend Coördinator, Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) en Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)
Ron VAN DEN BRANDEN, Wetenschappelijk Medewerker, Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) en Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)
Le 29 juillet 1914, alors qu’elle était déjà bien âgée, l’écrivaine flamande Virginie Loveling coucha sur le papier deux très courtes phrases. Elles allaient constituer le début d’un journal des années de guerre, aussi phénoménal que colossal, qui ne s’achèvera qu’au lendemain de l’Armistice, le 11 novembre 1918. Loveling espérait ardemment que son journal clandestin soit un jour publié dans son intégralité. Ceci n’eut cependant lieu pour la première fois qu’en 1999, dans une édition de Ludo Stynen et Sylvia Van Peteghem. Six ans plus tard, une version révisée du journal est publiée en ligne sur le site Web du « Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie » (CTB). Le journal constitue un document intéressant au plus haut point, du fait d’une combinaison variée de descriptions journalistiques factuelles, d’une part, et d’une foule de « petites histoires », d’autre part. Afin de lui restituer une forme la plus vivante et la plus pratique possible, le CTB a fait le choix d’un média qui s’est aujourd’hui substitué au journal classique : le weblog.
À l’abordage ! La classification de la Bibliothèque du Congrès, Terra Incognita
Virginie TACQ, Gestionnaire de l’information, Université Catholique de Louvain (UCL) – Bibliothèque de psychologie et des sciences de l’éducation
Chaque bibliothèque a impérativement besoin d’un langage de classification qui se rapproche le plus des exigences documentaires de son public et de son fonds. La Classification de la Bibliothèque du Congrès, ou Library of Congress Classification (LCC), peut être une de ces alternatives mais encore faut-il en connaître la philosophie et le fonctionnement précis pour en apprécier la pertinence. L’histoire de cette classification unique, intimement liée à celle de la Library of Congress, fondée en 1800, démontre le cheminement intellectuel qui guida sa création. C’est seulement au terme d’une aventure longue d’un siècle que James Hanson et Charles Martel élaborèrent la LCC. Aujourd’hui près de vingt millions de livres sont soumis à cette classification et un nombre croissant de bibliothèques l’adopte.
La gestion de l’information des organisations : Analyse de définitions et conceptualisation
Jeremy DEPAUW, Doctorant boursier, Université Libre de Bruxelles (ULB) – Dpt des Sciences de l’Information et de la Communication (SIC)
« Donner la bonne information à la bonne personne, au bon moment, pour prendre la bonne décision… » Inspirée de Michael Porter, cette citation décrit les enjeux de la Gestion de l’Information (GI), le concept central de cet article. Ce dernier a pour objectif d’identifier les dimensions du concept et leurs composantes majeures afin d’en proposer une définition, construite à partir d’une revue de la littérature. Plutôt que d’envisager la Veille ou l’Intelligence comme des activités distinctes, cet article propose la GI comme un concept composé de trois dimensions majeures : la Surveillance, la Veille et l’Intelligence. Chacune de ces dimensions fait l’objet de nombreuses définitions dans la littérature. L’analyse des mots-clés montre la prédominance de certaines catégories sémantiques, mettant ainsi en évidence la cohérence et les points communs entre les nombreuses formulations. Cet article soutient l’idée que la GI pourrait être considérée comme un concept générique, utile à la description et la compréhension de l’ensemble des démarches visant à appréhender l’information, indépendamment des moyens ou des objectifs mobilisés par chacune d’entre elles.
Compte rendu
La formation des archivistes : Relever les défis de la société de l’information
Véronique FILLIEUX et Evelyne VANDEVOORDE, Université catholique de Louvain (UCL) – Service des Archives
Recherches sur Internet : méthode et astuces
par Christophe Dupriez, Destin
 Éditorial
Éditorial
Cet été, qui vient de s’achever, a permis à l’Association Belge de Documentation de franchir le cap symbolique des 600 membres. En effet, quel que soit le type d’affiliation (individuelle, collective, étudiante), nous sommes maintenant plus de 600 professionnels de l’information à avoir estimé qu’il était important de ne pas rester seuls dans notre coin et à avoir décidé de nous affilier à une association professionnelle.
Le « métier » comportant plusieurs visages, faut-il préciser que l’ABD compte des membres tant dans l’industrie que dans les universités, les institutions internationales, les services publics, les ASBL etc. ? En tant qu’association nationale, nous avons également la chance de voir se côtoyer francophones et néerlandophones, sans oublier nos membres néerlandais, français et luxembourgeois.
Alors que jusqu’à fin 2003, le nombre de membres avait plutôt tendance à diminuer, nous sommes heureux d’avoir, en deux ans et demi, gagné 150 membres. Certes, ce n’est pas un concours et ce nombre ne change en rien les objectifs et la philosophie de notre association mais il est la preuve que vous appréciez ses activités et ses publications. Non seulement vous nous restez fidèles, mais d’autres personnes se joignent à nous. Quel beau cadeau à l’approche de notre soixantième anniversaire !
Cette progression est aussi la preuve que les professionnels de l’information sont toujours présents. Nous ne sommes pas remplacés par Google ou par un autre système informatique soi-disant révolutionnaire. Certains d’entre nous se sont sans doute un peu éloignés de l’image traditionnelle des documentalistes ou des bibliothécaires mais, en mais leur fonction n’en conserve pas moins les caractéristiques de ces métiers de base, que d’autres aspects du traitement de l’information viennent enrichir.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau Cahier.
Guy DELSAUT
La gestion d’une bibliothèque avec un logiciel libre : Exemple concret et implications
Stéphanie FORT, Bibliothécaire, Collège Saint Pierre
Une bibliothèque scolaire change de logiciel de gestion et opte pour un logiciel libre. Bonne idée ? Cet article vous propose de suivre les tribulations d’une bibliothécaire et de son public dans le monde des logiciels libres et de l’un d’eux en particulier : PMB. Depuis quelque temps, les logiciels libres rencontrent un franc succès. Qui n’a pas entendu parler de Linux et autres OpenOffice ? Le monde des bibliothécaires n’échappe pas à la règle. On voit de plus en plus de SIGB libres se développer sur le marché. Le but de cet article n’est pas de faire une comparaison de ces divers logiciels, que les professionnels que vous êtes connaissent certainement ou dont vous avez du moins entendu parler. Je désire plutôt vous faire part d’une expérience pratique d’utilisation d’un tel logiciel et de ses implications dans mon travail.
Ce que l’annuaire fait à Internet : Sociologie des épreuves documentaires
Christophe LEJEUNE, Chercheur en sociologie, Institut Charles Delaunay
Internet regorge de communautés de passionnés en tous genres. C’est de l’une d’elles que traite cette contribution. Lancée en 1998, l’initiative en question regroupe des volontaires construisant un annuaire de sites Internet. Bien avant le succès de Wikipédia, cette communauté est loin d’avoir laissé indifférents les géants de l’informatique puisque Netscape l’a sponsorisée depuis ses débuts et que le service d’annuaire de Google utilise sa base de données. Apparemment éloigné des bibliothèques, ce groupe de passionnés n’en est pas moins en train de réaliser le rêve de Paul Otlet, pionnier (belge) de la documentation. En effet, en collectant les adresses de sites Internet, en les répertoriant, les classant, ces personnes reproduisent, un siècle plus tard, ce qui fut le travail des premiers documentalistes. Ils se confrontent à des problèmes similaires. Ils y trouvent souvent des solutions analogues. Et, parfois, leurs solutions divergent. Après quatre années d’observation fouillée de cette communauté virtuelle, l’auteur propose une mise en perspec-tive de cette activité classificatoire avec les usages et les outils de la documentation.
Federale bibliotheken slaan de handen in mekaar
Stefaan JACOBS, Hoofdbibliothecaris, Bibliotheek Queteletfonds; Voorzitter van het forum van de bibliothecarissen van de Federale Overheidsdiensten
Les bibliothèques des autorités fédérales se sont réunies dans deux forums, un pour les services publics fédéraux et un pour les établissements scientifiques fédéraux. Tous deux ont mis sur pied un mémorandum dans le but de faire connaître les points névralgiques de leur travail. Ceux-ci peuvent se résumer en six thèmes : prestation de services interne, prestation de services externe, moyens financiers, accès aux collections, ressources humaines et collaboration. Les bibliothèques ne sont pas restées passives et ont développé un certain nombre d’initiatives pour alléger ou transformer ces aspects de leur activités, notamment par un catalogue commun, des dépliants d’information, des formations et des descriptions de fonctions, la numérisation des collections, la livraison de documents, des journées d’études, des communautés virtuelles et l’appui à des projets externes comme le e-depot. Les bibliothécaires remarquent que le contexte dans lequel ils travaillent est en proie à des changements importants et veulent s’armer pour évoluer dans leur rôle de chercheurs d’informations et par conséquent, pouvoir continuer à exister.
Het beheer van elektronische collecties
par Guido Goedemé, Afdelingshoofd Geautomatiseerde Documentatie, Koninklijke Bibliotheek van België
Open Access, terug naar de kern van wetenschappelijke communicatie
par Inge Van Nieuwerburgh, Coördinator Digitale Bibliotheek, Universiteitsbibliotheek Gent, Universiteit Gent
NEREUS – Economists online : l’open archive dans le domaine de l’économie en Europe
par Jacques Hellemans, Bibliothécaire et responsable du service Information économique. Responsable de la bibliothèque des sciences économiques et de gestion de l’ULB
 Éditorial
Éditorial
Quelle culture voulons-nous ? Voilà le titre de l’éditorial du premier numéro de l’année de Lectures. Il est signé par la Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse de la Communauté française. La question est bien posée et la Ministre y donne des réponses dans les limites de ses compétences et des moyens dont elle dispose. Est-ce suffisant ?
Il existe un nombre considérable de définitions du mot « culture ». Il vient du latin « colere » qui signifie : habiter, cultiver, honorer, toutes notions qui expriment les liens d’un être avec son environnement et avec ses congénères dans la durée et la qualité. Sur le plan individuel, il recouvre l’ensemble des connaissances acquises et collectivement, le patrimoine, social, artistique et éthique d’un ensemble d’individus se réclamant d’une même identité.
Le siècle passé, boulimique s’il en fut, a fini par remplacer la qualité par la quantité. Toujours plus de… Malheureusement, le temps se caractérise par son inélasticité et les nouvelles technologies, si elles permettent d’effectuer toujours plus d’opérations dans une unité de temps, ne peuvent allonger celui-ci. Chaque opération sera donc de plus en plus éphémère et sa trace toujours plus ténue. Notre culture sera-t-elle la culture de l’instant, autrement dit l’absence de culture, puisque aussitôt consommé le fait momentané ne s’inscrit plus dans une progression vers un idéal mais se perd dans l’émiettement d’un temps déstructuré ?
Faut-il s’étonner dès lors que la valeur, aussi bien d’un produit de l’activité humaine que du temps nécessaire à sa réalisation, ne se mesure plus qu’en rapport avec la monnaie, qui n’est après tout, qu’une création abstraite et très relative ? Que l’on puisse détruire la vie, que ce soit celle de l’arbre séculaire d’Amazonie, de l’ours blanc du pôle ou de l’adolescent innocent dans la foule, marque une limite et il faut dès à présent prendre le temps de réfléchir à notre futur, si nous en voulons un.
Vous voilà bien loin de la documentation, me dira-t-on ? En êtes-vous sûrs ? N’avons-nous pas pris l’habitude de compter en méga-ceci et en giga-cela. Ne parlons-nous pas trop souvent de stratégie et de compétition ?
Et si on rêvait un peu ?
Simone JÉRÔME
Nationaal project voor de bewaring van Belgische kranten « Presse-papier »
Dirk LUYTEN, Verantwoordelijke Tijdschriften, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)
Marc D’HOORE, Verantwoordelijke Afdeling Kranten en Tijdschriften, Koninklijke Bibliotheek van België
Lors d’une journée d’étude à la Bibliothèque royale, le 25 novembre 2005, le Projet national de conservation de la presse belge sur support papier a présenté son action. Le projet, placé sous la direction de la Bibliothèque Royale et de la Bibliothèque de la Ville d’Anvers, a été lancé en 2003; en associant et en coordonnant toutes les instances de la Belgique fédérale, il a pour ambition de répondre au problème grave de la menace de disparition des journaux. En effet, les quotidiens sont une source fréquemment utilisée pour la recherche scientifique car ils fournissent de l’information sur tous les aspects de la politique et de la société.
Une référothèque pour la Police Fédérale : Proposition de cahier de charges intégrant des aspects techniques et humains…
Véronique DUMONT, Sociologue, Doctorante et Assistante, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)
Véronique LAURENT, Sociologue et chercheuse, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)
Claire LOBET-MARIS, Docteur en sciences du travail et Directrice de la CITA, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)
Evelien DE PAUW, Sociaal assistent en licentiaat in criminologie, wetenschappelijk medewerkster, Universiteit Gent
Paul PONSAERS, Dr. in criminologie en directeur van Sociale Veiligheidsanalyse, Universiteit Gent
Réfléchir à la création d’une bibliothèque virtuelle pour la Police Fédérale belge, voilà une recherche à laquelle a participé en 2005 la Cellule Interfacultaire de Technology Assessment des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur (FUNDP) ainsi que le groupe de recherche Sociale Veiligheidsanalyse (SVA) de l’Université de Gand dans le cadre du programme de recherche Agora de la Politique Scientifique Fédérale. Nous présenterons dans cet article le compte-rendu de cette recherche et ses principaux résultats. Nous montrerons également que la conception et l’aboutissement d’une telle application ne repose pas simplement sur des bases techniques ou informatiques mais doit également prendre en compte des aspects organisationnels et humains.
Former les étudiants en premier baccalauréat de chimie aux techniques de documentation et communication : Expérience réalisée à l’Université de Liège
Caroline COLLETTE, Responsable scientifique, Université de Liège – Bibliothèque des Sciences et Techniques
Cet article relate l’expérience vécue lors de l’introduction d’un cours de technique de documentation et communication au niveau de la première année d’études universitaires en chimie à l’Université de Liège pour les années académiques 2004-2005 et 2005-2006. Le cours a été inséré dans le cursus du baccalauréat chimie dans le cadre de la réforme des enseignements pour l’harmonisation des études dans l’enseignement supérieur européen. L’objectif du cours est de mettre en contact les étudiants de première année baccalauréat avec la littérature et les bibliothèques scientifiques. L’article présente l’historique de l’élaboration du cours, sa structure et le bilan que l’on peut en tirer après deux années d’expérience.
Overkoepelende fusiebibliotheek binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Vesalius Documentatie- en Informatie Centrum: Uitwerken van concept en oprichting
Bernadette CLAUS, Bibliotheekverantwoordelijke, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en Projectleider, Vesalius Documentatie- en Informatie Centrum (VDIC)
Les bibliothèques du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement se sont réunies au sein de la bibliothèque virtuelle Vesalius Documentation and Information Center (VDIC) (). Le chef de projet explique dans cet article pourquoi et comment cela a été réalisé et quelles ont été les suites pratiques. Le portail du VDIC s’est transformé en quelques mois en véritable carrefour où l’offre en information et la demande de documentation se rencontrent de manière optimale grâce à des tournées de formation auprès des différents partenaires. Le personnel des bibliothèques s’est activement impliqué dans cette réorganisation et soutient de nouvelles initiatives modernes qui devraient commencer en 2007. De nouveaux partenaires peuvent faire une demande d’affiliation à la bibliothèque virtuelle.
Compte rendu
Knowledge Economy: Challenges for Measurement
Evelyne LUCTKENS, Senior Consultant – Document Management, I.R.I.S. S.A.
par Marc Borry, Consultant en Intelligence stratégique
Programme
MATIN
ACCUEIL
INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
par Willy Vanderpijpen, chef de département à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR),
Philippe Laurent, président de l’ABD-BVD,
et Vincent Maes, coordinateur de l’Inforum 2006
SERVICES D’INFORMATION ET CLIENTÈLES : LE RÔLE DU MARKETING
par Réjean Savard, professeur titulaire, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI), Université de Montréal, Canada
Qu’est-ce vraiment que le marketing ? Comment peut-il aider les bibliothèques et les centres de documentation ? Comment l’utilise-t-on un peu partout dans le monde ? Quelles sont les implications de son utilisation pour les gestionnaires de services d’information ? Au programme : définitions, aspects théoriques, aspects pratiques. Un tour d’horizon du marketing des services d’information.
DÉTERMINER LES BESOINS EN INFORMATION DANS LE CADRE D’UNE ENTREPRISE
par Mia Brugmans, Business Intelligence, Inbev
Un sondage pour déterminer les besoins en information d’une institution peut être une entreprise considérable, mais cela peut également être réalisé à une échelle déterminée ou consister en une suite de sondages de moindre importance. Quelles sont les principales raisons qui poussent à réaliser un tel sondage de nos jours ? L’organisation ou la ré-organisation de bibliothèque ou de service d’information, la gestion des connaissances, l’intranet, la gestion (électronique) des documents et des archives, la protection des données. Au moyen d’exemples, on montrera comment la théorie peut être mise en pratique.
VERS UNE CERTIFICATION EUROPÉENNE DANS LE SECTEUR DE L’INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION : UN AVANTAGE POUR LE CLIENT (NL)
par Marc Van den Bergh, administrateur de l’ABD-BVD, membre du jury CERTIDOC
Dans plusieurs pays européens, il existe une tendance à valider les compétences professionnelles, et à ne plus se baser uniquement sur le diplôme. Pour une partie importante du secteur de l’information et de la documentation, le Consortium CERTIDOC a finalisé un Euroréférentiel, applicable dans plusieurs pays européens. L’Association Belge de Documentation y a collaboré et participe aux jurys de certification de différents niveaux (assistant, technicien, manager, expert).
PAUSE
DÉBAT
animé par Dirk Van Eylen, conseiller en gestion des connaissances, Service Public Fédéral Personnel et Organisation – Gestion des connaissances
LUNCH
APRÈS-MIDI
LA VISIBILITÉ ET LE MARKETING DE LA DOCUMENTATION EN SANTÉ
par Llewellyn Losfeld, documentaliste-webmaster au FARES (Fonds des Affections RESpiratoires)
Depuis des décennies maintenant, les centres de documentation et les bibliothèques spécialisés en santé font partie du quotidien des chercheurs et des étudiants. Face à l’instabilité liée au manque de financement se retrouve néanmoins une qualité intrinsèque à notre profession et (presque) inépuisable : notre souhait constant de susciter l’apprentissage des connaissances des utilisateurs. De cette envie naît la volonté commune de développer et d’enrichir nos expériences via des réseaux documentaires. Mais entre cet idéal et la réalité du quotidien existe un énorme fossé. Si la visibilité est bel et bien nécessaire, la reconnaissance et le succès qu’elle peut générer entraînent parfois des difficultés. Face aux nombreux changements affectant son environnement, le bibliothécaire doit perpétuellement se remettre en question.
GAGNER DES CLIENTS, UNE QUESTION DE CHOIX !
par Bart van der Meij, directeur de projets, Reekx, Pays-Bas
L’environnement dans lequel opèrent les bibliothèques, les centres de documentation ou d’information devient de plus en plus complexe, avec davantage de concurrence, de nouvelles techniques, de clients qui s’émancipent etc. Tout ceci entraîne des conséquences importantes pour la position du service au sein de son institution ou de son marché. Le positionnement et les attentes en matière de prestations sont remis en question. Dans beaucoup de cas, on s’aperçoit qu’existent, ou qu’apparaissent, le besoin d’un service nouveau ou renouvelé, l’envie de produits et de services autres ou améliorés, de nouveaux processus de travail, de nouveaux groupes-cibles ou marchés et surtout des spécialistes de l’information d’un autre genre. En fonction de différents thèmes de marketing et d’exemples tirés de sa pratique comme consultant, Bart van der Meij vous aide à trouver vous-même le bon chemin; il éclaire les concepts du marketing orienté client, il joue l’avocat du diable et confronte les auditeurs à leur propre clientèle.
PAUSE
CLIENT DIFFICILE ? QUE SE PASSE-T-IL ?
par Marc De Tienne, learning advisor au FOPAS, Fonds de promotion de l’emploi et de la formation dans le secteur de l’assurance, formateur de Junior Chamber International (JCI)
“Cela fait trois semaines que j’attends la documentation que vous m’aviez promise dans ‘les trois jours’ !!” Incompréhension ? Malentendu ? Mauvaise foi ? Au cours de cet exposé, nous examinerons les différents types de clients difficiles et les raisons qui nous les font passer pour tels. La prise de conscience de la nature du décalage entre le client et nous, nourrira les pistes de solution pour établir une relation plus harmonieuse. Nous verrons donc les outils et les étapes de communication utiles pour aider progressivement le client à revenir sur une position plus appropriée à la discussion.
VERS UNE CERTIFICATION EUROPÉENNE DANS LE SECTEUR DE L’INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION : UN AVANTAGE POUR LE CLIENT (FR)
par Isabelle Somville-Cornet, administratrice de l’ABD-BVD, membre du jury CERTIDOC
Dans plusieurs pays européens, il existe une tendance à valider les compétences professionnelles, et à ne plus se baser uniquement sur le diplôme. Pour une partie importante du secteur de l’information et de la documentation, le Consortium CERTIDOC a finalisé un Euroréférentiel, applicable dans plusieurs pays européens. L’Association Belge de Documentation y a collaboré et participe aux jurys de certification de différents niveaux (assistant, technicien, manager, expert).
DÉBAT
animé par Michel Dorban, professeur; responsable de la section bibliothèques, maîtrise en science et technologies de l’information, UCL
RÉCEPTION
L’Eurocertificat des compétences en information-documentation
par Evelyne Luctkens et Isabelle Somville-Cornet